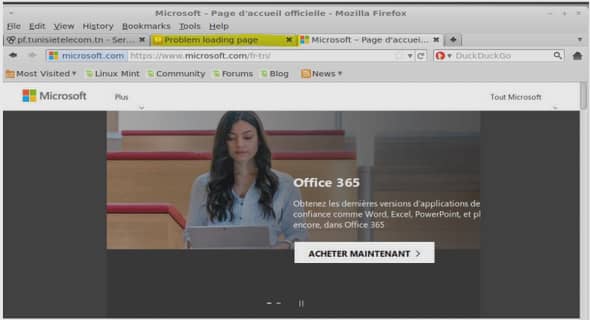LA SÉPARATION
Cette nuit, un mauvais rêve m’est revenu. Les hommes sans figure défilaient, l’épée dans la ceinture et la kalach en bandoulière. Ils passaient dans le village. Ils étaient des milliers.
Une horde de combattants sans yeux, ni nez, ni lèvres. Une armée d’ombres dans une nuit d’encre. Ils portaient des torches. La rue était un brasier sans fin et nos demeures des bûchers. Les hommes sans visage grognaient comme des ours. Ils hurlaient : « Massacrez-les tous ! »
Ils ont franchi le seuil de notre maison de torchis pour m’abattre d’une rafale de fusil-mitrailleur.
Je me suis réveillée le cœur battant.
Une lumière pâle balaye la chambre aux rideaux ajourés. Je me retourne dans le lit, l’esprit embrouillé par mon cauchemar. Walid, mon mari, est absent depuis deux semaines. Mon amoureux est maçon sur le chantier d’un immeuble en construction à Souleimaniye, une grande cité du Kurdistan irakien entourée de montagnes.
De la cuisine s’échappe une odeur de potage aux lentilles. Ma belle-mère prépare le petit déjeuner. La maison des parents de Walid s’éveille en douceur. Nesrine, leur fille aînée, et sa fille Rezan dorment encore. Amina, la cadette, a engagé une partie de cartes sur son téléphone portable lorsque l’appareil se met à vibrer. Sa cousine Diana appelle d’un village peu éloigné du nôtre : « Daech est entré dans le village ! Daech attaque ! »
Je m’attendais à devoir partir un jour ou l’autre dans la précipitation. Un sentiment de danger imminent m’étreignait depuis plusieurs jours et avec lui l’impression terrifiante qu’un monde allait s’effondrer : le mien. Je n’avais jamais rien ressenti de pareil. Un inéluctable cataclysme fonçait sur moi, emportant tout sur son passage.
Il faut déguerpir. Khero, le père de Walid, presse son petit monde féminin. Amsha, sa femme, se lamente dans la cuisine, j’entends le fracas d’une pile de casseroles qui tombent par terre. Je tire le kilim de laine disposé au pied de notre couche et soulève avec l’aide de Khero la dalle en ciment. Je sors de la cachette une bourse en cuir et un bas tricoté couvert d’une pellicule de poussière plâtreuse. Je les ai cousus après notre mariage pour y ranger notre trésor : environ 3 000 dollars en or et en argent. Notre fortune. Khero me bouscule. « Allons, dépêche-toi ! Ramasse-moi tout ça ! »
Nesrine s’énerve contre Rezan qui chouine. Elle hésite sur le choix des quelques affaires du bambin qu’elle veut emporter avec elle. Rezan marche à peine et commence juste à dire dayeke, « maman » dans notre dialecte kurde. J’aide Nesrine à dissimuler dans ses vêtements son pactole. Elle emporte 5 000 dollars. Son époux, Baktiar, n’est pas là lui non plus : il travaille comme manœuvre dans le nord-est, près de la frontière turque.
Mon beau-père nous presse. Nous avons pris des provisions : du pain, des légumes et de l’eau. Beaucoup d’eau, car la journée s’annonce torride. Il emporte sa kalach, qu’il glisse sous le siège de la voiture, et range son revolver dans la boîte à gants. Le voir l’arme à la main, la tenir par la crosse, efface mes craintes. Je ferme les yeux, respire très fort et monte dans la vieille Opel Vectra de couleur marron. En claquant machinalement la porte arrière du véhicule, j’ai la tête qui tourne. Assis à côté de moi sur les genoux de sa mère, Rezan pleurniche. C’est une enfant-éponge : elle capte l’anxiété et s’en imprègne. « Tu es pénible. Tu vas te calmer, ce n’est vraiment pas le jour », râle sa mère.
Khero fait tourner le moteur, desserre le frein à main, puis se ravise : « Nom de Dieu, j’ai oublié les oiseaux ! Attendez-moi dans la voiture. J’en ai pour deux minutes. »
Il court jusqu’à la volière et ouvre la grille au milieu des pépiements et des bruissements d’ailes. Un oiseau bariolé quitte le perchoir pour pointer son bec de l’autre côté des barreaux, hésite, puis volette. Il va se poser sur une pierre. Il est bien le seul à tenter l’aventure. La bande des canaris ne daigne pas le suivre à l’extérieur de la cage. En tout cas, pas dans l’immédiat. Est-ce bien le moment de s’occuper d’eux ? « Débrouillez-vous, mes amis », murmure Khero.
Les voisins ont arrimé leurs valises sur le toit de leur voiture, mais ils ne sont pas prêts. Nous partons sans eux. La rue principale est en ébullition. La nouvelle du déclenchement de l’offensive de l’État islamique a fait le tour du village, situé au pied du massif des monts Sinjar. Les villageois détalent à pied, en voiture ou massés dans les bennes des camionnettes. La panique est générale. Les plus prévoyants sont déjà partis. Les étourdis accélèrent les derniers préparatifs.
Parmi les villageois les plus pressés de s’en aller, je reconnais Bachir et Rojko. Hier encore, ils étaient déterminés à se « défendre jusqu’au bout ». C’est du moins ce qu’ils claironnaient. Ils appartiennent à la brigade de vigiles. Ils ont pris les armes pour participer à des rondes nocturnes. Des coups de feu claquaient au moindre bruit suspect durant leurs tournées. Nous ne nous alarmions pas.
Dénués d’expérience, nos protecteurs tiraient au hasard, droit devant eux. Cela devait les rassurer. Et nous aussi par la même occasion. Les derniers jours, les commerçants gardaient le rideau de fer de leur boutique baissé tandis que les paysans n’allaient plus aux champs. L’activité était paralysée. Nous avions envisagé d’évacuer le village en catimini, mais le périple s’annonçait compliqué. Il fallait, pour se dégager de l’emprise de Daech, contourner les monts Sinjar et leurs sommets familiers. Notre route aurait ensuite dû faire un crochet par le Rojava, la partie syrienne du Kurdistan, avant de franchir la rivière Tigre et d’entrer au Kurdistan irakien plus au nord, à deux pas de la frontière turque. Pour qu’enfin nous trouvions refuge près de la ville de Zakho où nous avons des proches. Soit une boucle de plus de deux cents kilomètres. Les peshmerga, les soldats kurdes, nous ont dissuadés de tenter un tel voyage.
« Pourquoi voulez-vous partir ? Nous vous protégeons. Vous pouvez compter sur nous. Vous connaissez notre bravoure », lançait à la cantonade Kekan, le chef des peshmerga qui stationnaient dans le village et aux alentours. Ceux qui annonçaient qu’ils voulaient partir quand même étaient rembarrés.
« Vous n’irez pas loin. Les passages entre la Syrie et l’Irak sont fermés. La frontière est close. Vous ne pourrez pas faire le tour de la montagne. »
Nous faisions plutôt confiance aux peshmerga, ces « hommes qui n’ont pas peur de la mort » en langue kurde. Kekan avait de la bedaine. Il ne ressemblait guère à l’idée que je me faisais de Saladin, le conquérant d’origine kurde célébré par l’histoire arabo-musulmane. D’après Khero, le père de Walid, il avait la réputation de s’être bien battu contre Saddam, qui détestait les Kurdes et les yézidis, mais ses faits d’armes étaient déjà très anciens. Sa légende de combattant survivait pourtant, comme une évidence. Il était respecté. Il avait été de toutes les batailles voici vingt-cinq ans, lorsque le dictateur de Bagdad avait poussé la brutalité jusqu’à gazer à l’arme chimique les Kurdes de Halabja, près de la frontière iranienne. C’était un brave parmi les braves. Nous ne nous doutions pas qu’il allait prendre ses jambes à son cou dans la nuit du 3 août.
Kekan et sa petite troupe avaient quitté le village un peu avant le lever du jour. Il venait d’apprendre aux sentinelles yézidies qu’une attaque de Daech avait débuté à Sinjar, la grande agglomération de la région où vivaient 300 000 habitants. Il avait ordre de se replier. Kekan a abandonné son poste.
Son cas n’est pas isolé. Des villages chrétiens de la plaine de Ninive et la ville de Qaraqosh ont connu le même sort. Je l’apprendrais plus tard.
À dire vrai, la peur règne en maître absolu depuis des mois. Elle s’est propagée de la Syrie en Irak en mai, lorsque les insurgés sunnites ont annoncé qu’ils abolissaient les frontières pour ne reconnaître qu’un pays : la Mésopotamie. Pour nous, yézidis, l’État islamique en Irak et au Levant, c’est Daech, son nom islamique.
L’État islamique s’était emparé en juin, sans coup férir, de Mossoul, la deuxième ville d’Irak, forte de deux millions d’habitants. L’armée irakienne s’était débandée. Un scénario identique s’était joué, près de chez nous, à une vingtaine de kilomètres, à Tal Afar.