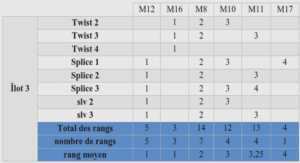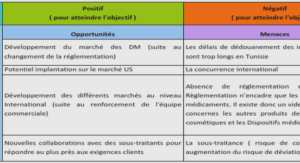VIOLENCES INSIDIEUSES
Longtemps considérées comme normales (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui), les violences « ordinaires », « familières » – « exercées à l’encontre des faibles : femmes, enfants, exclus du système social » (Héritier, 1996, p. 13) – sont des violences insidieuses, peu visibles et difficiles à déceler comme, par exemple, le « harcèlement psychologique et moral » ou la « violence psychologique ». Contraintes de toutes sortes, violation de l’intimité, non respect de la dignité humaine, force de la tradition, statut des femmes dans la société… Les violences cachées quoique présentes sont vécues de l’intérieur, imposées par quelque tradition, les valeurs sociales, la vie que nous menons, la volonté d’individus qui contrôlent ou gouvernent le monde avec la bénédiction de systèmes sociaux, la mondialisation. Ces violences sont subies, parfois à cause de la couleur de la peau ou de l’origine. Ce sont des agressions physiques, spirituelles, verbales ou morales (Boni, 2002, p. 105). Ajoutons à cette définition que la violence peut être « structurelle ». La « violence structurelle », est une « violence d’intensité constante, qui peut prendre différentes formes : racisme, sexisme, violence politique, pauvreté et autres inégalités sociales. Par la routine, le rituel ou les dures épreuves de la vie, cette violence structurelle pèse sur la capacité des personnes à faire des choix dans leurs vies » (Castro et Farmer, 2002, p. 98). Pour Johan Galtung (2004), la violence structurelle correspond à l’action d’une structure sociale ou d’une institution trop oppressive ou trop aliénante qui empêche les gens de satisfaire leurs besoins élémentaires : « a structure itself is violent by being too repressive, exploitative or alienating; too tight or too loose for the comfort of people » (POLYLOG, consulté le 28/11/2013). Ainsi, selon Yves Michaud, « […] La famine, la sous-nutrition, l’absence de soins s’inscrivent dans des situations de domination qui concernent tous les aspects de la vie sociale et politique. De fil en aiguille, état de violence devient synonyme de domination et d’oppression » (1986/2012, pp. 7-8), « domination économique, rapport capital/travail, et le grand partage Nord/Sud » (Héritier, 1996, p. 13), le fossé sans cesse grandissant entre les pauvres et les riches.
Ces violences sont plus ressenties dans les sphères privées – au sein des familles – dans la mesure où elles constituent le microcosme de la société. Les violences conjugales et domestiques qui traduisent le malaise de la société sont marquées par le sexisme/machisme des hommes, des agressions physiques, morales et sexuelles à l’encontre des femmes et la maltraitance des enfants (abus sexuels, maltraitance physique et morale). Les femmes et les enfants sont doublement victimes : d’une part, ils sont victimes de la situation délétère de leur société et pays et d’autre part, de la violence de leur conjoint ou père. Cette situation ressemble à la situation des afro-américaines lors de la ségrégation raciale aux États-Unis où elles sont à la fois victimes du racisme des Blancs, de la violence de leur mari et des conditions de vie exécrables. Cette époque est décrite par Gloria Naylor dans son roman The Women of Brewster Place (1981) dans lequel elle met en lumière les conditions déplorables de six femmes afro-américaines qui habitent dans un immeuble immonde appelé Brewster Place. De même, Maya Angelou, dans I Know Why the Caged Bird Sings (1969), décrit le racisme, la xénophobie et l’abus dont les femmes et les enfants font l’objet.
En somme, Ben Okri, dans Landscapes Within et Dangerous Love, raconte une histoire qui exalte la vie quotidienne : « I had wanted to write a novel which celebrated the small details of life as well as the great, the inner as well as the outer. I had wanted to be faithful to life as lived in the round, and yet to tell a worthwhile story » (p. 325). La famille, microcosme de la société, sert de cadre à l’auteur de The Famished Road (1991) pour peindre la violence socio- politique, le capharnaüm existentiel et le sexisme dont les femmes sont les plus souvent victimes. Loin d’accepter son sort en victime résignée, elle essaie de fuir la vie qu’on lui impose : « she ran away from home, but she was caught and brought back before she reached the village boundary. She made attempts at poisoning herself, but gave up each time at the last moment » (pp. 79-80). La tentative de suicide d’Ifeyiwa traduit à la fois son malaise et son impuissance devant la tournure que prennent les évènements. N’ayant aucune emprise sur sa vie, elle se demande s’il ne faudrait pas mieux s’en débarrasser. Recourir au suicide, à l’autodestruction comme la seule solution pour échapper à la tyrannie ou à l’oppression familiale et sociale est une violence inouïe.