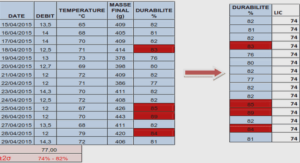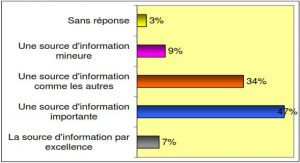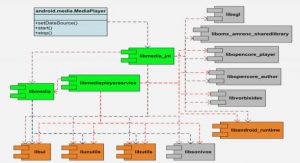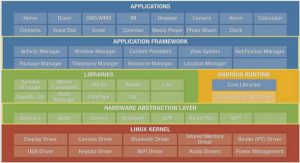Etat des connaissances sur la variabilité interannuelle en Atlantique tropical
Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer la variabilité observée en Atlantique tropical. Le premier est similaire au mode couplé équatorial responsable de l’ENSO dans le Pacifique (Carton and Huang, 1994). Il compose la partie équatoriale de la variabilité à l’échelle du bassin tropical et est relié aux changements interannuels de la pente de la thermocline, résultants des anomalies de vent zonal dans la partie Ouest du bassin (Zebiak, 1993). Cependant, l’amplitude et la durée des évènements correspondants sont plus faibles que dans le Pacifique (Wang et al, 2004). Le deuxième mécanisme est un mode tropical couplé, qui met eneuj les flux de chaleur air-mer, et est associé aux variations interannuelles du gradient ranséquatorial de SST à l’échelle du bassin, et aux variations de la migration méridienne de l’ITCZ (Xie and Carton, 2004). Enfin, la variabilité interannuelle dans l’océan Atlantique tropical peut aussi trouver son origine dans l’océan Pacifique ou dans l’Atlantique Nord via des téléconnexions atmosphériques (Wang et al, 2004).
Le premier système de variabilité climatique évoqué–le mode équatorial- se manifeste tous les deux à quatre ans en moyenne. Il se caractérise par un épisode chaud ou froid (Illig et al, 2006). Pendant un épisode chaud, on observe une relaxation des alizés dans la partie Ouest du bassin équatorial. Conformément à la théorie linéaire de propagation des ondes équatoriales (Cane and Sarachik, 1976, 1977, 1979, 1981 ; Philander, 1978), une telle perturbation des vents zonaux peut provoquer la propagation vers l’Est, le long de l’équateur, d’un train d’ondes de Kelvin, situées entre la surface et 100 mètres de profondeur environ (Illig et al, 2004). Ces ondes de downwelling vont approfondir la thermocline au cours de leur propagation et donc stopper les remontées d’eaux froides. De ce fait, des anomalies de température des eaux de surface dans le GG peuvent apparaître, comme ce fut le cas durant l’été boréal de 1996 (Illig et al, 2006). Lors d’un évènement froid, le phénomène s’inverse.La signature de ce mode de variabilité en SST est principalement visible dans l’Est du bassin équatorial et les anomalies sont maximales dans la région de la langue d’eau froide. Ce mode de variabilité entraîne des variations de la température de subsurface dans l’Est du bassin de l’ordre de 1°C en moyenne mensuelle, atteignant parfois 3-4°C dans le fond du GG, comme ce fut par exemple le cas en 1984 (Hisard et al, 1986).
Le deuxième mode de variabilité de l’Atlantique tropical est le mode inter-hémisphérique. L’analyse des structures spatiales des anomalies interannuelles de SST a montré que les sécheresses étaient associées à desdéplacements inhabituels en latitude de l’ITCZ (Ruiz-Barradas et al, 2000). Lorsque l’IT CZ se déplace anormalement vers le Nord, la température des eaux de surface augmente vers le Nord, tandis qu’elle diminue au Sud créant une anomalie de gradient trans-équatorial de SST. Ce gradient en phase positive déclenche une période de sécheresse danse lNordeste et de fortes pluies au Sahel. Une situation contraire apparaît quand l’ITC Z se déplace anormalement au-delà de sa position extrême Sud : la température des eaux de surface diminue alors au Nord et augmente au Sud, favorisant souvent d’importantes précipitations sur le Nordeste et la sécheresse au Sahel. Ce mode de variabilité estcependant mal compris et très controversé, en particulier sur la nature dipolairede sa structure spatiale (Houghton and Tourre, 1992 ; Mehta, 1998 ; Rajagopalan et al, 1998 ; Enfield et al, 1999 ; Servain et al, 1999 ; Dommenget and Latif, 2000).
La variabilité des vents et de la température de surface de la mer en Atlantique tropical est également affectée par d’autres systèmes climatiques, comme ceux du Pacifique tropical (Enfield and Mayer, 1997 ; Sutton et al, 2000 ; Nobre et al, 2003) ou des latitudes moyennes (Hasternrath et al, 1987 ; Nobre and Shukla, 1996). La circulation atmosphérique se compose de cellules de circulation zonales (cellule de Walker) et méridiennes (cellules de Hadley), ces dernières mettant en relation la variabilité de l’Atlantique tropical avec celle des latitudes plus élevées. Les perturbations atmosphériques rapides se propagent préférentiellement d’Ouest en Est et favorisent les téléconnexions entre les bassins Pacifique et Atlantique. Par ailleurs, on observe une influence de la variabilité d’ENSO sur les précipitations de certaines régions d’Amérique du sud (Diaz et al, 1998) et surl’activité cyclonique de l’Atlantique nord (Gray and Landsea, 1992). Cette influence peut s’opérer selon ce schéma : les anomalies de SST du Pacifique tropical entraînent une modification de la cellule de Walker. Un évènement El Niño crée un décalage versl’Ouest de la zone de convection habituellement centrée sur l’Amazonie, et de la convergence des vents d’Est et d’Ouest du continent (Wyrtki, 1982). Les alizés Atlantique sont alors renforcés et activent la cellule atmosphérique de l’Atlantique. Dans l’annéequi suit un évènement El Niño important, l’Atlantique tropical Nord est généralement caractérisé par une SST anormalement élevée, tandis que l’Atlantique tropical sud est parfois dans une situation opposée (Enfield and Mayer, 1997).
La réponse de l’Atlantique tropical à la variabilité du Pacifique tropical associée à l’ENSO a été mise en évidence par le calcul de corrélations entre les anomalies de SST des deux bassins (Lanzante, 1996 ; Enfield and Mayer, 1997). Les interactions air-mer jouent un rôle important dans la réponse de l’Atlantique à la variabilité du Pacifique associé à l’ENSO. Contrairement à l’influence impor tante qu’exerce l’ENSO sur le gradient méridien de SST, la corrélation entre lesévènements interannuels Atlantique et l’ENSO n’est généralement pas significative (Zebiak, 1993 ; Enfield and Mayer, 1997). En outre, Nobre et al (2003) montrent que les perturbations en Atlantique tropical, générées par la variabilité du Pacifique, sont capables d’entretenir la variabilité équatoriale, avec une amplitude en accord avec les observations. Cependant, d’après la théorie linéaire des ondes longues équatoriales, intensificationl’ des alizés de Sud-est de mars à juin le long de l’équateur, consécutive à un évènement El Niño, aurait tendance à augmenter l’upwelling équatorial, induisant une élévation de la thermocline équatoriale dans l’Est du bassin et provoquant un évènement froid en Atlantique équatorial.
Les influences des régions extratropicales et en particulier de l’Oscillation Nord Atlantique (NAO) sont plus complexes car elles peuvent s’établir aussi bien par le biais d’un pont atmosphérique qu’à travers des connexions océaniques. Par exemple, Xie and Tanimoto (1998) proposent que le gradient trans-hémisphérique de SST pourrait être excité par la NAO. Une analyse statistique fondée urs un index caractéristique du gradient (différence de la SST moyenne entre 10-20°N et entre 5-15°S) révèle une structure spatiale qui s’étend du Sud de l’Atlantique jusqu’au Groenland, suggérant donc une interaction entre la NAO et le gradient trans-hémisphérique de SST. En effet, le centre d’action subtropical (~40°N) entraîne des modifications de l’amplitude des alizés de Nord-Est et affecte ainsi la température de l’Atlantique Nord (Xie and Tanimoto, 1998 ; Chang et al, 2000 ; Czaja et al, 2002). Or, on a vu que ces anomalies modifiaient la position de l’ITCZ, et donc du gradient trans-hémisphérique de SST. Les latitudes moyennes influencent aussi la variabilitéde l’Atlantique équatorial à travers la circulation océanique (Schott et al, 2004), via lescellules de circulation subtropicales. Cette circulation méridienne transporte l’eau subductée au niveau des gyres dans les zones d’upwelling équatorial pendant l’hiver. La variabilité de ces cellules tropicales est elle-même influencée par le taux de subduction deslatitudes subtropicales (Lazar et al, 2001, 2002). Des modifications dans la formation d’eaux profondes aux hautes latitudes de l’Atlantique Nord peuvent en outre créer des changements du transport transéquatorial de SST, engendrant la formation d’un dipôle de SST (Yang, 1999).
Réciproquement, certaines études récentes suggèrentque la variabilité en Atlantique tropical peut aussi perturber la variabilité de l’Atlantique Nord (Rajagopalan et al, 1998 ; Roberston et al, 2000 ; Tourre et al, 1999 ; Okumura et al, 2001), à travers le dipôle de SST tropical qui force une téléconnection barotrope atmosphérique jusque dans les extratropiques.
Dans le GG, le premier évènement interannuel en SSTbien documenté fut celui de 1963 car il a coïncidé avec le programme d’observations EQUALANT (Merle et al, 1979). Durant l’été boréal 1963, les anomalies de ST ont excédé 1.5°C dans le GG. En raison de la synchronisation d’anomalies thermiques chaudes dans l’est du bassin, de la relaxation des alizés et du déplacement vers le Sudde la zone de convection, Hisard (1980) a baptisé de phénomène de Niño Atlantique.esL analyses de Servain et al (1982) ont permis de mettre en évidence les connexions entre le forçage atmosphérique dans l’Ouest du bassin et le réchauffement observé dansle GG. L’évènement de 1984 s’est produit lors d’un autre programme d’observations : SEQUAL/FOCAL (Weisberg, 1984), juste après l’intense évènement El Niño de 9821-1983. Les observations de subsurface ont révélé un approfondissement de la ermoclineth équatoriale dans l’Est du bassin (Philander, 1986) qui résultait d’un déplacement vers l’Est d’anomalies chaudes le long du guide d’ondes équatorial (Carton and Huang, 1994). Delecluse et al (1994) ont ensuite montré qu’il pouvait exister un lien entre cet évènement interannuel en Atlantique équatorial et l’évènement El Niño danse l Pacifique. Handoh and Bigg (2000) ont analysé l’évènement de 1996 à partir de données océaniques et atmosphériques issues d’observations satellites et ont suggéré un scénario reposant sur les propagations/réflexions d’ondes équatoriales, cénarios ensuite évalué à l’aide d’un modèle numérique par Illig et al (2006). Enfin, Vauclair et du Penhoat (2001) ont construit une base de données pour étudier trois évènements ou suite d’évènements équatoriaux particulièrement importants dans l’Atlantique : en 1983 et 1984, en 1994 et 1995 et en 1997 et 1998. Ils mettent en évidence lefait que ces évènements sont tous différents et ne répondent pas tous à la théorie classique de propagation d’ondes qui explique le mode équatorial de variabilité interannuelle.
Ainsi, la variabilité interannuelle de surface dans l’océan Atlantique équatorial résulte d’interactions complexes entre la dynamique océanique équatoriale et les flux de chaleur air-mer (Carton et al, 1996). Puisque la SST est un paramètre clé pour les interactions océan-atmosphère, il est crucial de comprendre les processus de couche de mélange qui contrôlent la SST à l’échelle interannuelle, en particulier dans la zone de la langue d’eau froide. En outre, on peut se demander si l’équilibre du bilan de chaleur déterminé pour le cycle saisonnier est le même à échellel’ interannuelle.
Article
Résumé de l’article
Une simulation numérique réaliste est utilisée pourexaminer les différents processus qui contrôlent la SST à l’échelle interan nuelle dans l’océan Atlantique équatorial Est. Les anomalies interannuelles sont calculées à partir d’un bilan de chaleur dans la couche de mélange. Le modèle simule les années 1992 à 2000, mais nous nous sommes focalisés sur les années 1996 à 1998 car cestrois années présentent de fortes anomalies interannuelles de SST et les processus mis en jeu sont représentatifs de ceux qui agissent sur toute la période 1992-2000. De plus, nous avons adopté une approche par boîte : nous avons considéré les anomalies interannuelles moyennes entre 15°W et 5°W et entre 2°S et 0°N.
Il est démontré à travers l’étude du bilan de chaleur de la couche de mélange que les processus verticaux unidimensionnels, c’est-à-d ire les flux de chaleur air-mer et les processus océaniques de subsurface, prédominent pour créer les évènements interannuels chaud et froid pendant la période 1996-1998. Néanmoins, deux mécanismes différents sont identifiés : le premiermet en jeu la réponse des termes de subsurface à la propagation vers l’est des ondes équatoriales, forcées dynamiquement à distance par les anomalies de tension de vent zonale dans la partie Ouest du bassin. Ce mode de variabilité interannuel correspond au mode équatorial identifié dans d’autres études, par exemple celle de Illig et al (2006). Il est similaire au mode ENSO du Pacifique équatorial. Le second mécanisme est purement thermodynamique et résulte des anomalies interannuelles des flux de chaleur air-mer locaux, dominées par celles de flux de chaleur latente. Malgré la difficulté d’isoler un processus purement local, la comparaison avec un flux de chaleur latente observénous permet de conclure sur le rôle actif des anomalies de vent local sur le flux de chaleur latente et donc sur la SST en 1998.
Enfin, contrairement à ce qui se passe à l’échelle de temps saisonnière, les advections horizontales de température par les courants basse fréquence jouent un rôle important pour la variabilité interannuelle de la SST. Ce rôle est totalement différent selon la composante zonale ou méridienne considérée.Tandis que l’advection zonale exerce une rétroaction négative sur les anomalies ed SST, l’advection méridienne peut être à l’origine d’anomalies interannuelles de SST, en lien avec les anomalies de vent local.