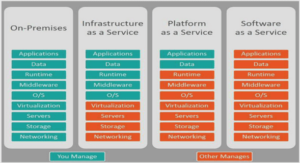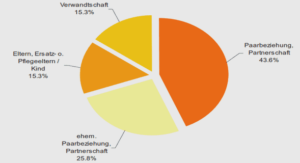Débat avec la salle
UTILISATION ADMINISTREE ET MECANISMES DE MARCHE
Quid du conditionnement ? Le médecin vous prescrit un traitement antibiotique pour neuf jours, la boîte est conçue pour six jours, on achète deux boîtes, on jette une demi boîte. Dans d’autres pays, le pharmacien, avec ses ciseaux, compte le nombre de pilules qu’il vous faut, vous les met dans un petit sachet et vous partez avec… Noël Renaudin : Le conditionnement fixe est un bon choix parce qu’il garantit la notice et parce qu’en réalité on n’achète pas des comprimés, mais des traitements. Hormis quelques produits dont le coût de fabrication est très élevé, dans la plupart des cas, le comprimé ne vaut rien !
On met dans les différents modèles de boîtes ce qui correspond le mieux à l’utilisation la meilleure et la plus courante du médicament. Les conditionnements correspondent à la très grande majorité des bonnes prescriptions.
Comment mettre en phase le système de production, qui répond aux lois du marché, et celui de l’utilisation, qui, en France, est administré ?
Noël Renaudin : Il ne s’agit pas de faire coexister un système collectiviste public à la française et un système libéral à l’américaine. En revanche, tous les systèmes, sous des formes diverses, deviendront de plus en plus universalistes, de plus en plus mutualisés, sur le modèle, à mon avis, du système français.
Ce qu’on constate, en regardant l’exemple américain, c’est qu’il est parti d’une technique assurancielle pure avec un système de recueil à l’hôpital pour les pauvres, les chômeurs ou les vieux, et qu’il fonctionne dans des conditions de plus en plus tendues. Pendant ce temps-là, les besoins augmentent, au point qu’une présidence comme celle de Georges Bush est contrainte d’annoncer des dépenses considérables, qui seront purement collectives ! Le problème n’est pas seulement traité au niveau fédéral. Certains Etats américains s’aperçoivent qu’ils ne peuvent pas laisser de côté toute une partie de la population qui n’accède pas au système assuranciel, et ils pratiquent le contrôle des prix plus que partout ailleurs dans le monde.
Jacques Biot : J’ai vu partir, hélas, avec ma casquette d’ancien haut fonctionnaire, le siège européen de Biogen ; on voit émigrer aujourd’hui celui de Gilead… Quelle est l’image de la France dans les multinationales ?
Marc de Garidel : Le système de soins, dans l’ensemble, est reconnu comme l’un des meilleurs du monde. Mais les gouvernements, de droite ou de gauche, ont une tendance chronique à imposer des mesures qui diminuent la visibilité de l’entrepreneur. Et celui-ci, quand la puissance publique le sollicite au-delà d’un effort qu’il considère comme normal, peut être tenté d’aller regarder ailleurs. Vient ensuite la question des 35 heures… Ce n’est pas un problème d’organisation, c’est un problème de fond : en France, le travail n’est pas une notion reconnue. On préfère y travailler moins pour vivre mieux. Et même si le taux de grèves est très faible par rapport à d’autres pays, nous avons tous été confrontés récemment à des grèves qui détériorent l’atmosphère.
Le couple médecin-malade utilise le médicament sans le payer ou en ayant l’impression de ne pas le payer. N’est-ce pas la principale raison du « gaspillage » ? Noël Renaudin : Ce qui est recherché, c’est ce qu’on appelle le « bon usage » du médicament qui est un peu la pierre philosophale du système de santé. On y parvient par la rationalisation du parcours de soins, la formation médicale, l’amélioration de l’information sur le médicament (par l’intermédiaire, nous nous y employons, de la visite médicale sur le lieu de travail), les contrats que nous passons avec l’industrie pharmaceutique. Cette méthode fonctionne pour les médicaments courants (le sirop contre la toux), mais le vrai problème, c’est que la dépense se déplace vers des médicaments très chers (anti-cancéreux, traitements de la sclérose en plaques ou de la polyarthrite rhumatoïde) pour lesquels les moyens que je viens de vous citer deviennent dérisoires.
Jean-François Bergmann : Je crois beaucoup en l’automédication. Toute une série de pathologies peuvent être prises en charge par le malade lui-même sans consulter son médecin, sans ordonnance pour acheter gratuitement ses médicaments. Mais dans notre société c’est très difficile. Ni les médecins ni, paradoxalement, les pharmaciens, ni les industriels, ni les pouvoirs publics, ni les malades ne veulent vraiment de l’automédication.
INDUSTRIE FRANÇAISE ET COMPETITION MONDIALE
Je suis fabricant de produits de contraste pour scanner et IRM. Pendant cinquante ans, mon principal concurrent, qui n’est pas français, a vendu ses produits au moins 30 % plus cher que je ne pouvais le faire, puisque lui n’était pas limité par une administration.
Jean-François Bergmann : Grâce au dépistage, aux diagnostics précoces, à l’amélioration technologique, on a fait d’énormes progrès. Mais les appareils et les produits de contraste sont tellement performants qu’ils parviennent à découvrir des non-maladies ! Le vrai problème aujourd’hui des tests-diagnostics, autant biologiques que radiologiques, c’est qu’on découvre des anomalies qui n’ont rien d’anormal mais qui justifient en général de faire un deuxième, voire un troisième examen ! Savez-vous qu’on diagnostique chez 40 % des femmes un cancer du sein qui finalement n’existe pas ? 40 % des femmes ! On leur dit : « Oh la, la ! Il y a un truc bizarre à l’écho ou à la mammo, il faut vous faire une cytoponction. » Elles vont prendre des benzodiazépines, des anxiolytiques, des antidépresseurs, pour s’apercevoir qu’il s’agit d’une fausse piste.
Quant au plafonnement de vos prix, il vous a permis d’obtenir 80 % des marchés hospitaliers parce que vous étiez concurrentiel ! A l’époque, votre concurrent prétendait que nous vous favorisions parce que vous étiez français !
Quelle peut être la tâche du Comité économique des produits de santé, s’il existe des prix mondiaux ?
Noël Renaudin : Les prix des produits les plus innovants sont inévitablement mondiaux parce que c’est une question de rapports de force. Nous ne pouvons guère demander plus qu’un rabais de deux ou trois pour cent parce que nous sommes gros clients. Il en est ainsi depuis que le marché est ouvert.
Mais il n’y a pas que des innovations… Sur tout le reste, le système d’administration des prix reprend ses droits pleins et entiers. Notamment lorsqu’arrivent des produits dont notre système d’évaluation considère qu’ils n’apportent rien ou très peu de choses. Nous demandons alors aux entreprises, si elles veulent bénéficier du marché français, de nous apporter une réelle économie. C’est à elles de décider si le jeu en vaut la chandelle, au prix que nous exigeons d’elles. C’est pourquoi il arrive que certains produits, qu’on trouve en Allemagne, en Angleterre ou en Italie ne soient pas présents sur le marché français.
Il y a donc de l’administration pour tout ce qui n’est pas innovation irremplaçable, pour tout ce qui ne correspond pas à une espèce de monopole provisoire.
Ne faudrait-il pas allonger la durée de vie des brevets ?
Noël Renaudin : La durée actuelle des brevets constitue un bon point d’équilibre pour la rémunération de l’innovateur. Je crois que très peu d’entreprises pourront survivre si elles n’ont pas les deux métiers de « génériqueur » et d’innovateur.
C’est la diversification du tissu d’entreprises qui assurera la transition. Une entreprise comme AMGEN est entièrement vouée à l’innovation. Le système peut nourrir
quelques entreprises de biotechnologie qui fabriquent de bons produits, très chers, mais pas plus.
Un deuxième modèle est en train de se développer, générique pur sucre au départ, mais qui investit sur la recherche. Les grands génériqueurs indiens et israéliens gagnent aussi de l’argent. Leur rentabilité par rapport au chiffre d’affaires est évidemment plus faible, mais ils vendent des quantités astronomiques de médicaments et génèrent un très gros chiffre d’affaires, avec des capacités de financement pour la recherche.
Une industrie nationale du médicament est-elle indispensable pour la gestion des mécanismes financiers et de la santé publique ?
Noël Renaudin : L’industrie du médicament est une industrie rentable ; il serait donc dommage de s’en priver, au niveau national ou européen. Du point de vue budgétaire, en revanche, cela n’a aucune incidence. Que le médicament vienne d’Amérique, du Japon, ou soit fabriqué en France ne change rien puisque que les marchés sont désormais ouverts. Du point de vue de la santé publique, la réponse est plus compliquée. Il ne fait de doute pour personne qu’une industrie des vaccins ou des anti-infectieux localisée sur le territoire constitue un avantage stratégique en cas de pénurie. Mais d’une manière générale, on est obligé de vivre avec la seule hypothèse raisonnable selon laquelle les gens qui fabriquent un médicament ont envie de le vendre, sont capables de le produire, et qu’à partir du moment où l’on accepte de le payer, on ne l’achètera pas plus cher que s’il était produit chez nous. Marc de Garidel : La recherche de base doit être publique, et c’est à chaque pays de s’en occuper. Développons, faisons des recherches dans les sciences de la vie parce qu’elle vont générer d’immenses progrès, puis laissons au privé le soin d’utiliser ces développements scientifiques, sans distinctions de pays, laissons jouer alors la concurrence pour que le patient en bénéficie le plus rapidement possible. DES AUTORISATIONS TROP
GENEREUSES OU TROP SEVERES
Comment faire la part entre les améliorations réelles et celles qu’on pourrait qualifier de cosmétiques sur des médicaments existants ?
Jean-François Bergmann : A partir de quel niveau peut -on considérer que l’intérêt pour la santé publique est majeur ? Je ne le sais pas. Et la société ne le sait pas plus. On ne le saura que cinq ou dix ans après la sortie d’un médicament.
En revanche, on a un véritable problème dans le domaine de l’antibiothérapie, qui m’inquiète. Ce n’est pas un bon créneau commercial parce que les traitements sont brefs et les maladies infectieuses, somme toute, peu nombreuses. D’autre part, on a de bons antibiotiques, les meilleurs datant en général de vingt ou trente ans. Les industriels ont donc freiné le développement de nouveaux antibiotiques. Mais la bactérie, elle, n’arrête pas son développement de résistances. Elle n’a pas d’actionnaires à satisfaire, de fonds de pension à gérer. Je suis donc très inquiet. Si nous cessons de nous battre contre les résistances, les bactéries peuvent gagner. Aujourd’hui, les dossiers des antibiotiques ne sont pas très bons en AMM. C’est évidemment un problème. Mais on ne peut pas dire non. Si l’on décourage les rares industriels assez masochistes pour chercher à se développer dans le monde de l’antibiotique, on court un très gros risque de perdre la bataille contre les bactéries. Noël Renaudin : La Commission de la transparence peut décerner une très bonne note à un médicament qui n’aurait mérité qu’une bonne note, ou une note un peu trop basse à un médicament qui aurait mérité une note moyenne. L’amélioration apportée n’en aura pas moins été identifiée. D’autre part, la discrimination entre améliorations mineures et améliorations à gros potentiel est presque toujours correctement réalisée.
Existe-t-il un médicament que le consensus médical considère aujourd’hui comme une innovation et que la Commission de la transparence n’ait pas dépisté ? La réponse est non. Existe-t -il un médicament qu’on considère aujourd’hui sans intérêt et que la Commission de la transparence ait honoré d’une AMSR (amélioration du service médical rendu) ? Le réponse est encore non.
Les médicaments déjà anciens peuvent-ils être soumis à une réévaluation ? Qu’en est-il de l’homéopathie, dont l’efficacité est pour le moins discutable ?
Noël Renaudin : Les médicaments anciens sont réévalués selon les mêmes critères que les nouveaux médicaments. Ce qui nous conduit parfois à déclarer que ce qui était bon hier ne l’est plus aujourd’hui, ou pour le dire autrement que le rapport bénéfice/risque n’est plus considéré comme satisfaisant. Un médicament peut ainsi cesser d’être remboursé. C’est un processus difficile parce qu’il implique la conscience collective des médecins, des malades et des entreprises. Jean-François Bergmann : Les médicaments d’homéopathie obtiennent l’AMM, passent devant la Commission d’AMM et sont remboursés sans passer devant la Commission de la transparence. C’est un choix politique. Il a été renouvelé par l’actuel ministre de la Santé. Ces médicaments n’ont jamais été évalués. Ils vivent sur leur symbolique, sur la qualité de l’homéopathe, mais pas sur la capacité de la granule ! Je regrette ce traitement de faveur, parce que j’y perds ma crédibilité de simple médecin enseignant dans un hôpital. Si on ne les retire pas du marché (ils n’ont tué personne), au moins pourrait-on les dérembourser.
Ne devrait-on pas assouplir les critères d’obtention de l’AMM ?
Marc de Garidel : Les essais cliniques coûtent certes très cher. Pour une nouvelle molécule ce coût de développement est de l’ordre de 150 à 200 millions d’euros. Mais ce qui coûte le plus cher, ce sont les échecs. Le coût de développement d’une molécule, si vous tenez compte des échecs, atteint aujourd’hui près d’un milliard d’euros. Le problème fondamental de notre industrie est d’obtenir une productivité suffisante pour augmenter le taux de réussite. C’est ce qui permet de passer de 1 milliard à 150 millions d’euros.
Cela dit, il y a dix ans, on n’avait peut- être besoin que de 20 ou 30 millions d’euros pour un développement qui nécessite aujourd’hui 150 millions. Cette explosion des budgets est imputable aux autorités de santé qui appliquent de plus en plus drastiquement le principe de précaution.
Jean-François Bergmann : L’AMM est un moindre coût. Que d’erreurs, de médicaments inutiles ou peu efficaces sont évités grâce à elle ! L’outil d’évaluation, l’essai thérapeutique, est un très bon outil. C’est l’ultime élément de garantie de l’efficacité. L’argent investi dans l’AMM est donc très bien utilisé.
Il vaut mieux refuser l’AMM à un bon médicament que de l’accorder à un mauvais. Si on se trompe, on perd du temps, mais l’industriel voudra prouver la qualité de son produit et l’autorisation finira par lui être accordée. En revanche, la mise sur le marché d’un mauvais médicament serait une catastrophe. Nos exigences sont légitimes.
Noël Renaudin : Il n’existe pratiquement pas de médicaments auxquels les entreprises renoncent parce que l’AMM serait difficile. D’autre part, nous pouvons aussi accorder l’ATU (autorisation temporaire d’utilisation) qui permet, avant l’AMM, de mettre un médicament à disposition des malades hospitalisés, parce que son potentiel justifie que dans des situations de péril pour les malades on coure le risque – accepté et même voulu par les patients – de sa toxicité.
UN EQUILIBRE EXTREMEMENT DELICAT
On l’aura compris, le médicament est soumis à des exigences de santé publique mais aussi à des contraintes budgétaires et à des intérêts industriels. Pour régler la position de ce produit particulier, dans un équilibre extrêmement délicat, au sein de ce « triangle magique », il faut un certain talent.
Une question reste ouverte : celle du pilotage d’une recherche industrielle qui a pour vocation de satisfaire des besoins collectifs à l’horizon d’une petite dizaine d’années. C’est le grand paradoxe, le grand mystère de l’industrie pharmaceutique : tout en assurant à ses actionnaires une rémunération immédiate élevée, elle doit impérativement nourrir une réflexion stratégique sur les besoins à terme de la collectivité (Jacques Biot).
Notes
(*) Marc de Garidel est le directeur général en France d’AMGEN, entreprise phare des biotechnologies, qui n’a peut-être pas débuté dans un garage mais dans une salle de laboratoire et qui est aujourd’hui de taille mondiale.
(**) Jean-François Bergmann est professeur de médecine interne, premier vice-président de la commission d’AMM, qui accorde aux médicaments le droit d’être mis sur le marché et mesure pour chacun d’eux le rapport bénéfice/risque.
(***) Noël Renaudin est président du Comité économique des produits de santé. En France, c’est l’Etat, par l’intermédiaire de cet organe, qui fixe le prix des médicaments.
Légende photo
Le médicament est soumis à des exigences de santé publique mais aussi à des contraintes budgétaires et à des intérêts industriels. Pour régler la position de ce produit particulier, dans un équilibre extrêmement délicat, au sein de ce « triangle magique », il faut un certain talent.