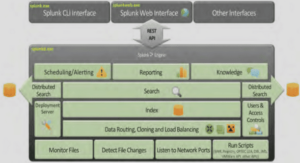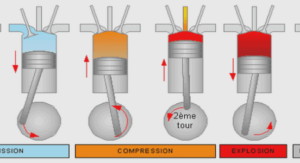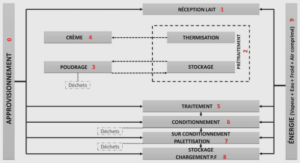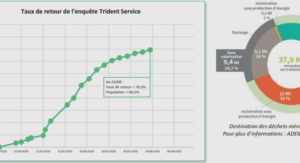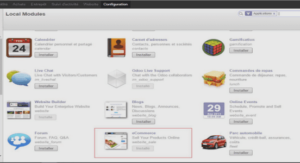Politique familiale en Union soviétique
Rabjaïeva (2004) et Noskova (2013) établissent trois phases de la politique familiale en Union soviétique : le modèle « post-révolutionnaire » qui apporte une vision progressiste de la famille, le modèle « stalinien » marqué par un retour à une vision pré-révolutionnaire de la famille, et le modèle « social-soviétique » qui promeut l’égalité entre hommes et femmes.
À partir de 1917, l’État cherche à former une famille nouvelle, porteuse des valeurs du communisme, se distinguant de celle présente sous le régime impérial, où l’homme est responsable des revenus et la femme du foyer. Aleksandra Kollontaï, femme politique, idéologue communiste et militante, promeut ce nouveau modèle familial en termes suivants (50) « Une famille traditionnelle ne sera plus nécessaire. L’État n’en a plus besoin parce que la gestion du ménage ne profite plus à l’État, il distrait les travailleurs de leur travail productif sans nécessité. Les membres de la famille n’en ont pas besoin parce que la société assume l’une de ses tâches : élever des enfants. À la place de l’ancienne famille, une nouvelle forme de communication entre un homme et une femme va se développer : une union camarade et cordiale de membres libres et autonomes, égaux dans la société communiste ».
« Традиционная семья перестанет быть нужной. Она не нужна государству потому что домашнее хозяйство уже не выгодно государству, оно без нужды отвлекает работников от производительного труда. Она не нужна самим членам семьи потому что другую задачу семьи – воспитание детей берет на себя общество. На месте прежней семьи вырастет новая форма обшения между мужчиной и женщиной – товарещиский и сердечный союз двух свободных и самостоятельно-зарабатывающих, равноправных членов коммунистического общества ».
Le gouvernement privilégie dans sa politique familiale un modèle formé à partir de deux conjoints qui travaillent. Pour cela, l’État prend en charge l’éducation des enfants par le développement d’infrastructures préscolaire et extrascolaire (jardins d’enfants, cercles et centres aérés, maisons de culture pour les enfants, etc.) et met en place des institutions soutenant la conciliation de la vie professionnelle et de la maternité (la mise en place d’un département de la santé maternelle et infantile en 1917, la création d’un comité de protection de la maternité en 1918, et l’introduction d’un comité de protection de l’enfance en 1919) (Lebina et al. 2007, p.30)29.
L’égalité entre les sexes est au centre de ce modèle familial : les hommes et les femmes reçoivent les mêmes droits (Décret n°160, 1917), l’État légalise l’avortement (Postanovlenie n°471, 1920)30 et le divorce (Décret sur la dissolution du mariage 1917)31, supprime la distinction entre enfants légitimes et illégitimes, ce qui aboutit de fait à la reconnaissance des unions libres (Lebina et al. 2007, p.33 citant le « Code familial », 1926). Ainsi, selon Yvert-Jalu (1981, p.45) « le nouveau régime socialiste propose d’assurer à la femme une véritable et complète émancipation, d’une part en lui garantissant une égalité juridique avec l’homme, d’autre part, en transformant l’économie domestique privée en industrie sociale, et en faisant de l’éducation une affaire publique » (51).
L’évolution de la politique familiale : d’une politique sociale à une politique traditionaliste
« Paysanne, soit prête à passer de l’ancienne « Ce que la révolution d’Octobre a donné à à la nouvelle vie »l’ouvrière et à la paysanne (bibliothèque, conseil des députés des travailleurs paysans, maison de la mère et de l’enfant, jardin d’enfantsPolitique nataliste restrictive (ex. : interdiction de l’avortement en 1935, augmentation des sanctions pénales en cas de non-paiement de la pension alimentaire) , école pour adultes, club des travailleurs) »
Par ailleurs, le nouveau gouvernement cherche à se libérer complètement de l’influence de l’Église. L’institution du mariage devient laïque : le nouveau « Code familiale », élaboré en 1918, proclame le principe de l’absolue séparation de l’Église et de l’État (« Code familiale », art. 52) et ne reconnaît plus le mariage religieux qui doit être désormais enregistré dans des actes d’état civil (ZAGS) (Büttner 2005, p.43).
Dans les années 1926-1953, l’État remet au centre de sa politique familiale un modèle de la famille fondé sur un couple marié avec des enfants (Chouïkina 2002, p.113). Ce tournant dans la politique familiale s’accompagne par une crainte de la dépopulation (Blum 1994, p.72) et se traduit par l’interdiction de l’avortement et de l’homosexualité en 1936 (Décret n°65, 1936) et le durcissement de la procédure de divorce en 1944 (52). Seul un mariage enregistré à l’État civil et indiqué dans le passeport est juridiquement valide et donne : 1) aux époux le droit d’hériter des biens du conjoint, et 2) aux hommes le droit d’établir leur paternité (Chpakovskaïa 2012, p.315).
(52) « Le tribunal peut dissoudre le mariage uniquement dans le cas où la demande est provoquée par des motifs sérieux et justifiés et où le maintien du mariage serait susceptible de porter atteinte aux principes de la morale communiste et ne saurait assurer des conditions pour la vie commune et pour l’éducation des enfants […]. Les jugements doivent contribuer à la juste compréhension du sens et de l’importance de la famille et du mariage dans l’État soviétique et éduquer la population dans le respect envers la famille et le mariage basés sur les principes élevés de la morale communiste que protège la loi soviétique ».
Selon Noskova (2013, p.156), cette transformation de la politique familiale n’est pas uniquement en lien avec des changements politiques, mais est surtout due aux problèmes démographiques après les pertes humaines de la seconde guerre mondiale. Pour compenser ces pertes, l’État incite les familles à s’agrandir et valorise les mères ayant au moins cinq enfants par la remise de décorations officielles32 (ex. : médaille « Gloire maternelle », Ordre « Mère-héroïque », entre autres) (voir Malinkine 2004). Cette valorisation des familles nombreuses se traduit par l’apparition de mesures qui ont pour effet de réduire les inégalités entre les familles ayant plus ou moins d’enfants. Parmi ces mesures, l’État introduit de nouvelles allocations à partir 1948 (Arrêté n°41, 1947) : 1) une prime de naissance de 200 roubles à partir du troisième enfant, 2) une prime de naissance de 650 roubles et une allocation mensuelle de 40 roubles à partir du quatrième enfant, 3) une prime de naissance de 850 roubles et une allocation mensuelle de 60 roubles à partir du cinquième enfant. Par ailleurs, un impôt pour les célibataires, concubins et mariés sans enfant est mis en place en 1941. En 1944, la liste des personnes devant payer cet impôt est élargie aux familles ayant moins de trois enfants. L’impôt représente 6% du salaire pour les individus sans enfants, 1 % pour les parents d’un enfant unique, et 0,5 % pour les parents de deux enfants (Grigoreva et al. 2014, p.25).
La dernière période est restée dans les esprits par sa politique familiale des années 1980 lorsque l’État introduit de nouvelles mesures qui sont propres au modèle social-démocrate (Rabjaïeva, 2004, p.94, Gourko 2008, p.205) : 1) le développement du congé parental (le congé parental rémunéré passe de 56 jours en 1955 à 70 jours en 1980, un congé parental partiellement rémunéré devient possible jusqu’aux 1,5 ans de l’enfant, et un congé parental non rémunéré mais permettant de conserver ses fonctions jusqu’aux 3 ans de l’enfant est mis en place), et 2) la mise en place d’allocations accordées à chaque naissance (50 roubles pour le premier enfant, 100 roubles pour les deuxième et troisième enfants) (Elizarov, 2011, p.78 citant Décret n°235, 1981). L’égalité entre hommes et femmes, propre à ce modèle, est également mise en avant par un retour au droit à l’avortement (en 1955), et une simplification de la procédure de divorce (1965). Le principe d’égalité des sexes redevient central dans la politique familiale soviétique puisque la « Constitution » garantit que « les deux conjoints sont complètement égaux dans les relations familiales » (« Constitution » 1977, article 53). Ce principe d’égalité se manifeste par des mesures qui permettent aux femmes de concilier maternité et travail (53), parmi lesquelles le développement d’infrastructures préscolaires (jardins d’enfants, centres pour enfants, etc.). Selon Noskova (2013, p.157), entre 1932 et 1990, le nombre d’établissements préscolaires pour enfants augmente de 60 000 (le nombre d’établissement passe de 27 500 en 1932 à 87 900 en 1990) et le nombre d’enfants fréquentant ces établissements augmente de 7 500 fois (de 1 200 en 1932 à 9 009 500 mille en 1990).
« La femme et l’homme ont des droits égaux en URSS. L’exercice de ces droits est assuré par l’égalité des chances des femmes en matière d’éducation et de formation, de travail, de rémunération et de promotion, d’activités sociales, politiques et culturelles, ainsi que par des mesures spéciales pour la protection du travail et de la santé des femmes, la création de conditions permettant aux femmes de combiner travail et maternité, la protection juridique, le soutien matériel et moral pour la maternité et l’enfance, notamment l’octroi aux femmes enceintes de congés payés et autres prestations ».
« Женщина и мужчина имеют в СССР равные права. Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, в вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей ».
« Женщина и мужчина имеют в СССР равные права. Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, в вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей ».
Source : « Constitution de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques » (1977, article 35).
Il est important de préciser que le partage des obligations concernant l’éducation des enfants n’est pas égalitaire dans les faits, car ces dernières reposent principalement sur la mère (Chernova 2013a, p.55, Kushtanina 2019, p.246). Cette situation ne remet pas fondamentalement en question l’analyse de la politique familiale soviétique comme faisant partie du type social-démocrate : même si l’égalité entre hommes et femmes n’est pas atteinte dans les faits, elle est effectivement promue par l’esprit des mesures engagées par l’État. Pour résumer, la politique familiale soviétique des années 1980-1991 peut-être considérée comme s’inscrivant dans le modèle social-démocrate décrit par Gautier (2002), car on y retrouve les traits principaux de ce modèle : 1) la promotion de l’égalité des sexes, 2) la combinaison de longs congés parentaux avec une offre de modes de garde des enfants, et 3) la mise en place d’allocations universelles.
Je montre maintenant qu’après la chute de l’Union soviétique, la politique familiale russe subit de nouveaux changements en combinant des traits du modèle social-démocrate avec des traits du modèle libéral.
Politique familiale dans les années 1990
L’effondrement de l’Union soviétique et le passage de la Russie à une économie de marché provoque une crise économique dans les années 1990, qui se traduit par la chute radicale du niveau de vie et l’appauvrissement général de la population (Lefèvre 2003a, p.85, Kortchagina et al. 2005, p.219, Prokofieva 2012). Au début des années 1990, la part de la population ayant un revenu inférieur au minimum de subsistance représente environ 50 % de la population selon les données du Rosstat (2019). Il était estimé officieusement qu’à la fin de l’URSS, selon Milanovic (1998), la proportion de pauvres (dans les années 1987-1988) représentait seulement 2 % (Bertin & Clément 2008, p.196, citant Malinovic 1998).
Selon Prokofieva & Terskikh (1997, p.1244), le niveau de la pauvreté est en lien avec la spécialisation des territoires : la situation est plus favorable dans les régions où les entreprises de l’industrie extractive prédominent, et, inversement, l’orientation agricole du territoire et la prédominance des entreprises industrielles (industrie légère ou lourde) ont un impact négatif sur le niveau de vie des familles.
L’appauvrissement touche particulièrement les familles avec enfants (Lefèvre 2002, p.548), notamment les familles monoparentales et les familles nombreuses (Lefèvre 2003a, p.86, Kortchagina et al. 2005, p.219). En 1992, un quart des familles avec enfants se trouve dans une situation de pauvreté et un quart des familles monoparentales est dans une situation de pauvreté extrême .