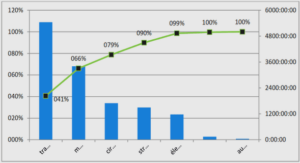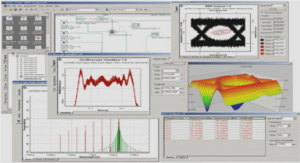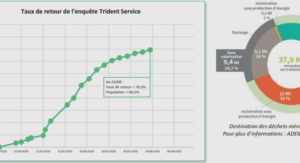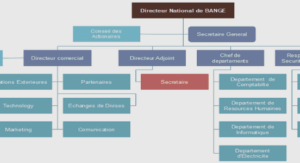Des fondements hérités de la scolastique
Inspiré de la tradition grecque, Digby cherche l’élément clé, l’item unique qui permettrait de justifier l’ensemble des phénomènes physiques et naturels : plutôt que de choisir l’un des quatre éléments comme les présocratiques, il penche vers un fondement numérique et trouve dans un concept de quantité ajusté à ses besoins les possibilités explicatives qui lui sont nécessaires.
La quantité
Comment se fait-il que deux corps faisant le même volume puissent avoir une masse différente ? Telle est l’interrogation liminaire qui anime Digby au seuil de son étude physique. Deux corps ne peuvent occuper le même espace : la différence de poids ne peut donc être due à la présence d’un troisième corps. Pour résoudre cette énigme, Digby adopte une méthode qu’il emprunte à l’astronomie – l’hypothèse – et introduit ainsi dans son ouvrage, de façon délibérée et appuyée, l’illusion productive, la fantaisie
Une philosophie de la nature pétrie de lumière et de mouvement
au service de la réalité, dans une démarche qui est loin de faire l’unanimité à son époque1. Les astronomes calculent les mouvements à partir de ce qu’ils supposent être les orbites, les parcours et les évolutions des étoiles et des planètes qu’ils observent – en aucun cas n’ont-ils la certitude que leur examen est conforme à la réalité2, tout dépendants qu’ils sont de leurs instruments d’optique et de leur position d’observateurs. Dans le manuscrit de Deux traités, Digby ajoute même que les astronomes peuvent déterminer par avance le mouvement des cieux grâce à leurs calculs, mais « qu’il leur importe peu que ceux-ci soient vrais et réels3 ». Il biffe ensuite cette remarque sans doute pour couper court aux critiques qui lui reprocheraient de faire fi, lui aussi, de la réalité du monde physique par son usage d’hypothèses, mais il adopte l’approche de la fiction utile et féconde. Cette nouvelle méthode ouvre à Digby un champ de possibles : plutôt que de fonder sa physique sur un enchaînement rigoureux où la vérité est établie à chaque étape et où les conjectures sont gardées pour la fin à la manière scolastique, il peut commencer par une supposition qui sera validée si l’ensemble de ce qui suit est cohérent et libre de toute contradiction. La confirmation se fait a posteriori, et la démarche ouvre un cadre à la fiction qui se trouve ainsi dotée d’une dignité nouvelle, d’une légitimité philosophique.
Digby emprunte la plupart de ses catégories à l’antiquité grecque, et bien souvent il leur donne un tour contemporain, coloré par le mécanisme de son époque. Est-ce à dire que ses concepts de base sont relégués au rang d’hypothèses, en particulier ceux qu’il emprunte à Aristote ? De fait, bien que le Stagirite soit une autorité dont Digby se réclame souvent, le chevalier cherche à instaurer de la circonspection dans les trop nombreux préceptes des Écoles et sa reprise de la théorie aristotélicienne la déclasse en effet du rang d’autorité indiscutable à celle d’hypothèse recevable. Le philosophe Andreas Blank abonde dans ce sens et ajoute que Digby organise ses idées en fonction du concept épicurien et stoïcien de « notions courantes » qui veut que les noms des concepts soient des indicateurs de ce qu’ils signifient, et que l’usage commun d’un terme soit, par conséquent, l’un des critères de son sens et de sa validité4. Ainsi, aux concepts aristotéliciens de densité et de rareté, Digby ajoute ceux de quantité et de substance qu’il emprunte au langage courant. Il évite ainsi de parler de forme pour se concentrer sur la matière au moyen de termes fonctionnels et accessibles1. Les notions de Digby sont ainsi tirées d’une tradition intellectuelle, mais aussi plébiscitées par le sens commun, ce qui permet, dans l’approche du chevalier, de leur accorder un statut d’hypothèse valable. Cette double validation justifie leur adoption comme fondement, et se voit confirmée a posteriori, comme fiction vérifiée.
Le principe initial que Digby emprunte à Aristote est la quantité, c’est-à-dire ce qui permet au corps d’avoir des parties. Sa première propriété est d’être grande ou petite, ce qui se traduit concrètement par la présence de plus ou moins de parties2. Pour la définir et l’épurer de son passé scolastique, le chevalier recourt aux définitions communément admises et conclut qu’elle est mesurée grâce à la comparaison. La quantité est l’extension d’une chose calculée par un nombre d’extensions plus petites, mais de même nature, qui sont des parties de l’ensemble, comme le drap que l’on évalue en toises3. Dès lors, puisqu’elle comprend nécessairement des parties, la quantité peut se résumer à sa capacité à être divisée en ces dernières, elle équivaut donc à la divisibilité. Cette définition est rendue évidente quand on se tourne vers la quantité discrète, comptabilisée grâce à un nombre, plutôt que la quantité continue aussi appelée extension. De fait, il est dans la nature du nombre d’être divisé, son application à la quantité est donc idoine.
Digby est conscient que sa définition de la quantité prête le flanc à la critique, et son interprétation des atomes diffère parfois de celle de ses contemporains. En promouvant une infinie divisibilité4, il introduit dans le monde physique communément admis pour sa finitude, l’infiniment petit – et comme on le verra par la suite, ce n’est pas là sa seule incursion de l’infini dans le fini. L’infini étant normalement, sur le plan métaphysique, l’attribut du divin, et le divin n’étant jusque-là jamais défini en termes d’extension et encore moins en termes de petitesse, il faut que le chevalier montre, d’une part, que Dieu se situe sur un autre plan et, d’autre part, que la matière lui reste soumise, que cet infini nouvellement découvert ne menace pas sa suprématie – il le fera en prouvant que le monde des esprits ne répond à aucun des impératifs du monde physique.
Une philosophie de la nature pétrie de lumière et de mouvement
Adopter la proposition inverse et admettre l’existence de minuscules corps indivisibles obligerait à fixer la limite minimale en deçà de laquelle on ne peut plus parler de corps. Outre la difficulté de mesure que cette approche pose, elle obligerait Digby à rompre l’adéquation qu’il établit entre indivisibilité et éternité, comme on l’étudiera au sujet des atomes, et par conséquent rouvrirait la voie aux accusations d’athéisme auxquelles l’atomisme renaissant était fréquemment associé1. En jeu dans cette définition se trouve la division fondamentale entre corps et âme, entre mondes matériel et immatériel : la définition digbéenne de la quantité est à la racine de son dualisme.
Ce principe essentiel qui fait correspondre la quantité avec la divisibilité fait l’objet de la vindicte de Joseph Glanvill qui affirme dans son Vanity of Dogmatizing l’impossibilité de connaître les processus physiques et métaphysiques qui régissent l’univers, réfutant au passage la démarche et les arguments de Digby, sous prétexte que la capacité de l’homme à connaître s’est excessivement émoussée depuis Adam. L’argument, caractéristique des sceptiques, lui vaut une réponse cinglante de Thomas White dans Sciri, sive, sceptices et scepticorum a jure disputationis exclusio qui est suivi d’une traduction en anglais publiée en même temps que la réplique de Glanvill, Scire/i tuum nihil est2. Après avoir affirmé qu’il est impossible de connaître l’âme (chapitre 3) et d’expliquer le fonctionnement de la perception et de la mémoire (chapitre 4), le sceptique s’en prend à la composition de la matière (chapitre 5) et avance que les parties doivent être séparées et distinctes dans leur masse et leur quantité, et que la divisibilité, par conséquent, doit présupposer la diversité des parties. Il se fie pour sa démonstration aux sens qui font prendre conscience que les parties sont variées et nombreuses et il remet en cause la méthode de Digby et de White qui, affirme-t-il, nient les données simples fournies par les sens perceptifs. De fait, Digby ne se réfère pas, dans sa définition de la quantité, aux organes sensoriels, qui peuvent être source d’erreurs, mais préfère se fonder sur la notion commune qui porte déjà la trace du travail intellectuel, si ténu soit-il. L’adéquation avec ce qu’indiquent les sens n’est pas négligée comme le pense Glanvill, elle est dissociée de sa contrepartie plus théorique qui nécessite d’abstraire les informations sensorielles, dans une démarche qui pourrait s’apparenter à la méthode mathématique. La quantité n’a pas besoin d’être perçue puisqu’elle est infra-sensible, elle est un outil mental qui ouvre un accès à la compréhension du réel. Ce processus discret de mathématisation du monde1 échappe à la sagacité de Glanvill qui refuse la justification théorique a posteriori et promeut à la place une réflexion conforme, à chaque étape, à la perception que le sujet a du monde.
Ainsi, le concept digbéen de la quantité est faussement présenté par son auteur comme simple et dénué de polémique et son équivalence avec la divisibilité, essentielle pour la démonstration, est loin de faire l’unanimité. Elle permet toutefois d’accorder à chaque chose dans le monde une identité numérique qui la rend reconnaissable et qui se compose d’un équilibre particulier entre rareté et densité, évalué grâce à la notion de quantité. Ainsi, la pensée de Digby s’inscrit dans le mécanisme d’inspiration baroque que décrit Herbert Knecht, puisque son exposition du savoir « recherche la forme mathématique, qui ordonne idéalement les connaissances au sein d’un tissu cohérent2 ». Par sa mathématisation, le monde devient saisissable.
Grâce à l’identité numérique qu’est la quantité, chaque chose peut être classée sur une échelle de densité et qualifiée de plutôt dense ou plutôt rare, ce qui entraîne des caractéristiques différentes. Parmi ces dernières, Digby remarque que, sur le plan empirique, les parties des corps denses sont plus serrées et difficiles à diviser que les corps rares, en sus de paraître plus lourdes. Ce constat signifie-t-il que le degré de densité joue un rôle dans la chute ? Pour traiter de ce sujet brûlant, il reprend les définitions opérationnelles proposées par les philosophes qui le précèdent, à commencer par Galilée qui postule que le milieu ambiant offre une résistance accrue proportionnelle à l’état de l’objet cheyant. Digby récuse cette idée : une livre de plomb massif et une livre de plomb en poussière comprimée tombent à la même vitesse, avance-t-il ; elles ne sont pas composées des mêmes corps, néanmoins elles contiennent des corps de même nature, ce qui signifie, dans le système de Digby, que ces derniers partagent la même quantité1. Ce n’est donc pas le nombre d’entités dans un volume qui importe, mais plutôt la nature de la matière qui occupe ce volume qui permet de déterminer la masse et l’allure de la descente qui s’ensuit.
Ce raisonnement permet à Digby d’évacuer la question du vide interstitiel qui faisait rage à son époque2 : dans l’hypothèse où les corps rares sont plus « aérés » que les denses, qu’y a-t-il entre leurs différentes parties ? La présence de vide obligerait à admettre que les corps flottent, vision effrayante d’un monde sans ancrage, à la dérive, soumis à des forces contraires et arbitraires, outre le fait qu’elle empêcherait le mouvement des petits corps isolés puisque, d’après Aristote, le mouvement ne peut exister qu’au sein de la matière attenante3. L’accent que le chevalier fait porter sur la quantité, et non sur les corps premiers ou atomes, invalide l’hypothèse du vide dans la mesure où seule l’identité numérique influe sur la masse et la vitesse. Digby agrémente son propos des récents calculs de densité de l’air, de l’eau et de l’or par Galilée et Marin Ghetaldi4 – le sérieux et la rigueur de cette approche prouvent que Digby n’est pas un dilettante, mais bien qu’il est au courant des dernières recherches qu’il cherche à s’approprier5. À chaque corps correspond un nombre précis qui équivaut à sa densité propre ; Digby s’inscrit subtilement ici dans la mathématisation du monde qui veut que tous les phénomènes physiques répondent à une numération.
L’exemple qu’emploie Digby fait appel à une expérience quotidienne : quand on vide un bac d’eau, comment la séparation entre le contenant et le liquide se fait-elle ? Leurs degrés de rareté respectifs, différents puisque bac et eau ne sont pas composés de la même matière, expliquent la division naturelle. Les gouttes d’eau qui demeurent sur le bord et l’absence de morceaux de bac dans le liquide évacué s’expliquent par le fait que l’ensemble « bac et eau » forment une quantité déterminée et continue qui prévaut sur l’unité de l’eau seule1. Pour oiseuse que puisse paraître la discussion, rappelons que la Renaissance prend très au sérieux la question de l’individuation qui trouve chez Digby un écho dans le problème de l’identité2. Le raisonnement choque le bon sens moderne, par cela même qu’il revient à assigner une même densité à l’eau sous ses formes liquide, solide et vaporeuse, et donc à leur allouer, sur le plan théorique, la même vitesse de chute et la même masse. Afin de saisir ce concept primordial dans la pensée de Sir Kenelm, il ne faut envisager la quantité que comme une donnée théorique qui permet une classification systématique du monde, une mathématisation utile à sa compréhension. Digby privilégie, en choisissant la quantité comme source de toute sa physique, un principe qui lui permet à la fois de rester fidèle à la vision aristotélicienne d’un monde continu, sans vide, mais aussi de favoriser une approche réglée, méthodique et mathématique caractéristique de son temps, tout en promouvant l’intelligibilité du monde physique.
Ainsi, grâce au concept de quantité et à ses corollaires de densité et de rareté, Digby, dans le sillage de Galilée, prêche l’intelligibilité du monde grâce aux outils mathématiques, ainsi que la continuité de la matière physique, par son refus du vide interstitiel, au détriment des contours marqués de chaque chose. La continuité promue par Digby évoque la distinction entre styles linéaire et pictural dressée par Wölfflin : si le premier procède à l’aide d’essences, et insiste sur le dessin et les contours marqués des choses dans une perspective toute classique, le deuxième met en valeur les relations qu’entretiennent les formes, « s’efforce de saisir l’espace dans une unité vitale et mouvante » et propose une vision du monde symphonique plutôt qu’analytique3. De même, le refus du vide et la continuité affichée de la matière qui en découle effacent les contours de chaque chose physique pour y substituer une vision continue de l’étendue renforcée par le mouvement des atomes.
Les atomes
Si le vide n’existe pas et si la matière qui constitue le monde est continue, comment expliquer que les choses individuelles soient distinctes ? Dans le détail, la question de l’individuation se pose sous un angle nouveau chez Digby et chez ses contemporains atomistes1. De fait, l’hypothèse atomiste au XVIIe siècle, qui ressuscite d’une façon ou d’une autre la pensée antique, suppose que le monde soit fait de petits corps mouvants et, dans une certaine mesure, interchangeables. Deux séries de questions s’ensuivent. D’une part, la nature de l’association entre la personne ou la chose et ses atomes reste à déterminer, puisque si le nombre de particules est fini, il faut convenir de la réutilisation possible de certaines pour constituer d’autres entités ; ainsi, un corps humain peut comprendre un atome ayant auparavant composé un champignon ou un coléoptère. D’individuelle, la matière qui compose l’enveloppe charnelle devient peu à peu perçue comme provenant d’un magasin où la nature va puiser librement ; la chair humaine est un emprunt temporaire à la réserve générale. La matière est en permanence recyclée. De surcroît – et il s’agit là d’un corollaire de l’interrogation précédente – les atomes étant des forces en mouvement, ils suscitent la question de l’identité de la personne ou de la chose par rapport aux aléas et aux transformations qu’impose le temps : qu’est-ce qui fait que la graine et la plante qui en sort quelques semaines plus tard sont le même végétal ? La première a perdu des atomes et en a agrégé d’autres : peut-on encore parler d’une seule et même entité ? Digby traite de ces questions à de nombreuses reprises, comme l’étude de sa biologie le montrera ; il suffit de souligner pour le moment que le tourbillon perpétuel du monde physique qu’il décrit avec éloquence met en péril l’identité personnelle, la signature individuelle de chaque chose, et que le chevalier tente de substituer aux données habituelles de permanence la notion de quantité, afin de réaffirmer avec force que l’individu continue d’exister dans un monde mouvant, continu et fluctuant.
Corps naturel le plus menu du monde physique, l’atome de Digby, paradoxalement, n’est pas indivisible2. Le débat autour de l’indivisibilité faisait rage au XVIIe siècle, quand les atomistes distinguaient « être divisible par la pensée » et « être réellement divisible », et préservaient ainsi la toute-puissance de Dieu tout en affirmant l’existence d’une unité minimale3. Ils évitaient ainsi la réfutation classique de l’atomisme qui consiste à exhiber les paradoxes de l’indivisibilité pour la géométrie euclidienne1. Digby fustige dans une lettre à Mersenne les atomes de Démocrite qu’il estime de pures contradictions : irréductibles, ils sont éternels en vertu d’une adéquation ancienne entre la perfection de l’entité indivisible et l’immortalité2. Mais s’ils sont matériels, ils ne peuvent être éternels, puisque, faisant partie du monde physique, ils sont mortels et corruptibles. À l’inverse, si ces atomes étaient spirituels, ils ne pourraient concourir à composer les choses matérielles3. Digby rejette ce modèle et semble plutôt s’inspirer de la tradition scolastique des minima naturalia dans la mesure où il dessine l’existence de quatre types d’atomes différents sur le plan qualitatif, correspondant aux quatre éléments4. Conformément à la pensée des minima, la dimension ou la forme de l’atome importent peu dans le système digbéen, alors qu’elles sont centrales dans les théories atomistes de penseurs inspirés d’Épicure, Gassendi et Charleton en premier lieu5. À l’origine, la théorie scolastique désigne le minimum en-deçà duquel la forme ne subsiste plus, la limite inférieure de la divisibilité – mais Digby n’y voit pas de contradiction avec son principe d’infinie divisibilité6.
La forme des atomes, négligée dans Deux traités, fait toutefois surface dans un opuscule plus tardif, le Discours fait en une célèbre assemblée, publié en 1658. Le Discours occupe une place particulière dans l’œuvre physique du chevalier, du seul fait que plusieurs théories que Digby récuse par ailleurs y apparaissent presque fortuitement. Fruit de sa maturité, il peut constituer le signe que la pensée de Digby évolue au fil des années, ou encore qu’il adapte sans vergogne ses explications à son public. Prononcé pour l’Académie de Montpellier en 1657, puis sans doute lu à l’Académie de Castres en 1658, le Discours s’adresse principalement à des médecins français sans aucun doute familiers de la pensée de Descartes, mais aussi des atomes antiques7. L’évocation du lieu naturel ou de la forme des atomes pourrait n’être qu’une façon de vulgariser sa propre pensée, une manière d’adopter un vocabulaire connu afin de rendre sa pensée accessible en peu de temps. Plausible aussi est l’hypothèse selon laquelle Digby cherche à combler les interstices laissés par l’exposition de sa théorie atomiste des années 1640. Toujours est-il qu’en 1657, il discute du contour des corpuscules : il conteste la conception lucrétienne des atomes crochus pour avancer que les particules de sel sont, suivant leur particularité, des cubes, des hexaèdres, des colonnes ou des hexagones1. L’expérimentation permet de l’affirmer, puisque, quelle que soit la transformation à laquelle les sels sont soumis, ils reviennent toujours à leur forme initiale. Cette « figure » propre à chaque atome, comme l’appelle le chevalier, est l’une des forces majeures de l’union des parties et explique qu’un atome, préférant toujours la compagnie de ses semblables, s’agglutinera plus facilement avec ses analogues. Ainsi, dans la force de l’âge, Digby adapte son système atomiste aux théories dominantes de Gassendi et Descartes2.