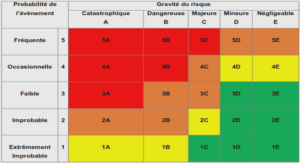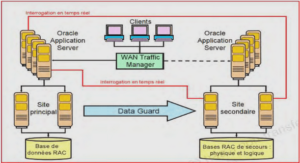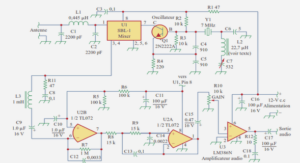Une phase de transition : d’Internet au Web élargi (2.0)
La première des difficultés que nous avons pu rencontrer à été de constituer un terrain homogène d’acteurs, de pratiques et de représentations. Depuis le milieu des années quatre vingt-dix, moment où nous avons commencé à nous intéresser à la question du médiactivisme, la configuration des acteurs et des pratiques a été en évolution constante au point que même s’il y a une continuité dans l’affirmation de pratiques, celle des acteurs ou de leurs espaces d’expression (sites web, listes de discussion, etc.) a considérablement évolué.
Une de nos premières tâches qui restera constamment à préciser, à affiner ou à réorienter en fonction des évolutions de la configuration du réseau a été de nous donner un cadre qui puisse constituer un terrain d’enquête.
Les approches sociologiques traditionnelles en termes de catégories socioprofessionnelles, d’organisation, de mode de vie, etc. ne permettant pas de trouver une cohérence satisfaisante pour notre étude du médiactivisme, nous avons opté pour une définition de cadre s’attachant à un champ de pratique pris dans sa dynamique à la fois spatiale et temporelle.
Notre travail ne porte donc pas sur des organisations ou sur des catégories socioprofessionnelles, mais sur des pratiques qui sont mises en œuvre par des acteurs très hétérogènes, pouvant aller du sans-papier ou du chômeur à l’universitaire ou au patron d’une PME de société de service informatique. Pour aller un peu plus loin, nous pourrions presque dire que nous avons voulu réaliser une biographie culturelle d’objets au sens où Igor Kopytoff l’entend dans l’ouvrage dont Arjun Appadurai a dirigé la publication en 1986 :
The social life of things. Commodities in Cultural perspective87. La démarche méthodologique de Kopitoff, qui vise à appréhender les objets dans leur « biographie », c’est-à-dire dans leurs différentes singularisations et resingularisations successives, nous semble particulièrement adaptée pour montrer la dynamique propre de ces curieuses machines auxquelles ont recours ces « orphelins de la politique ».
Ces biographies culturelles d’objets, qu’ils soient techniques, artistiques ou médiatiques, produites dans une perspective de critique sociale et politique comme de transformation concrète de la société, nous permettront d’étudier les représentations que ces activistes se font de la politique. D’un point de vue schématique nous pourrions dire que le médiactivisme se développe en France, comme dans le reste du monde en trois phases de mobilisation qui possèdent chacune leurs propres caractéristiques techniques et leurs propres outils.
Nous allons tenter ici de donner une esquisse de ces différentes phases sachant que notre investigation porte sur la période allant de 1995 (date à laquelle Internet commence à apparaître dans le grand public) à 87 APPADURAI, Arjun (dir.). The social life of things. Commodities in cultural perspective. Cambridge : Cambridge University Press, 1986 52 Olivier Blondeau – « Les orphelins de la politique et leurs curieuses machines ». Thèse IEP de Paris – Année 2006 2005, c’est-à-dire sur une durée assez longue de 10 ans.
Nous nous attacherons à décrire de manière précise la première période qui ne fait pas partie de notre travail de thèse, mais dont il convient de connaître la physionomie générale et une partie des acteurs pour aborder les deux autres moments de l’évolution de cet activisme en réseau. 1) 1995-2001 : L’Internet militant entre Web et listes de discussion Cette première période consiste en France comme dans le reste du monde à une phase intense d’appropriation. En majorité, les mouvements activistes ont recours au Web et aux listes de discussion.
Dans une phase d’investigation préalable de notre travail, nous avons pu repérer en France plus de 45 sites Web et une dizaine de listes de discussions. Il est à noter que la période qui suit les élections législatives de 1997, marque une apparente régression de ce type d’activité sur le Net. Coïncidant avec la diffusion, dans des milieux encore relativement confidentiels et privilégiés des outils télématiques liés à Internet, la période qui va de 1995 à 1997 a vu un développement sans précédent de ce que Fabien Granjon a pu appeler « l’Internet militant88 ».
De nombreux activistes, souvent isolés, y ont vu le moyen de donner à leurs revendications un retentissement d’ampleur nationale, sinon internationale sans être obligés de passer par les grandes centrales syndicales ou politiques et leurs organes de presse. Les Sans-papier et les chômeurs font évidemment figure de symbole, mais on peut citer aussi les enseignants et les parents des écoles de Seine Saint-Denis et du Gard ainsi que les différents mouvements d’Intermittents du spectacle.
La période qui suit l’arrivée de la « gauche plurielle » au gouvernement et qui se prolonge jusqu’aux grandes mobilisations internationales contre la mondialisation financière, à Seattle en juin 1999, est une phase d’éclipse apparente des mouvements sociaux sur Internet comme dans les médias traditionnels. En fait d’éclipse, on peut supposer que cette période est une période de maturation et de recomposition profonde de l’activité politique sur Internet. C’est sans doute à ce moment que de nombreux militants ont pris le parti de « franchir le Rubicon »