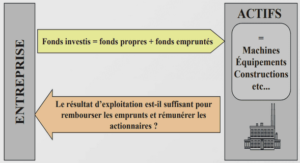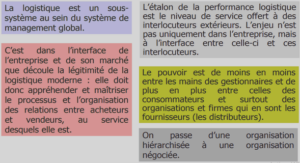La mesure de la réception : une entreprise très complexe
L’intérêt d’un discours de propagande est d’influencer vers des objectifs précis : ici recruter, persuader, enraciner des convictions violentes, convaincre d’un passage à l’acte, ou encore terroriser et paralyser. L’analyse de sa réception est donc nécessaire pour tenter d’en mesurer le succès par rapport aux objectifs souhaités par le propagandiste, mais mesurer l’impact d’un discours de propagande sur un comportement est très complexe. Ce qu’affirme le diplomate américain Alberto Fernandez sur la contre propagande américaine contre le djihadisme, « il est impossible de connaitre l’efficacité réelle de ces dispositifs sur les départs sur zone, à moins qu’un homme ne se lève pour affirmer « j’allais partir pour la Syrie, puis j’ai vu votre vidéo et cela m’a fait changer d’avis » », est un bon résumé des problèmes posés par cette tentative d’évaluation578. Elle est complexe à mesurer en l’absence de données concrètes et objectives, et se heurte à des biais, comme l’honnêteté des personnes interrogées, voire l’objectivité de leur propre conscience de ce poids dans leur engagement. La propagande est un moteur, un facteur parmi d’autres dans le processus de radicalisation, et son poids est individuel, il varie d’une trajectoire et d’une biographie à une autre. C’est pourquoi, rares sont les études à avoir tenté cette analyse, et à avoir réussi avec succès. L’analyse sur les populations demeure elle, globalement non explorée, et n’appartient pas réellement au domaine de la recherche en sciences sociales, qui ne possède pas tous les outils et méthodes pour parvenir à la réaliser.
Pierre Conesa, Margaux Chouraqui et François Bernard Huyghe, dans leurs travaux sur la propagande francophone de l’Etats Islamique, dans lesquels ils amorcent une approche par la réception, se sont confrontés aux difficultés énoncées. Pour eux, la force de l’Etat Islamique réside dans sa rhétorique puissante, et le discours pourrait en réalité être évalué surtout au niveau des interactions entre cette rhétorique et les profils des personnes radicalisées579. Cette évaluation de la réception passe dans leurs travaux par une étude de témoignages médiatiques de parents et amis, voire d’anciens djihadistes. Cette approche est assez intéressante, car nombreux sont les témoignages de proches, de professionnels, mais aussi dans les procès, sur l’importance de la propagande dans la vie des personnes radicalisées580. Néanmoins, cette approche de la réception repose sur un risque d’imprécision et de biais non négligeable compte tenu des sources et du dispositif d’enquête. Daniel Milton a également amorcé une approche par la réception, puisque ses travaux sur 1700 photos ont permis de déterminer que les photos violentes, notamment celles touchant à la violence rétributive, soit à la vengeance et à la récompense, suscitaient le plus d’engagement sur Internet581. Il est donc possible, bien que cela soit complexe, de faire une analyse de la réception en se plaçant du côté de la radicalisation, même si cela reste un champ encore peu exploré en sciences sociales. Le principal champ de recherche se situe actuellement sur le rapport entre numérique et radicalisation. Sur la question de la réception par les populations, des études interrogent l’impact du terrorisme sur les populations à travers les médias, mais ne portent pas directement sur la réception de la propagande582. Cette absence est peut-être justifiée par le fait qu’il est difficile d’imaginer une autre réponse que du rejet dans une France post attentats.
L’élaboration d’un dispositif d’enquête qualitative
Dans la seconde partie de chapitre, nous voulions interroger la réception de ce discours de propagande par ses cibles, définies ici comme les populations en France. Comme précédemment mentionné, nos travaux ne nous ont pas permis d’accéder à un public représentatif, soit à un public qui aurait été au contact de ce discours et se serait radicalisé, aussi l’expérience portait sur un public de cibles large, qu’on résumait à des échantillons de la population vivant en France, et interrogeait autant les émotions suscitées par la propagande de séduction que par la propagande de terreur. L’Etat Islamique s’adressait dans une partie de sa propagande aux populations en France, pour séduire, terroriser, et choquer, il semblait donc intéressant de voir dans quelle mesure il atteignait ses objectifs. La France a été à la fois visée par un discours de recrutement à échelle individuelle, et par une campagne de terreur à échelle large. Il s’agissait de confronter ce discours à la manière dont celui-ci est effectivement reçu par un public cible, pour cela, était envisagée une expérience réalisée sur des panels.
L’expérience proposée devait répondre à la question : Quelles émotions, sentiments et réactions suscitent les différents types de vidéos et discours de propagande de l’Etat Islamique chez les populations françaises et comment cela influe-t-il sur leur opinion et positionnement sur plusieurs questions de société et géopolitiques ? Les populations sélectionnées étaient invitées à répondre à des questions fermées évaluant graduellement leurs émotions, qui n’exigeaient pas de rédaction, la rédaction risquant d’intimider les interrogés, pas toujours très renseignés sur ces questions. Il s’agissait d’une enquête davantage qualitative, réalisée sur un échantillon très réduit de quarante personnes. L’objectif ici n’étaient pas de tirer des conclusions générales, mais de faire des hypothèses en proposant une approche de la propagande par la population et sur le terrain des émotions. Le protocole reposait d’abord sur le visionnage d’extraits de vidéos de propagande et l’écoute d’un chant choisis sur plusieurs critères. Un premier critère reposait sur la langue, pour faciliter la compréhension du corpus par les interrogés francophones, cinq vidéos et un chant étaient en français, une seule vidéo était en anglais et traduite par nos soins. Le second critère reposait sur le contenu et sur une graduation, on partait de la séduction pour passer graduellement en revue tous les types de vidéos de recrutement, suivi par l’enracinement dans la cause, pour finir avec deux vidéos de terreur, dont la seconde mettait en scène un enfant. Le chant, qui parlait des attentats du 13 novembre, s’inscrivait aussi dans la terreur. Tous les fichiers étaient issus des archives de l’Etat Islamique, précisément de la chaine Al Hayat Media Center, à l’exception d’une vidéo extraite d’Al Furqan Media. Ce visionnage était accompagné d’un questionnaire anonyme évaluant les différentes émotions des spectateurs. En complément de ce questionnaire était proposé en fin de chaque séance et avec chaque groupe un entretien collectif pour échanger sur le visionnage, et sur différentes questions d’actualité présente ou passée en lien avec le djihad. Pour approfondir certaines questions, en dehors de la pression de groupe, devaient également être réalisés des entretiens individuels semi directifs.
L’abandon de l’expérience : un renoncement préférable
Après un temps de réflexion sur le dispositif envisagé, et malgré des doutes persistants sur la capacité d’une telle expérience à offrir des résultats probants, nous l’avons présenté à des tiers. Si les personnes en dehors du monde de la recherche ont montré de l’enthousiasme et de l’intérêt, les chercheurs se sont montrés beaucoup plus réservé. Ce sont finalement ces échanges avec des chercheurs expérimentés qui nous ont convaincu qu’il était préférable d’abandonner. Le premier problème était éthique, il semblait discutable après réflexion de montrer des vidéos djihadistes à un public non professionnel, même averti, quand bien même les scènes de violences physiques, comme les exécutions, seraient coupées pour ne pas heurter excessivement la sensibilité. En effet, il s’agit d’une démarche qui peut sembler discutable et risquée, dans un pays qui a momentanément sanctionné l’accès à ce discours. L’autre risque concernait l’impossibilité prévisible d’arriver à un résultat probant dans une France meurtrie par les attentats, où il est difficilement envisageable de voir une personne éprouver et exprimer autre chose que de la colère, du dégout et du rejet, une telle expérience ne pourrait donc rien prouver, rien amener de véritablement intéressant. Cette dernière remarque nous semble faire sens, dans la mesure où les personnes interrogées avaient fort peu de chance de donner une réponse autre, et encore moins favorable, ce qui par ailleurs aurait mis la chercheuse dans une situation fort délicate. En effet, dans le cas contraire, si une personne devait approuver le discours, le problème éthique serait encore plus grand, puisqu’il placerait la chercheuse devant le devoir de prévenir les autorités compétentes, alors même que l’expérience garantissait l’anonymat. Ensuite, la question des outils et des capacités s’est également posée, les sciences sociales ne disposant pas vraiment des outils nécessaires pour mener ce type d’enquête, qui fait appel aux sciences cognitives, voire neurocognitives, et à des logiciels spécialisés dans le traitement et la lecture de telles données. La question de nos capacités à mener à bien une telle expérience, qui fait appel à des outils et des méthodes hors de notre discipline, et à interpréter ses résultats, se posait. Enfin, il s’agissait également de ne pas se disperser dans un sujet trop vaste, la question de la réception étant un sujet assez vaste et pointu, qui pourrait être le sujet d’une thèse en elle-même. Il était difficilement justifiable de traiter la réception par les cibles alors que l’angle choisi reposait avant tout sur la réception pénale, cela aurait exigé un travail colossal, surtout peu cohérent avec l’ensemble. En conclusion, le risque d’échec, de résultats peu probants, a conduit à l’abandon de l’expérience. Nous avons malgré tout mené des entretiens avec des citoyens de plusieurs âges, femmes et hommes, notamment des spécialistes de l’image, pour les interroger sur leur accès à la propagande, leurs connaissances et leurs ressentis, nous avons appris que la plupart d’entre eux avaient déjà vu des extraits de propagande via les médias. En tout, dix entretiens individuels semi directif ont été menés, six avec des personnes de 18 à 45 ans et quatre avec des personnes de 46 à 75 ans. Nous avons également interrogé ces personnes sur ce qu’ils pensaient de la réaction pénale face à la propagande djihadistes en France, et avons constaté une faveur de la population pour le fait de sanctionner directement les spectateurs.
En conclusion de ce chapitre, et de cette partie, il apparait que la propagande de l’Etat Islamique, bien que s’inspirant d’autres modèles de propagande, terroriste ou de guerre, a su mettre à sa disposition des moyens et outils modernes. Tant au niveau de la création, de la production de sa propagande, qu’au niveau de sa diffusion, le groupe s’est reposé sur des outils modernes, qui ont nettement contribué à l’expansion de son discours en occident, à sa médiatisation. C’est grâce cela, et à la couverture médiatique dont il est l’objet, à côté d’une campagne d’attentats sans précédent, que le groupe est depuis 2014 dans tous les esprits. Sa propagande est une véritable valeur ajoutée à son projet, puisqu’elle l’aide à atteindre tous ses objectifs qui sont de recruter, d’encourage le passage à l’acte, le passage de l’intentionnalité à l’action, et de terroriser. S’il est difficile de mesurer le poids concret de la propagande et du numérique dans les trajectoires d’engagement, ou encore sur le sentiment d’insécurité des populations, nul doute qu’elle apporte une véritable contribution. C’est cela qui va encourager le droit et la justice à sanctionner et à instrumentaliser la propagande pour tenter de freiner l’expansion du djihadisme sur territoire. Le sujet de la réception est vaste, passionnant et nécessaire pour comprendre l’impact du discours djihadiste sur ses différentes cibles, mais complexe à appréhender. On peut le saisir à notre échelle à travers les modes de diffusion et la réaction du droit et des institutions, car ils nous permettent de cerner la portée exceptionnelle du discours de l’Etat Islamique sur notre société.