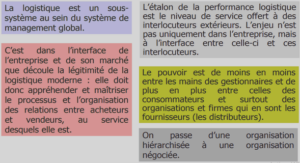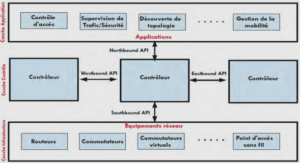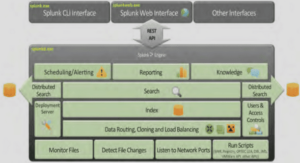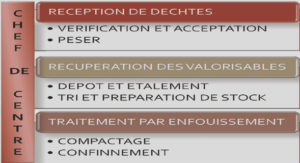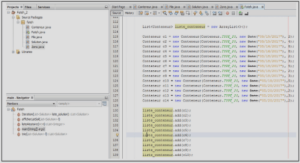L’instrument : une matérialisation d’intentions et l’incorporation de représentations spécifiques d’enjeux
Ces dernières années, la notion d’Instrument d’Action Publique s’est vue porter un intérêt renou-velé dans le champ de l’analyse des politiques publiques (Lascoumes & Simard, 2011, 1). Ce regain d’intérêt peut s’expliquer selon Christopher Hood par trois phénomènes (Hood, 2007, 20) : (1) un renouvellement des enjeux politiques, tel que la santé ou l’environnement, amenant à questionner la conduite des politiques publiques ; (2) l’application croissante à la sphère publique de pratiques issues du privée, c’est-à-dire la montée en puissance d’une approche gestionnaire des politiques publiques associée à des technologies de contrôle et d’évaluation des actions publiques ; et (3) le renouveau des approches critiquant le développement de ces nouvelles modalités de contrôle et de normalisation.
L’approche par les instruments est pensée pour être une réponse aux approches positionnant l’État comme étant en surplomb et propose, au contraire, de s’intéresser au plus près des manifestations concrètes et de la matérialité de l’action publique (Lascoumes & Le Galès, 2005). Cette dernière est définie comme : « un espace sociopolitique construit autant par des techniques et des instruments que par des finalités, des contenus et des projets d’acteurs » (Lascoumes & Le Galès, 2005, p. 12).
L’instrument : un assemblage socio-technique engagé vers l’action
Avant d’aller plus loin, il nous semble important de présenter, ici, ce que recouvre le terme ins-trument dans les analyses mobilisant la notion d’Instrument d’Action Publique. En effet, l’instrument n’est pas ici un simple artefact physique (Rabardel, 1995). Il ne s’agit pas d’un objet inerte et déli-mité. Un instrument n’est pas un outil qui serait le prolongement de la main, un auxiliaire modeste et neutre (Aggeri & Labatut, 2014). Au contraire, pour Franck Aggeri et Julie Labatut, l’utilisation de l’instrument nécessite des « opérations de pensée d’ordre supérieure » (Aggeri & Labatut, 2014, p. 65). L’instrument comporte une représentation et un sens de l’action qu’il est supposé performer et nécessite un apprentissage engageant non seulement le corps mais aussi l’intellect.
L’instrument comporte une dimension politique. En effet, l’instrument véhicule les intentions de ses concepteurs et leurs représentations du sens et de la performance de l’action dans laquelle l’instru-ment est engagé (Rabardel, 1995). Il matérialise donc ces intentions et incorpore une représentation spécifique de l’enjeu qu’il traite (Lascoumes & Simard, 2011, 1). Ainsi, l’instrument s’inscrit dans une vision de ce que doit être l’action, des savoirs et des pratiques qui doivent être mobilisés par ses utilisateurs, ainsi que des « effets » que l’utilisation de l’instrument est supposée produire.
Cependant si l’instrument est destiné par ses concepteurs à certains usages et à cadrer les pratiques de ceux qui l’utilisent, il est aussi le véhicule des intentions de ceux qui l’utilisent, qui interagissent avec lui et qui, au besoin, l’adaptent à leurs pratiques (Rabardel, 1995 ; Aggeri & Labatut, 2014). En effet, les chercheurs mobilisant la notion d’Instrument d’Action Publique ne considèrent pas l’État ou les décideurs-concepteurs de ces instruments comme étant en position surplombante (Halpern et al., 2014b). Ils ne s’inscrivent pas dans une approche gestionnaire qui viserait à évaluer l’efficacité des instruments uniquement à l’aune des effets anticipés de l’utilisation des instruments et des objec-tifs qui leur auront été assignés (Boussard, 2008). Au contraire, leur programme de recherche est de s’attacher « aux aspects concrets, aux supports matériels de l’activité » (Halpern et al., 2014a). Il s’agit donc de considérer l’instrument non pas comme neutre ou inerte, qui ne ferait que ce qui était prévu de faire, mais comme agissant et modifiant une situation et comme étant modifié en retour (Feen-berg, 2004). L’instrument co-construit ainsi avec ses concepteurs et ses utilisateurs la signification et l’orientation de l’action.
Un instrument est donc un assemblage socio-technique dans la mesure où, certes, il incorpore des artefacts techniques, mais est aussi éminemment une construction sociale dans la mesure où il véhicule les intentions et les représentations de ses concepteurs, ainsi que celles de ses utilisateurs en interaction avec lui.
L’instrument dans l’action publique
Comme nous l’avons vu précédemment, les politiques publiques, notamment du fait de l’avène-ment de modèles managériaux issus du secteur privé (Boussard, 2008), sont de plus en plus souvent accompagnées d’instruments (Halpern et al., 2014a). Pendant longtemps, les questions liées aux pro-priétés de ces instruments, les critères de leurs choix, leurs effets et leur combinaison ont été occultés dans l’étude des politiques publiques (Lascoumes & Simard, 2011, 1). Cependant le renouvellement des interrogations concernant la conduite des politiques publiques du fait de l’émergence ou de la ré-orientation d’enjeux publics (environnement, santé, etc.), la diffusion de mode de pilotage de l’action publique fondée sur la mesure des performances et l’accroissement des critiques remettant en cause cette « gestionnarisation » des politiques publiques (Hood, 2007, 20) ont conduit à ne plus considérer la place des instrument dans l’action publique comme donnée et « naturelle » (Lascoumes & Simard, 2011, 1).
Dans ce contexte, Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès ont proposé de penser « l’instrument d’ac-tion publique » comme : « un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur ».
La focale retenue sur l’instrument permet de sortir du seul monde des idées, des postures et des in-tentions et de saisir l’action publique dans sa matérialité. De plus, l’étude par les instruments d’action publique permet de révéler les changements qui s’opèrent, notamment dans le rapport entre gou-vernant et gouverné, car ils permettent, entre autres de révéler des scènes discrètes (Halpern et al., 2014a) lors des discussions qui président à leur constitution ou leur réagencement (Latour, 2007).
L’approche par les instruments permet également de remettre en cause plusieurs préconçus comme l’idée que la technique serait neutre, et non influencée par les stratégies politiques (Halpern et al., 2014a ; Feenberg, 2004).
Néanmoins, les approches fondées sur les instruments sont loin d’être homogènes. Pour sa part Christopher Hood a identifié trois principales orientations dans les travaux s’intéressant aux instru-ments dans le champ des politiques publiques (Hood, 2007, 20) : la première se concentre « sur les problèmes du choix et sur l’adéquation entre un objectif de politique publique et les moyens suscep-tibles de l’atteindre », la deuxième s’intéresse « à la diversification constante des instruments et aux problèmes de coordination qui en découlent », tandis que la troisième « est centrée sur les dynamiques de construction permanente [des instruments] et d’appropriation par les acteurs » (Lascoumes & Si-mard, 2011, 1). Parmi ces différentes approches, nous retenons la troisième, c’est-à-dire nous nous inscrivons dans une approche centrée sur les dynamiques de construction et d’appropriation.
Le programme de cette approche, ou plutôt de cet ensemble d’approches, propose de ne pas consi-dérer les Instruments d’Action Publique comme étant neutres, mais d’interroger leurs propriétés, leurs effets ainsi que les formes d’autorité et d’auteurité qui les légitiment (Lascoumes & Simard, 2011, 1). Il ne s’agit pas de considérer les Instruments d’Action Publique comme un simple « médium » qui véhiculerait, sans déformation, ni friction les représentations et les préoccupations de ses concepteurs et qui, par conséquence, les imposerait à ses utilisateurs. De même, les Instruments d’Action Publique ne sont pas des objets librement disponibles pour les utilisateurs qui pourraient les manier unique-ment selon leurs propres agendas. Au contraire, les Instruments d’Action Publique « détiennent une force d’action autonome qui se développe en interaction avec les acteurs qui les utilisent » (Lascoumes & Simard, 2011, 1). Un des enseignements de la sociologie de l’innovation (Akrich, 1987 ; Akrich, 1991 ; Latour, 1990 ; Latour, 1992 ; Callon & Law, 1997) est d’avoir justement montré que la construction de ces objets socio-techniques ne suppose pas de faire les « meilleurs » choix techniques (Latour, 1992), des choix qui ne seraient guidées que par la « raison » (Feenberg, 2004). La concep-tion de ces objets socio-techniques nécessite de négocier à la fois avec les différents acteurs humains, mais aussi avec des acteurs non-humains (Latour, 1990 ; Latour, 1992), tels que les lois de l’aé-rodynamisme, la taille des pistes de décollage, etc. dans le cas de la conception d’un avion (Callon & Law, 1997). De même, la construction de cet instrument ne signifie pas qu’il sera utilisé tel que l’avait prévu ses concepteurs (Akrich, 1987 ; Martin-Scholz, 2011 ; Martin-Scholz et al., 2013). Les instruments « ne sont pas statiques et réductibles à de la pure technique, ils produisent des effets indépendamment des objets qui leur avaient été assignés » (Lascoumes & Simard, 2011, 1). L’utilisa-tion de ces instruments suppose des négociations et des ajustements entre l’objet socio-technique et les acteurs qui le mobilisent. Les instruments possèdent ainsi une forme « d’inertie » (Latour, 1990) produisant des effets et orientant ainsi l’action.
Ainsi les approches fondées sur les instruments s’intéressent non seulement aux négociations et aux controverses entourant leurs conceptions et leurs utilisations, mais sont également attentives à leurs « effets ». Pierre Lascoumes et Louis Simard ont ainsi relevé trois principaux effets des instruments d’action publique : (1) les instruments constituent un acteur-réseau (Callon, 1984), ils ont un effet d’agrégation, où via des chaînes de traduction des acteurs hétérogènes se retrouvent et travaillent dans un même réseau ; (2) les instruments ont aussi un effet cognitif direct, dans la mesure où ils induisent une problématisation particulière de l’enjeu, ils hiérarchisent des variables et peuvent aller jusqu’à suggérer un système explicatif ; et (3) les instruments ne sont pas indissociables des modes d’actions contextualisées, c’est par et à travers elles que l’instrument existe réellement (Feenberg, 2004).
Le recours aux chiffres et aux indicateurs comme fondement de l’instrument
Un des fondements de l’instrument d’action publique est le recours aux chiffres et aux indicateurs, à des objets quantifiant et qualifiant un « état du monde ». En effet, l’instrument vise à organiser les rapports entre la puissance publique et ses administrés (Halpern et al., 2014b). Or, selon Albert Ogien (Ogien, 2000 ; Ogien, 1995 ; Ogien, 2008 ; Ogien, 2010), le discours de légitimation qui accompagne tout exercice du pouvoir (Weber, 1965) dans le cas des « démocraties avancées » est devenu celui du « gouvernement au résultat », impliquant une « mesure de performance de l’action de l’État selon le degré de réalisation d’objectifs chiffrés appliqués aux politiques publiques » (Ogien, 2010). S’instaure ainsi de plus en plus ce qu’Alain Supiot désigne comme la « gouvernance par les nombres », selon la-quelle les acteurs des politiques publique se doivent désormais moins « d’obéir à des prescriptions que d’atteindre des objectifs dont la réalisation est évaluée au regard d’indicateurs chiffrés » (Supiot, 2015, p. 216). Ainsi, les acteurs des politiques publiques territoriales ont, depuis une vingtaine d’années, de plus en plus recours à des objets qui quantifient ou qualifient, caractérisant un « état du monde », sous l’influence de la montée en puissance conjointe mais distincte des débats relatifs au développement durable (Rey-Valette et al., 2011) et de l’application aux politiques publiques de méthodes issues du privé (Theys, 2002), du fait de la propagation des idées dites « libérales », favorables à la régulation par le marché (Desrosières, 2008 ; Supiot, 2015).
La force « légitimante » de ces objets est qu’ils ont en commun d’avoir pour « but », selon leurs concepteurs, de fournir une « image objective » du monde. En effet, dans un contexte où les déci-deurs politiques sont de plus en plus enjoints à prendre des décisions les plus rationnelles et les plus efficaces possibles, et de les justifier, ces objets donneraient une certaine légitimité aux discours qu’ils soutiennent, du fait de la « rationalité supérieure » que sont censés incarner la science et la technique dont ils sont issus (Habermas, 1969 ; Marcuse, 1964 ; cités par Boussard, 2008, p. 116). Ce recours aux chiffres en tant que discours de légitimation, s’explique aussi selon Albert Ogien par les « vertus » dont ils sont parés par les individus souvent de manière irréfléchie, à savoir celle d’être vrais, d’être neutres et d’être incontestables (à condition que personne ne remette en cause leur « objectivité ») (Ogien, 2010).
Pour comprendre pourquoi les chiffres et la rationalité sont pourvus de toutes ces propriétés, au point presque de les « sacraliser » (Ogien, 2013), il est nécessaire de comprendre le modèle de pensée et d’action qui prédomine dans les services de l’État. Il s’agit, en prenant appui sur la thèse de Marie Bénéjean (Bénéjean, 2013), de comprendre d’où vient et de quoi est constitué la « pensée-ingénieur » à l’œuvre dans ces services. Pour Scardigli (Scardigli, 2001 ; cité par Bénéjean, 2013), cette pensée a été forgée à partir de l’influence des penseurs du XIXième siècle, tel que Auguste Comte, un des fonda-teurs du positivisme, pour qui le progrès des sciences et des techniques est la condition pour atteindre la félicité des Hommes et des Sociétés. Ainsi, cette pensée postule que « les sciences exactes et quan-titatives peuvent et doivent décrire tous les rapports entre l’Homme et son environnement » (Gras, Moricot, Poirot-Delpech & Scardigli, 1994, p. 239 ; cité par Bénéjean, 2013). Selon ce système de pensée, il est donc nécessaire de réduire les incertitudes en décomposant le monde en entités me-surables et appréhendables, en fonctions, auxquelles un rôle peut être attribué, afin de reconstruire le monde sous une forme maitrisée et contrôlable puisque ses paramètres ont été définis (Scardigli, 2001).
Cependant, cette approche positiviste et essentialiste tend à considérer la technique et la science comme « une force autonome située en dehors de la Société, une sorte de seconde nature affectant la vie sociale à partir du royaume de la raison » (Feenberg, 2004, p. 14), c’est-à-dire qu’elle suppose qu’il existerait une « Vérité » qui se dévoile en suivant la voie logique en n’étant guidée que par la raison. Or, comme le souligne Feenberg (Feenberg, 2004), la technique et la science sont empruntes du contexte dans lequel elles s’insèrent et qu’elles performent. L’établissement de faits scientifiques (Latour, 2006) de même que la conception technique (Latour, 1992) ne suivent pas une voie unique tracée par avance mais suivent des chemins sinueux au fil des luttes et des controverses dont ils font l’objet. Ils sont conçus à partir de choix, de compromis et de négociations. Ainsi, les objets quantitatifs et qualitatifs utilisés par les acteurs des politiques publiques territoriales ne sont pas donnés mais construits (Terrier, 2011).
Nous tenons néanmoins à signaler que dire que les « données » sont construites ne signifient pas pour autant qu’elles ne sont « pas vraies », qu’elles sont forcément biaisées ou faussées (Latour, 2007, p. 130). Pour Latour, les faits sont des faits « exacts » justement parce qu’ils sont « construits », c’est-à-dire que leur établissement nécessite de mobiliser différentes entités, humaines et non-humaines, et de s’assurer du maintien de leur inscription dans le collectif ainsi constitué (Latour, 2007, p. 131). Ainsi, comme l’affirme Melvin Kranzberg : « La technologie n’est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre… L’interaction entre la technologie et l’écosystème social est telle que les développements techniques ont des conséquences environnementales, sociales, et humaines qui dépassent de loin les objectifs des appareils techniques et des pratiques elles-mêmes. »
En ce sens, nous nous inscrivons dans une approche non essentialiste de l’information (Mayère, 2010, 40 ; Mayère et al., 2012), il s’agit de « désacraliser » (Ogien, 2013) le recours aux chiffres dans l’instru-mentation de l’action publique ; non pas pour en dénigrer l’usage, mais, au contraire, afin d’observer comment ces chiffres sont mobilisés par les acteurs comme sources d’autorité permettant de légiti-mer ou délégitimer certains acteurs humains ou non-humains. Cette approche nous permet égale-ment d’interroger comment ce recours aux chiffres participe aux assemblages socio-techniques qui se constituent par et à travers le recours aux Instrument d’Action Publique.