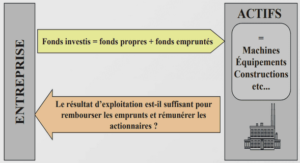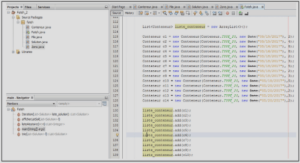Des cadres théoriques d’interprétation
Les idées et modes de raisonnement du sens commun en dynamique ont été très lar-gement étudiés par la recherche en didactique depuis une trentaine d’années (Viennot, 1978; Clement, 1982; McCloskey, 1983; Halloun and Hestenes, 1985).
Leurs analyses ont varié selon différents développements théoriques, les voyant tantôt comme des habitudes interprétatives élémentaires, déconnectées les unes des autres (« knowledge in pieces » (DiSessa, 1988)), ou tantôt comme des théories alternatives avec une certaine cohérence (Vosniadou et al., 2008). Depuis l’article de Posner et al. (1982) Accommodation of a scientific conception : Toward a theory of conceptual change, une grande quantité de réflexions a été publiée sur le sujet, comme en témoignent notamment Rowlands et al. (1999) :
• Over the past two decades, international research on student understan-ding of science concepts has produced a vast literature that has attempted to describe that understanding. Much of the research has catalogued the in-terpretations that students have of scientific concepts (e.g. Boeha 1990), and many of the researchers have attempted to explain the origins and nature of these interpretations (e.g. Bliss & Ogborn 1994). The terms alternative fra-meworks (e.g. Terry & Jones 1986), alternative conceptions (e.g. Ramadas et al. 1996), student prior conceptions (e.g. Driver 1988), misconceptions (e.g. Hestenes 1992), preconceptions (e.g. Arons 1990) and conceptual profiles (e.g. Mortimer 1995) have been used to refer to the various interpretations of scientific concepts that are at odds with the well-defined meaning of these concepts held by the scientific community. […] » (Rowlands et al., 1999)
De nombreuses synthèses de ces travaux existent déjà, dont cet article de Rowlands et al. (1999). On peut trouver également une synthèse particulièrement bien organi-sée dans la thèse de Westra (2006), portant également sur la mécanique 5. Sans nier la finesse d’analyse des différentes théories existantes, et leur pertinence pour certains types de cas, nous ne reviendrons pas sur celles-ci ici. L’absence de consensus entre ces orientations théoriques dans la communauté a plutôt incité à considérer des problèmes avec la conscience de l’étendue de la littérature sur ce sujet : « It is impractical if not impossible to give an account of what people have done to understand and improve teaching/learning mechanics that comes close to being complete. » (Westra, 2006, p.8) d’apprentissages plus basiques, en amont des raffinements des divers cadres interpréta-tifs.
Cette posture rejoint la remarque de Rowlands et al. (1999), qui poursuivent leur obser-vation précédente sur la quantité des développements théoriques, en constatant qu’ils n’ont pas réussi à aboutir à une certaine forme de paradigme, au delà de l’influence partagée du constructivisme :
• The research on the various student interpretations of scientific concepts has generated a constructivist perspective that seems to be a major in-fluence in science education (Mortimer 1995 ; Matthews 1997). However, it would seem reasonable to suppose that, after twenty years, a paradigm would have emerged that would govern an approach to ideas, theory and observation – that by now we would have established some form of structured approach to (1) the nature of student ideas with respect to the learning of science, (2) how these ideas are generated, (3) how these ideas effect the construction of scientific concepts in the class-room and (4) the steps necessary to facilitate that construction. What we have instead are the many reports that describe student understanding and much reference to philosophical issues that pertain to pedagogy, epistemology and psychology. » (Rowlands et al., 1999)
Nous ne chercherons donc pas à nous situer au sein des différents courants sur le change-ment conceptuel. Ceux-ci ont plutôt été considérés comme des points de repère pouvant aider à interpréter certaines situations concrètes, sans avoir besoin de spéculer sur leur degré de généralité 6. Au final les difficultés majeures prises pour cible dans cette pro-position d’enseignement ne nécessitent pas de se prononcer vis à vis de ces différentes théories.
Avant d’expliciter les problèmes considérés dans l’apprentissage de la dynamique, com-mençons par une synthèse des modes de pensée principaux ayant été identifiés sur les forces et le mouvement.
Idées des élèves & problèmes d’apprentissage visés
Synthèse des tendances majeures du sens commun
Quand on demande les forces qui s’exercent sur un objet ayant été jeté verticalement vers le haut, un commentaire classique d’élève est le suivant : « Pendant la montée, il y a la force de l’objet vers le haut, transmise par le lanceur ». Il s’agit d’une réponse extrêmement répandue, encore en études supérieures, et incompatible avec le point de vue physique selon lequel le poids et les forces de frottement de l’air agissent sur l’objet. Ce commentaire permet d’illustrer les tendances majeures du sens commun en dynamique (Viennot, 1978; Halloun and Hestenes, 1985) :
— Penser la force comme cause du mouvement, dans la direction de celui ci, intuitivement associée à la vitesse. (Une force vers le haut pour le mouvement vers le haut). Un mouvement à vitesse constante nécessite une force constante, et un mouvement dont la vitesse augmente nécessite une force qui augmente.
— La tendance à aller chercher une cause dans le passé, quand les forces connues ne semblent pas compatibles avec le mouvement. (Dans ce cas, comme le poids – dirigé vers le bas – semble incompatible avec un mouvement vers le haut, alors il faut quelque chose d’autre : la force qu’a donnée le lanceur, vers le haut).
— Penser la force comme une quantité que possède l’objet (la force de l’objet), qui peut être transmise, stockée et s’épuiser. (La force donnée par le lanceur). On parle parfois de « capital de force » (Viennot, 1977) .
Ces modes de raisonnement du sens commun correspondent à des tendances générales. D’autres moins répandues ont été mis en évidence, ainsi que des distinctions plus pré-cises parmi celles-ci, sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas.
Une considération importante, et qui justifie ce choix, est que les réponses d’élèves interprétées sont fortement dépendantes de la situation physique en jeu, du type de question posée, et de la formulation des réponses d’élèves. Cette dépendance inévitable au contexte a été mise en avant par Laurence Viennot dans son travail de thèse (Viennot, 1977) puis plus tard, comme le synthétise Rowlands et al. (1999) :
• A taxonomy of student conceptions may be impossible because, as Vien-not (1985) has stated, the consideration of ‘misconceptions’ requires a spe-cificity regarding the framework from which the ‘misconceptions’ occur : namely, what kind of problem prompts the misconception, what formula-tions are used in holding the misconception, and how the misconception is linked to other forms of reasoning. » (Rowlands et al., 1999) Viennot (1977) proposait plusieurs catégories de situations ayant tendance à déclencher les différents modes de raisonnement qu’elle a identifiés, selon que le mouvement soit compatible ou non avec les forces « connues » dans cette situation.
• […] bon nombre d’étudiants obéissent à une nécessité intuitive de « com-patibilité » entre force et mouvement, et […] ils sont prêts à fabriquer au besoin la force nécessaire, dans le sens du mouvement si mouvement il y a, opposée aux forces réelles s’il y a « équilibre » (traduire : vitesse instantanée nulle). » (Viennot, 1977, p.71)
Cette idée de dépendance aux types de situations est également soulignée par (Rowlands et al., 1999) :
• […] the findings suggest […] that alternative ideas are context specific, that is, specific to the various forms of motion presented […]. The student’s intuitive schema of force and motion is not well defined and is specific to the dominant features of the situation — how the student perceives the dominant feature of the situation triggers his response to the situation. » (Rowlands et al., 1999)
Cette caractéristique implique pour ces chercheurs qu’il n’est pas légitime de parler d’un concept intuitif de force, et ils préfèrent ainsi la notion de « schema » 7 reliant les différents modes de raisonnement possibles selon les cas.
• An ‘intuitive concept of force’ seems to suggest a concept that is fairly well formed ; whereas it might well be the case that instead of a concept of force, we have a schema of loosely related and poorly differentiated concepts formed from spontaneous reasoning. » (Rowlands et al., 1999)
C’est en s’appuyant sur cette considération qu’ils critiquent l’idée de « changement conceptuel » pour le cas de la mécanique. Si l’on ne peut pas parler d’un « concept intuitif de force », alors il n’est pas légitime de voir l’apprentissage de la notion physique de force comme l’évolution d’un « concept intuitif » vers un « concept scientifique », dont la caractéristique est d’avoir une définition unique et précise, s’appliquant pour toutes situations.
Dans ce travail, les « idées du sens commun sur les forces et le mouvement » seront consi-dérées également dans cette perspective : comme un ensemble de modes de raisonnement d’élèves, dépendant des situations considérées, s’observant de manière récurrente.