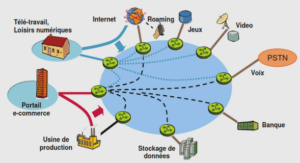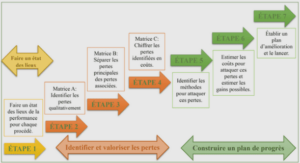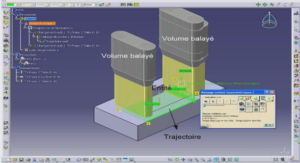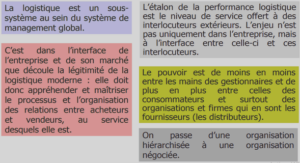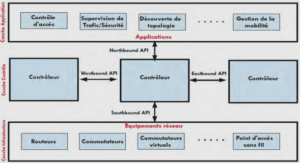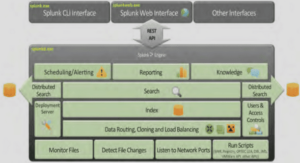Un tour d’horizon des interfaces écologiques
Read, Salmon, & Lenné, (2015) proposent un tour d’horizon des travaux sur les interfaces écologiques. Ces auteurs relèvent près de 59 travaux plus ou moins appliqués à la conception d’interfaces écologiques. Ils effectuent un classement de ces recherches selon le type de domaine concerné, à savoir, intentionnel ou causal.
La première interface écologique à avoir été réalisée fut DURESS (Dual Reservoir System Simulation). Cette interface portait sur un système de réservoir et de chauffage d’un circuit d’eau en centrale nucléaire. Cette interface a fait l’objet d’une dizaine d’études (Orchanian, Smahel, Howie, & Vicente, 1996) (Howie & Vicente, 1998)(C. A. Miller & Vicente, 2001). Une analyse complète du domaine de travail de DURESS a été réalisée (Vicente & Pawlak, 1994).
Depuis le processus de conception écologique a été appliqué à de nombreux domaines, comme le transport, le contrôle commande d’opérations militaires, en passant par la santé ou encore l’industrie à fort volume de production. Pour le domaine de l’automobile Hilliard & Jamieson, (2008) et Stoner, Wiese, & Lee, (2003) ont développé des interfaces écologiques pour des voitures de course fonctionnant à l’énergie solaire. Ces interfaces intègrent un ensemble d’informations relatives à la gestion de l’énergie dans la voiture.
Dans le même esprit, Young & Birrell, (2012) proposent une interface écologique basée sur l’analyse du domaine de travail automobile pour favoriser une conduite économique. Dans le domaine naval, peu de travaux ont été réalisés à notre connaissance. Les quelques travaux disponibles sont ceux de Chalmers, Burns, & Bryant, (2001) et de Park Myung, (2012) portant respectivement sur la conception d’EID pour les situations de combats navals et la conception d’écrans radars navals. On retrouve également quelques recherches dans le domaine sous-marinier, mais ces travaux restent encore majoritairement confidentiels et donc difficiles d’accès (Judas et al., 2012).
Dans le domaine aéronautique, C. Borst, Sjer, Mulder, Van Paassen, & Mulder, (2008) proposent une interface écologique pour un système d’aide à l’atterrissage d’urgence pour les pilotes. Dans le domaine de la production énergétique, Drivalou & Marmaras, (2009) et Li, Sanderson, Memisevic, Wong, & Choudhury, (2006) se sont intéressés aux réseaux électriques. Lau et Jamieson, (2011) ont appliqué le concept des interfaces écologiques à des systèmes de réacteurs à bouilleur. Toujours dans le domaine industriel, Upton & Doherty, (2008) se sont intéressés à la faisabilité d’utiliser les EID dans les industries dites à haut volume de production.
Dans le domaine de la robotique, Kaminka & Elmaliach, (2006) proposent une interface pour superviser plusieurs robots agissant simultanément, le but de cette interface est de résoudre la question d’une meilleure prise en considération de la coordination entre les robots avec l’utilisation d’une interface écologique par rapport à une interface conventionnelle. Pour le domaine de la finance, l’on retrouve les travaux de Morineau & Billet, (2007) ; Dainoff, Dainoff, & McFeeters, (2004) et de Achonu & Jamieson, (2003).
Enfin, le domaine de la santé n’est pas en reste. Il s’agit d’un domaine en pleine expansion, avec un fort accroissement technologique. Morineau, Morandi, Le Moëllic, & Jannin, (2013) ont travaillé sur l’analyse du domaine de la neurochirurgie pour guider la conception d’interfaces écologiques. Hall, Rudolph, & Cao, (2006) ont réalisé une analyse cognitive du travail pour le domaine de l’anesthésie médicale. Jiancaro, Jamieson, & Mihailidis, (2013) dresse de manière plus générale un état des lieux de l’utilisation de l’ingénierie cognitive dans le champ médical.
Globalement, on note que la conception d’interface écologique semble s’intégrer dans de plus en plus de contextes industriels et répond à une forte demande. Néanmoins, on constate que dans la plupart des cas, la conception de ces interfaces a été réalisée par des équipes de recherche déjà expertes dans ce type de conception. De plus, il n’est jamais précisé le temps de conception nécessaire pour aboutir à une interface écologique finale même si ce temps semble particulièrement long au vu du travail à fournir et dépendent de la taille et de la complexité du système à évaluer. Vicente, (2002) précise d’ailleurs que l’un des challenges de la conception des interfaces écologiques pour le futur est de chercher à réduire ce temps nécessaire à l’analyse à travers une meilleure intégration à l’échelle industrielle.
De nouvelles perspectives pour la conception écologique d’interface
Au-delà de ces approches aujourd’hui classiques des interfaces écologiques, plusieurs travaux ont abordé de nouvelles déclinaisons de la démarche.
Des interfaces écologiques aux modalités perceptives variées
Watson & Sanderson, (2007) proposent l’utilisation du son comme modalité perceptive pour l’interaction entre l’humain et le domaine de travail. En effet jusqu’à lors, seule l’utilisation de la modalité visuelle était utilisée pour représenter les contraintes de l’environnement. Ils vont proposer pour concevoir une interface écologique de supervision en anesthésie, d’utiliser des données physiologiques et de représenter l’information issue de l’analyse du domaine de travail à l’aide d’objets sonores. Ces objets sonores sont caractérisés par des critères comme le pitch, la clareté, le timbre, l’amplitude, la résonance, la réverbération, le vibrato ou le trémolo d’un ton. Burns, Ho, & Arrabito, (2011) démontrent que le choix de la modalité perceptive est important pour concevoir une interface écologique. Ils proposent un guide pour aider au choix de la modalité perceptive (visuelle, tactile ou sonore) à utiliser selon le type de besoin informationnel. (Tableau 10), puis l’applique à un système de contrôle de drone.
Des interfaces écologiques aux formats d’affichages divers
Le format de l’affichage est également une question importante avec la démultiplication des formats d’écrans. Du très grand écran de salle de commande aux espaces de visualisation très restreints (tablettes numériques, smartphones) en passant par des écrans d’ordinateur, plus conventionnels (écran 21 pouces), la palette d’espace de visualisation est importante. La question de l’intégration visuelle de l’information (voir page 48, chapitre 1) est un point important dans les principes sous-jacents à une bonne conception écologique.
Mazaeva & Bisantz, (2014) ont mené des recherches sur les écrans de petite taille et ont comparé la conception d’une interface écologique en intégrant toutes les informations sur un écran par rapport à la représentation de l’information sur plusieurs écrans. Ils montrent que les performances des utilisateurs sont meilleures lorsque l’information est intégrée sur un même écran. Se basant sur ces résultats, ils proposent des recommandations pour la conception d’interfaces écologiques pour les écrans de petite taille comme les smartphones ou les écrans d’appareil photo.
La première de ces recommandations est que les concepteurs devraient regrouper les informations du système sur les écrans, sur la base des relations fonctionnelles du système. Il est préférable de concevoir un écran qui sera robuste et en mesure de faire face à la plupart des tâches que de développer un écran par tâche à réaliser.
La seconde recommandation est que les concepteurs se doivent de regrouper sur un écran les informations liées aux différents niveaux d’abstractions, sur la base des relations fonctionnelles, en s’appuyant sur la matrice de domaine de travail. Enfin la dernière recommandation et que les concepteurs doivent sélectionner un pattern de forme visuelle homogène, pour la conception d’interfaces de petite taille, ce qui rejoint l’idée de proposer une bibliothèque de représentation écologique pour assurer des interfaces écologiques de bonne qualité.
Burns, (2000) a étudié la question de l’intégration de l’information et des différents niveaux d’abstraction à travers un ou plusieurs écrans. Elles montrent que pour obtenir des meilleures performances en termes de temps de détections d’erreurs, et de diagnostiques de fautes, il faut idéalement favoriser une interface écologique avec à la fois un haut niveau de proximité spatiale et à la fois un fort niveau de proximité temporelle.
La notion de proximité spatiale se définit par le fait que les éléments d’informations doivent être plus rapprochés spatialement. La notion de proximité temporelle est liée au timing de présentation de l’information. . Ainsi un haut niveau de proximité spatiale et un haut niveau de proximité temporel se traduisent par des informations proches spatialement et affichées en même temps. Appliqué à une interface écologique une forte proximité spatiale et une forte proximité temporelle se traduisent par un affichage de tous les niveaux d’abstraction au même temps et sur le même écran. Pour arriver à une telle représentation Burns, (2000) utilise la technique graphique du contexte en arrière-fond (Figure 43).