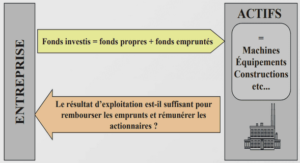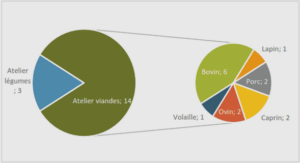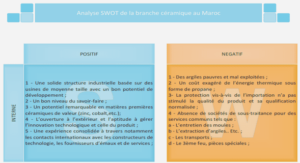La reprise des codes graphiques des publications de presse britannique
Une des manières utilisées dans Broadchurch pour représenter la presse britannique, en particulier la presse écrite, repose dans sa reprise des codes graphiques des publications de la presse. En particulier, trois unes du Herald15 apparaissent à l’écran et nous semblent reprendre les mises en pages16 de grands journaux nationaux britanniques qui visent le « middle-market » ou marché intermédiaire de la presse écrite en Grande Bretagne : le Daily Mail et le Daily Express17. Lorsqu’on compare les 3 unes du Herald aux unes de ces journaux, il est clair qu’elles reprennent directement leurs codes graphiques. La première une18 est celle de l’interview des Latimer, en particulier de Beth, au sujet de Danny. On y retrouve le même nombre de niveaux de lecture que dans la une du Daily Express (« Maddie ‘died’ in apartment ») : tout d’abord le bandeau situé tout en haut de la page, comme bandeau « promotion » du journal, en dessous duquel on trouve la manchette du journal. Il est intéressant de noter que les deux journaux ont une identité graphique très similaire : leur logo est écrit en capitales, avec une typographie didone (aux empattements rectilignes) en noir, dont l’insigne rouge est situé entre les deux mots qui composent le logo. D’ailleurs, la proximité graphique de ces deux insignes renforce la comparaison19 : le bouclier et la lance du « crusader » (croisé) d’un côté, le cheval et la lance de l’autre créent les mêmes connotations liées au Moyen-Âge. Or, le « crusader » du Daily Express est un symbole connu en Grande Bretagne et fait partie du paysage médiatique (fondé en 1900, le Daily Express a fait partie des journaux les plus vendus en Grande Bretagne dans les années 1990, bien que sa diffusion soit en déclin aujourd’hui20). Cela contribue donc à inscrire le Herald dans la catégorie des journaux intermédiaires, par des connotations et un « effet de réel » lié à l’importance de l’attention aux détails21. Cet effet de réel concerne tout le reste de la une que nous étudions : la une du Daily Express et celle du Sunday Herald ont toutes les deux un encadré coloré situé sous la manchette, avec une ou plusieurs photos, qui renvoient aux pages intérieures du journal. On trouve dans les deux cas sous cet encadré le gros titre, réalisé avec les mêmes caractéristiques : en gras, capitales, d’une très grande taille (entre un quart et un tiers de la page), avec une typographie didone noire. Une photo en couleur est ancrée en bas à droite de la une, et est quasi-systématiquement le portait d’une personne. En bas à gauche de ces unes, on retrouve le sous-titre, et le début de l’article en deux colonnes. De la même manière, il est aisé de trouver de nombreuses similitudes entre cette une du Herald et la une du Daily Mail représentée en annexe (« Did a Facebook Friend Kill Jo? »). En particulier, nous pouvons souligner l’utilisation du terme « exclusive » dans le sous-titre, que l’on retrouve souvent dans ce type de publication. Il nous semble donc clair ici que le Herald fait directement référence aux journaux intermédiaires britanniques que sont le Daily Mail et le Daily Express. Par cet effet de réel et grâce à cette référence, Broadchurch permet la projection des spectateurs dans la réalité de la communauté du village. Le spectateur peut aisément se mettre à la place et s’identifier à un habitant de Broadchurch qui va lire ce journal. La même comparaison peut se faire avec les deux autres unes visibles dans la série. Ainsi la seconde une mise en scène22, qui titre « I did not kill your son » sur une photo de Jack Marshall prise par un paparazzi, rappelle les unes du Daily Mail ou du Daily Express que nous présentons en annexe. Celles-ci prennent pour sujet des personnages actuels « ennemis » du grand public, tels qu’Oussama Ben Laden ou des personnes accusées d’être responsables de la mort de Lady Diana, ou dénoncent un « horrifiant » scandale de vente de données de retraites à des arnaqueurs. Dans ces unes autant que dans celle de Broadchurch, l’utilisation d’une typographie didone en capitales, en gras, blanc sur fond noir et qui prennent plus de la moitié de l’espace de la une donnent un caractère dramatique et exceptionnel aux sujets traités. La large présence du noir peut ici être associée à la peur et à la mort, ainsi qu’au deuil. La ressemblance entre la une du Daily Mail (« Your pension secrets sold to conmen for 5pence ») et celle du Daily Herald est particulièrement frappante : le texte est situé sur la photo au fond noir, et l’accusé apparait à droite du texte. Les deux personnes sont ici comme prises sur le vif (pour Jack Marshall, nous savons que c’est une photo prise par un paparazzi). Le début de l’article est situé en bas de page, sur moins d’un quart de la une. Les deux unes mettent en avant en rouge de manière similaire les termes « exclusive » ou « investigations unit » sous le gros titre. L’ensemble de ces éléments crée une atmosphère sombre et inquiétante. Enfin, la troisième une mise en avant dans la série, dans l’épisode 6 au lendemain de la mort de Jack Marshall, peut aussi être comparée à des unes du Daily Mail ou du Daily Express23. Nous n’entrerons pas dans une analyse plus poussée de cette une, dans la mesure où elle est assez similaire à la première une du Herald (« My Danny »).
Le Daily Mail et le Daily Express sont des qui journaux se distinguent à la fois des journaux « de qualité » (comme le Gardian, le Times…) et des quotidiens populaires (tels que le Daily Mirror ou le Sun). Selon Jean-Claude Sergeant, dans Les Médias Britanniques, cette catégorie de journaux est constituée de « titres hybrides, plus proches des titres populaires que de ceux dits de qualité, tout en se distinguant des premiers par le contenu et la nature de leur lectorat. »24 Or, si le Herald n’est pas un journal aujourd’hui publié en Grande Bretagne, il a véritablement existé jusqu’en 1964. Pour Jean-Claude Sergeant, ce concept de journal intermédiaire « permet utilement de répertorier, rétrospectivement, des titres comme le News Chronicle et le Daily Herald »25. Nous pouvons donc conclure que les choix effectués par la production de Broadchurch pour la représentation de la presse écrite, tant en termes d’identité visuelle et de graphismes que de choix du nom du Herald lui-même, l’inscrivent directement dans cette catégorie, qui touche une large portion de la population qui donne beaucoup d’importance à la presse
Si la presse britannique est l’une des plus importantes dans le monde27, elle fait face des difficultés économiques qui mettent sous pression les rédactions et les journalistes, contraints à limiter les coûts et à toujours se plier aux attentes du lectorat. Dans une tribune en 2009, Jeremy Dear déplorait les conditions économiques qui limitent le pouvoir de la presse et son devoir vis-à-vis de la démocratie: « Almost one in four jobs in local newspapers have gone. Thousands of jobs have gone across national newspapers (…). Dozens of local media offices have closed, removing journalists from the communities they serve. »28 Or, Broadchurch décrit largement ces conditions économiques difficiles, notamment à travers les situations d’Olly et Karen. Dès le premier épisode, au bout de 13 minutes, nous avons un aperçu de la difficulté pour un jeune journaliste de trouver un emploi dans une grande rédaction : Olly reçoit un mail au sujet de sa candidature non retenue en tant que reporter junior au Daily Mail. Sa réaction, ainsi que celle de Maggie, rédactrice en chef du Broadchurch Echo et mentor d’Olly, sur un fond de musique aux accents tristes et dramatiques, laisse imaginer au spectateur les difficultés qu’il rencontre dans ses recherches. Son échange avec Maggie (Maggie: « There’s plenty of other newspapers » / Olly: « I’ve tried them all now! » / Maggie: « You’re good petal. Your time will come. ») 29 souligne que ce n’est pas le premier refus qu’il essuie. Les premières minutes de la série plantent le décor pour Olly : c’est un jeune journaliste qui lutte pour s’installer durablement dans le métier et entamer une carrière sur le plan national, comme beaucoup d’autres.
Mais les difficultés économiques touchent également les grandes rédactions : Bob Franklin et Matt Carlson parlent de « crisis of financial viability » (« crise de viabilité financière »)30. Ainsi, dans Broadchurch, Karen est obligée de se justifier à de nombreuses reprises et d’aller contre les instructions de son rédacteur en chef pour se rendre à Broadchurch et écrire sur le meurtre de Danny Latimer. Dans le premier épisode (à partir de la 34e minute), alors qu’elle demande à aller sur place pour traiter le sujet, son rédacteur en chef refuse, notamment parce que cela coûterait trop cher. Il lui demande de passer par une agence et de « pimenter » l’histoire (« jazz it up ») depuis la rédaction à Londres. Ce phénomène est notamment évoqué par Jean-Claude Sergeant : « on peut prévoir que les rédactions de demain ne compteront plus qu’un nombre réduit de journalistes permanents qui assureront la mise en forme et le maquettage des pages du journal, l’essentiel de l’information étant fourni par des agences et des journalistes indépendants »31, et ce pour des raisons économiques. Face à cette réaction de son rédacteur en chef, Karen insiste, en expliquant que tout ce qu’elle fait ces derniers temps est de « polir des communiqués de presse » (« polishing press releases »). Cette autre facette du journalisme britannique limité par ses ressources financières est aussi évoquée par Jeremy Dear (cité par Franklin et Carlson) : « As a result [of job cuts and newspaper closures] local and national democracy is suffering (…). Journalists are increasingly stuck in offices rewriting press releases relying ever more on corporate or celebrity PR ».32 La situation de Karen semble donc être caractéristique de celle de nombreux journalistes britanniques, ne pouvant plus aller sur le terrain et devant se contenter de réécrire des communiqués de presse. C’est d’ailleurs ce qu’elle explique dans le premier épisode avant d’apprendre la mort de Danny : « I’ve got this Department of education press release. I’ve gotta try and sound like it’s essential news, and it’s barely even in English »33. Ici, la journaliste d’un grand journal national n’a pas beaucoup de liberté pour choisir ses sujets, et n’est pas convaincue elle-même de la pertinence de son travail. Cela reflète dans une certaine mesure la réalité de certains journalistes britanniques, pour qui la politique éditoriale de leur journal influence largement leur travail.34 Cette situation étant bien sûr d’autant plus précaire à cause des suppressions d’emplois et donc de la difficulté de faire valoir sa volonté de sortir des sentiers battus.
Il est donc clair que la représentation des journalistes dans Broadchurch a été pensée de telle manière à être fidèle aux conditions économiques réelles des journalistes britanniques. Mais au-delà de cette représentation économique, il semble que les journalistes mis en scène eux-mêmes permettent de dresser un portrait nuancé du journalisme britannique aujourd’hui.
Olly, Karen et Maggie : trois profils de journalistes différents
Les trois journalistes présents dans la série correspondent à trois profils distincts qui apportent chacun des éléments d’informations sur le journalisme britannique et qui servent largement l’intrigue de la série. Le premier est Oliver Stevens (« Olly »), le journaliste « bleu » qui cherche à faire ses preuves. Il correspond parfaitement à la catégorie de « Cub reporter »35 définie par Joe Saltzman : « Beginning reporters make the same mistakes in silent films as they do in (…) television programs. The cub reporter is the one journalist with whom everyone in the audience can identify. He or she knows nothing about journalism (…), so the cub can ask all the questions that the audience wants to know. When veteran journalists correct the cub, either the audience laughs with knowing derision or learns something. It is a win-win proposition, and it makes for an easy plot device lo let the cub find out what the audience already knows or wants to know. »36 Il est en effet celui qui permet au spectateur de comprendre comment fonctionne la rédaction d’un journal et il crée l’opportunité de présenter au spectateur ce qu’est une « good story », un bon sujet d’article. Ses questions à Maggie et à Karen sont également les questions du spectateur et il partage toutes ses occasions d’apprentissage avec lui. Par exemple, dans l’épisode 5, alors qu’Olly et Karen relisent l’article rédigé par Olly sur Jack Marshall, Karen lui explique quels détails manquent dans son article :
Karen: « Tell them where the news agent was in the town, how close to where the body was found. What, quarter of a mile? »
Olly: « No actually his house is a lot closer than that, it’s literally on top of the beach. »
Karen: « And you haven’t put that in there?»
Olly: « Didn’t think. »
Karen: « Thinking definitely helps, Olly.»37
Cet échange, et plus généralement l’ensemble de cette scène, donnent au spectateur un aperçu du travail qu’implique la rédaction d’un article par un journaliste. Tout au long de la scène, elle retravaille son article et donne ainsi à Olly et au spectateur une partie des clés de la rédaction de l’article. Cette scène fonctionne aussi comme un ressort comique, comme le précise Joe Saltzman (« Thinking definitely helps, Olly. »).