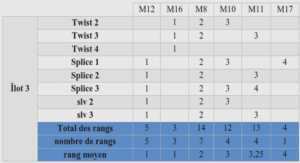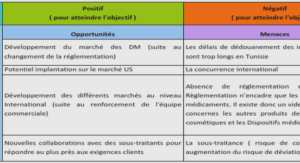Un parcours sociologique, des animaux emblématiques à la biodiversité
J’ai profité d’un congé parental pour quitter la Lorraine et me rapprocher des Alpes. J’ai été nommée en février 1993 à l’Institut national des études rurales montagnardes (Inerm) . L’Inerm était alors composé de quatre secteurs ; celui que je devais rejoindre, dénommé « Territoires », avait pour responsable Jacques Perret et était composé d’économistes du développement, qui étudiaient notamment les modes de développement touristique et la pluriactivité. Devant moi-même travailler sur les flux économiques entre les territoires, je me suis procurée quelques livres de référence en économie mais, au bout de quelques semaines, j’ai dû admettre que je ne parvenais pas à « accrocher ». Je m’en suis ouverte à Jacques Perret, qui m’a donné carte blanche pour aborder les territoires montagnards comme je l’entendais. Je ne crois pas que j’aurais pu bénéficier ailleurs d’une telle compréhension ni d’une telle liberté. Comme l’Inra, l’Inerm était alors engagé dans un suivi pluridisciplinaire de la mise en place de l’article 19 dans le Var, le Jura et en Margeride lozérienne. Un volet sociologique avait été prévu ; j’en ai été chargée. C’est ainsi, sans la moindre préparation, que je suis partie en enquête. Au cours de ces premières années, j’ai également travaillé sur les stations de sports d’hiver, sous la houlette de Jacques Perret.
J’ai mené avec lui des enquêtes approfondies dans plusieurs communes et nous avons notamment rédigé ensemble un rapport sur « les fondements historiques des difficultés actuelles des stations de sports d’hiver ». Quelques-unes des orientations de ces travaux de jeunesse ne se sont pas démenties. Je retrouve l’intérêt pour les rapports des gens à la nature et, plus précisément, le questionnement sur leurs réactions à un changement de la nature ou de leur rapport à la nature. Je retrouve aussi le goût pour l’approche historique et pour les histoires, que l’on recueille et que l’on raconte. Je retrouve encore l’importance décisive accordée à l’enquête de terrain. Je n’avais certes que le terrain auquel me raccrocher puisque les courants et les auteurs sur lesquels j’aurais pu m’appuyer m’étaient totalement inconnus. Mais mes lectures et mes progrès en sociologie n’y ont rien changé, au contraire : le terrain continue de venir en premier. Sur d’autres points, on le verra, mes idées ont sensiblement évolué.
Une formation tardive à la recherche en sciences sociales
Désireux que le Cemagref puisse être reconnu comme un Établissement public à caractère scientifique et technologique (Epst) à part entière, ses responsables poussaient les jeunes ingénieurs mis à disposition par le ministère de l’agriculture à acquérir une véritable formation à la recherche et à entreprendre un cursus universitaire. J’ai donc été incitée à m’inscrire en Dea puis en thèse. J’ai opté pour le Dea « gestion des espaces montagnards » de l’Institut de géographie alpine, à la fois pour des raisons pratiques et parce que nous avions des liens étroits avec plusieurs enseignants-chercheurs de l’Iga, avec lesquels nous partagions des interrogations sur les « systèmes territoriaux ». J’ai décidé de contribuer à l’analyse territoriale telle qu’elle était pratiquée à l’Inerm en démontrant que l’attachement des gens aux territoires se constitue dans leurs relations à des éléments particuliers et que ces éléments ne sont pas nécessairement dotés d’une grande valeur marchande. Je ne voulais donc choisir pour objet d’étude ni les stations de sports d’hiver ni les troupeaux domestiques, sur lesquels travaillaient mes collègues, ni la forêt, que je connaissais un peu.
La quête d’éléments du territoire à la fois importants dans la formation d’attachements entre des gens et des lieux et économiquement marginaux m’a conduite aux ongulés sauvages, dont j’avais repéré la place dans les discours et les pratiques d’une partie des montagnards. J’ai donc enquêté sur « le rôle du chamois et du bouquetin dans la configuration symbolique de l’espace en Vanoise », sous la direction de Bernard Debarbieux. La perspective théorique et l’objet retenu étaient totalement absents des travaux antérieurs du Cemagref. À l’aune de ma petite expérience, celui-ci se révélait à nouveau très différent d’une image qui me semble assez répandue, à l’université et dans d’autres Epst, selon laquelle les relations seraient au Cemagref fortement hiérarchisées et les études menées essentiellement appliquées et dictées par la possibilité d’obtenir des financements. À la suite de mon Dea, Daniel Terrasson, chef du département « Gestion des territoires », m’a encouragée à poursuivre en thèse, en sociologie plutôt qu’en géographie, en me conseillant de m’adresser à Raphaël Larrère. J’ai rencontré pour la première fois Raphaël Larrère au colloque d’Aussois sur les sciences sociales et les espaces protégés, en 1997, et il a aussitôt accepté de diriger ma thèse.
Celle-ci s’est en partie inscrite dans la continuité du Dea, dans la mesure où j’ai continué à travailler sur le chamois et le bouquetin et où la question spatiale n’a pas cessé de m’occuper. Je me suis notamment intéressée aux conceptions de mes interlocuteurs sur « la juste place des animaux » (Mauz, 2002) et à la façon dont ils mobilisent les animaux et les rapports aux animaux pour faire et défaire des liens entre des gens et des lieux. Mais j’ai cessé de faire référence au territoire et je me suis centrée sur le rôle des animaux dans la construction des rapports sociaux, avec le souci constant de montrer que, loin d’être seulement parlés et agis, les animaux interviennent activement dans les rapports entre les hommes. Il s’agissait de ne pas verser dans le « sociocentrisme », selon le terme de Raphaël Larrère (Larrère, 1999), qui m’a par ailleurs convaincue d’intégrer dans ma réflexion l’arrivée des loups dans mon terrain d’étude, en dépit de mes préventions initiales.