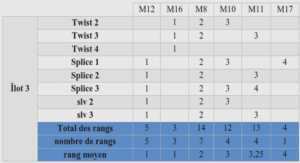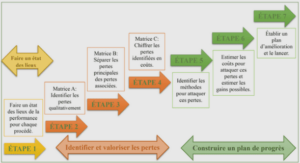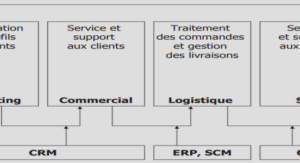Un organe représentatif de l’État a priori inamovible
Que vaut, dans l’ordre juridique français, la présomption de représentativité que la coutume internationale reconnaît de plein droit au ministre des Affaires étrangères ? Son caractère coutumier est-il de nature à faciliter sa prise en compte par la pratique constitutionnelle française ou constitue-t-il, au contraire, un obstacle rédhibitoire dans un représentative du Gouvernement2540 et, d’autre part, la conception large promue en ce domaine par la pratique internationale. Leur résolution s’annonce pour le moins périlleuse dans le cadre doctrinal français où la question de l’assujettissement de la Constitution par des normes extérieures suscite un profond « malaise et même des craintes quant à la survivance 2004 par le président américain George W. BUSH, elle s’inscrit dans le cadre de la guerre internationale contre le terrorisme. Sa logique plus messianique que véritablement légale a été diversement reçue par la Communauté internationale, notamment, par la France sous la présidence de Jacques CHIRAC. Elle a été vivement combattue par le ministre français des Affaires étrangères de l’époque, M. Dominique de VILLEPIN, dans un marquant plaidoyer pour le respect du droit international des conflits, prononcé le 14 février 2003 devant l’O.N.U. de la République »2541. Toutefois, cette inquiétude peut être facilement levée par l’invocation du principe d’autonomie qui articule les ordres juridiques interne et international. La doctrine française l’interprète majoritairement en faveur du primat du droit interne sur le droit externe : « le droit international n’est partie intégrante du droit interne qu’en vertu d’une disposition constitutionnelle du droit interne ; il ne vaut donc pas comme droit interne en vertu de sa juridique se veut pacifique car il en va de la pérennisation des relations politiques des États. Ce n’est, donc, pas dans un rapport d’opposition que l’on propose d’inscrire la réflexion sur les sources externes hypothétiques de la pratique diplomatique française mais plutôt dans un rapport de subsidiairité.
L’étude historique de l’action du ministre des Affaires étrangères a été l’occasion d’apprécier les logiques consensualistes et pragmatiques qui soustendent la politique juridique extérieure de la France depuis l’Ancien Régime. A cet égard, elle s’inscrit en faux contre une perception manichéenne de l’articulation des droits positifs qui l’enserrent dans l’ordre juridique interne et international. Dans cette optique, il sera question d’apprécier le degré d’influence – et non de contrainte – du droit international coutumier sur la conception juridique interne de la fonction de ministre des Affaires étrangères. Cette démarche prend appui sur le paradoxe qui a servi de postulat à l’étude de la fonction ministérielle sous la Vème République, à savoir le flou normatif qui entoure sa représentativité malgré l’importance politique que cette dernière revêt en pratique. Sur ce point, on a vu que le silence de la Constitution avait été instrumentalisé principalement par le président de la République au point que le ministre des Affaires étrangères est présenté par la doctrine majoritaire comme discordantes se font entendre parmi les internationalistes. Le juriste allemand Heinrich TRIEPEL admet, dans certaines circonstances, que « le droit interne [est] permis par le droit international ». Sa position est pour le moins radicale : « On reconnaît à l’État le « droit » d’organiser sa Constitution comme il l’entend, d’édicter des lois pour ouvrir et fermer ses frontières aux personnes et aux choses, de réserver législativement le cabotage ou la pêche côtière à ses sujets, de déterminer le domaine d’application personnel et « territorial » de ses normes, etc… On doit d’élever là contre. Il ne peut jamais être question ici d’un « droit » » [Droit international et droit interne, Trad. par René BRUNET, Bibliothèque Française de Droit des gens de la Fondation Carnegie, Éd. A. Pedone (Paris), Imprimerie de l’Université (Oxford), 1920, p. 379].
En marge des textes, ce sont souvent des usages mi-politiques, mi-juridiques qui ont suppléé les vides normatifs afin de situer le ministre dans la conduite de la politique extérieure ou qui ont, simplement, éclairé des dispositions obscures ou ambiguës. Dans une perspective complémentaire, la dichotomie envisagée dans la présente Section conduit à réfléchir sur l’éventuel apport des pratiques coutumières internationales à la conceptualisation du rôle constitutionnel du ministre des Affaires étrangères sous la Vème République. A cette occasion, il ne sera pas question de se lancer dans un débat général sur le caractère moniste ou dualiste de l’ordre juridique français mais d’apprécier la perméabilité de la pratique constitutionnelle à ce progrès du droit international que constitue l’ouverture de la Au final, l’enjeu soustendu par le consensualisme juridique qu’inspire la représentativité du ministre des Affaires étrangères pourrait être problématisé de la manière suivante : le chef du Quai d’Orsay peut-il trouver dans le conditionnement international des relations diplomatiques des États, des exigences fondamentales qui seraient de nature à transcender les contingences politiques internes, et partant, à légitimer son statut privilégié de représentant de l’État à part entière? La réponse à ces interrogations suscite un raisonnement en deux temps. L’hypothèse d’une immutabilité de la fonction de ministre des Affaires étrangères prenant sa source dans le droit international coutumier..