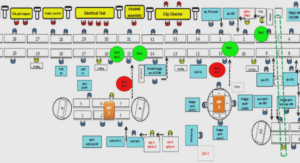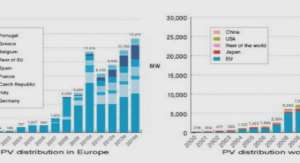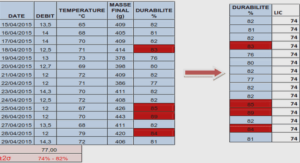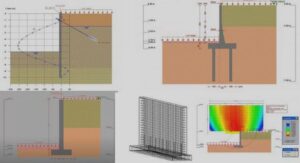La faculté de médecine
Cette année-là, ma grande sœur Yvette qui vivait depuis longtemps aux États-Unis d’Amérique et qui était ma deuxième mère lorsque j’étais tout petit, arriva au Cameroun. Elle, comme toute la famille, était très contente de ma réussite au baccalauréat et c’était la fête à la maison. Moi qui étais considéré comme un enfant presque à la dérive sur le plan éducatif, je renaissais tout simplement de mes cendres. Ils se posaient maintenant une question de mon devenir : « quelle filière me conviendrait le mieux après l’école ? »
J’étais déjà inscrit à NGOA-EKELLE et j’y allais de temps en temps faire des cours, mais la réflexion était permanente à la maison pour essayer de me trouver une voie. C’est ainsi que mes parents, qui nourrissaient toujours le rêve de voir un de leur fils médecin, commencèrent à me proposer cette idée-là qui ne m’enchantais pas beaucoup. Me lancer dans une école de médecine était un peu comme une sorte d’humiliation. Au fil des jours, cette idée ne fit que germer et tout le monde commençait à me dire que l’idéal aurait été vraiment que je fis les concours pour entrer en faculté de médecine. Ce que je persistais à refuser, étant plus enclin à évoluer dans une discipline technologique.
C’est ainsi que je décidai de présenter le concours d’entrée à l’école nationale supérieure polytechnique ainsi que celui de l’école des travaux publics, concours auxquels j’échouai. Mes parents me mirent donc face à cette impasse et m’indiquèrent qu’il fallait que je commence des cours de préparation au concours du CUSS (aujourd’hui FMSB). On me demanda donc de me renseigner à ce propos, ce que je fis, et je leur annonçai que ces cours coûtaient 50 000 FCFA/mois. Ils me remirent donc l’argent pour m’inscrire. Chaque matin, lorsque je sortais de la maison, je n’allais pas au cours bien évidemment. J’avais utilisé l’argent à d’autres fins, et je me rendais au lycée de Tsinga, histoire d’étudier afin d’avoir bonne conscience. Juste après, je me rendais au domicile de mon ami Cédric, dans le même quartier, ou alors dans une salle de jeux vidéo, question de perdre un peu de temps avant de rentrer. Lorsque je rentrais et qu’on me demandait comment se passent les cours, j’expliquais que tout allait à merveille. Vint alors le jour du concours du CUSS. J’allai composer sans grande conviction et le résultat était bien sûr implacable : j’échouai ! Mes parents décidèrent de passer au plan B, parce qu’il fallait courir contre la montre. Il ne fallait pas que l’année 2007 se terminât sans que je ne fusse dans une école professionnelle. Ils se renseignèrent chez une amie à ma sœur qui vivait à Madagascar, et elle leur parla d’une faculté de médecine là-bas en leur transmettant les informations y afférentes. On débuta la confection des dossiers, mais une fois de plus, les délais nous tenant à la gorge, ce fut un échec une fois de plus.
C’est alors que, mon père reçut une information selon laquelle il existait aussi une faculté de Médecine à l’Ouest-Cameroun. Nouvellement créée mais déjà opérationnelle, il s’agissait de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé de l’Université des Montagnes, dans l’Ouest du Cameroun plus précisément dans le département du NDE. La date du concours pour intégrer cette institution étant très proche, mon père me demanda donc de commencer à préparer ce concours-là car, en réalité il tenait absolument à ce que je continue mes études au Cameroun. De ce fait, avoir une autre faculté de médecine toujours au Cameroun était une aubaine pour ce dernier.
C’est ainsi qu’un vendredi, la veille du concours, je me rendis à Bangangté, ville dans laquelle je n’étais jamais allé. J’ai un oncle qui y vit depuis des années. On me donna ses coordonnées parce que c’est chez lui que je devais résider lorsque je serais arrivé, pour le concours qui devait avoir lieu le lendemain matin. J’arrivai dans la ville aux environs de 17h30. La première chose qui me frappa, c’était le froid glacial qui m’accueillit et surtout la terre rouge, les motos et l’absence de taxis. J’empruntai une moto à destination du domicile de mon oncle. Une fois sur place, je l’appelai et il vint à ma rencontre. Il me fit installer dans une chambre et toute sa famille m’accueillit très chaleureusement. Toute la nuit, je révisai avec les quelques petits documents que j’avais pris avec moi, mais sans une réelle motivation. Très tôt le matin je me levai, autour de 6 heures. Je devais me laver pour aller au campus, mais il fallait affronter un obstacle et non des moindres : se laver avec une eau glacée dans un climat glacial. Une équation assez compliquée. Je versai quelques gouttes d’eau sur mon corps, avant d’enfin prendre mon courage à deux mains et verser la bassine d’eau sur moi. J’eus l’impression à ce moment-là que mon cœur allait cesser de battre, tellement l’eau était glacée. Je finis rapidement de me laver, m’habillai et pris un petit-déjeuner. Après quoi, je me mis en quête d’une moto afin de me rendre au campus, celui de « Mfetum ».
Une fois sur place, je découvris une université de la forme d’un petit lycée. Même le lycée classique et moderne d’Ebolowa où j’avais terminé mon secondaire, était bien plus grand et plus imposant, pour ne pas dire plus impressionnant. Je commençai même dès cet instant à me questionner sur l’effectivité d’une formation de médecin dans un cadre pareil. Nous étions près de 700 étudiants à postuler, et après que j’eus regardé mon numéro de salle au babillard, je me dirigeai vers ma salle. À ma grande surprise, j’y rencontrai ma copine avec laquelle j’étais en classes de Première et Terminale et que j’avais perdu de vue juste après. Elle aussi se présentait au concours. Nous échangeâmes chaleureusement et quelques temps après, aux environs de 8h, tous les candidats furent invités à rejoindre leur salle de classe pour le début des épreuves. Il y en avait trois, une épreuve de physique, une épreuve de chimie et une épreuve de biologie. Je compose simplement, sans grand plus ou motivation, et à la fin de la journée, je remets mes feuilles. Après le concours, je rentrais à Yaoundé le lendemain. Deux jours plus tard, nous fumes informés que les résultats venaient de sortir. Je consultai alors les résultats en ligne sur le site internet de l’Université et me rendis compte que je n’avais pas réussi. Malgré tout, j’étais tout de même sur liste d’attente. Je passai donc la nouvelle à mon père. Il me demanda de le suivre afin qu’on aille au bureau de relai de l’université à Yaoundé, parce qu’il souhaitait savoir ce qu’on faisait des élèves sur cette liste. Dès qu’on y arriva, il présenta la situation et le responsable de ce bureau l’informa qu’il aurait fallu payer la première tranche au plus tôt pour que j’eusse pu intégrer l’école et commencer les cours dès la semaine d’après.
Je n’en revenais pas !
Mais, j’avais encore un dernier espoir. En effet, les frais de scolarité dans cette université s’élevaient à 1 000 000 FCFA (un million de FCFA) chaque année, dont la première tranche et l’assurance représentaient près de 600 000 FCFA. Et à cette époque-là, mon père qui avait déjà pris sa retraite, était financièrement essoufflé. Alors, d’une part, je savais qu’il ne pourrait pas payer. Lorsque je dis donc à mon père que la scolarité coûtait trop chèr, il me dit : « on va se battre pour payer, qu’importe la manière, tu dois devenir médecin ».
Il rentra me laisser à la maison et ressortit immédiatement après. Je discutai avec ma mère qui me fit comprendre que, si c’était vrai que la situation économique est assez morose à la maison, ils allaient faire tout leur possible afin que j’intégrasse dans cette école. Ce même jour aux environs de 20h, le klaxon de la voiture de mon père annonça son retour. Je montai lui ouvrir le portail, et il se gara dans la cour. Après être sorti de sa voiture, il s’approcha de moi et me dit : « tu vas à Bangangté demain. Voici la facture, j’ai effectué le paiement à la banque tout à l’heure ». J’avais l’impression de mourir de l’intérieur, je me disais que tout était terminé. Ce que je redoutais tant prenait désormais forme. Me voilà qui allait faire médecine. Il demanda à ma sœur Michèle de préparer le nécessaire pour m’accompagner le lendemain à Bangangté. Il avait déjà acheté l’indispensable et il me dit que le reste viendrait progressivement. Mon oncle qui vivait dans cette ville avait déjà trouvé un bailleur qui m’avait réservé une chambre. La nuit fût longue, je ne pus pratiquement pas dormir. Je voyais mes rêves s’évanouir peu à peu et étant totalement impuissant, je ne pouvais que subir les choses.
Le matin, au réveil, ma sœur me demanda de commencer à m’apprêter. Dès que cela fut fait, mon père nous déposa à Mokolo où se trouvait l’agence de voyage CHARTER, l’une des seules à y rallier la ville de Bangangté à cette époque-là. Nous achetâmes nos tickets, entrâmes dans des bus de type Coaster, serrés comme des sardines. Cinq heures plus tard, nous arrivâmes à Bangangté. Nous nous présentâmes donc chez la bailleresse qui avait déjà réservé une chambre pour moi, et qui nous l’a fit rapidement fait visiter. C’était une petite chambre, avec une minuscule douche interne dans un bâtiment en route, sans portail et avec quatre autres chambres de ce type. Ma grande sœur m’aida à déposer mes premiers effets : une chaise, une table, un lit et le matériel indispensable pour un début : format, stylo, etc. J’avais déjà un voisin, Boris, qui était dans la chambre voisine et par coïncidence, ce voisin avait fait l’internat du LYCLAMO lui aussi, et à la même époque que moi. Il était en classe de Terminale lorsque j’étais en classe de 3e. J’étais tout de même content de voir quelqu’un que je connaissais, même très superficiellement, mais c’était déjà un repère. C’est donc lui qui m’expliqua comment ça se passait à Bangangté. Il me parla des cours, de la ville, de l’environnement, de la bailleresse, des stratégies à adopter pour survivre bref, comme le maitre d’internat l’avait fait lorsque je venais d’arriver.
Ma chambre était vide comme le Sahara : pas de télévision, pas d’ordinateur, pas de moyens de distraction, juste un lit, une table, une chaise et un réchaud à gaz. Au début, je passais donc la plus grande partie de mon temps chez Boris pour me divertir car il avait un ordinateur. J’avais quand même une PlayStation portable que j’avais achetée lorsque j’avais eu le bac. C’était mon seul moyen de distraction.
Premier jour de classe, j’arrivai au Campus, le même dans lequel j’avais fait le concours. Ce jour-là, nous devions avoir un cours d’anatomie. Le professeur, Pr KRAFT, était Français, comme plusieurs autres enseignants. En entrant en classe, je remarquai que nous étions plus d’une centaine, chacun venant d’horizons divers, chacun avec son histoire. J’étais totalement perdu, je me demandais bien ce que je foutais là, au milieu de ces élèves dont les yeux brillaient, et parmi lesquels ceux qui avaient toujours eu pour rêve de faire médecine manifestaient avec un enthousiasme certain pour ce premier cours. Moi par contre, j’étais dans les nuages. Le professeur entra en classe, et le cours se révéla tout simplement unique, incroyable de mon point de vue. Des choses à noter, à retenir, une foultitude de schémas à dessiner, maitriser, pour ne pas dire réciter et reproduire textuellement. Moi qui étais habitué à la compréhension, aux chiffres, aux statistiques, aux algorithmes, je commençai à lire à outrance et surtout à retenir puis restituer. Le professeur nous faisait comprendre qu’il fallait être capable de maîtriser au moins cinq cent fiches de dessins du corps humains par cœur chaque mois. Pour moi, c’était tout simplement la fin des temps. Comment allais-je y arriver, moi qui n’aimais pas lire ? Au secondaire, je n’avais jamais réussi à lire une œuvre littéraire au programme jusqu’à la fin, encore moins un livre de science. Je passais mon temps à faire des exercices, des démonstrations, etc. Comment allais-je m’en sortir dans un univers où il fallait lire à outrance et absorber des livres à longueur de journées ? Pour moi c’était tout simplement insoutenable !
Mais, quand je pensais aux efforts consentis par mes parents pour m’inscrire dans cette école, je compris très vite qu’il ne fallait pas qu’au-delà de leur peine et de leurs sacrifices, j’eusse pris encore le risque d’échouer, ce qui aurait été tout simplement fatal pour eux. Ils avaient eu leur trophée, ils avaient enfin leur fils qui était en faculté de médecine, la promesse d’un futur docteur au bout de sept ans. Je voyais cette lueur briller dans leurs yeux, même lorsqu’ils en parlaient à quelqu’un, et bien évidemment, je ne voulais pas les décevoir. Lorsque mes amis du secondaire apprirent que je faisais médecine, tous m’appelaient systématiquement pour se moquer de moi et me demander quel miracle se fut produit pour que le « mathématicien » se retrouvât en médecine. Je prenais tout cela sportivement sur le plan intellectuel, mais, chaque soir, lorsque je rentrais à la maison, j’essayais d’apprendre à étudier ce type de leçons, car c’était tout nouveau pour moi. Je ne voulais pas être le meilleur (comme c’était le cas au secondaire), ça ne m’intéressait pas, ça ne me passionnait pas. Tout ce que je voulais c’était d’éviter que mes parents soient déçus. Je décidai donc de me mettre en mode minimal. En médecine cela s’appelle le métabolisme de base. Je décidai de faire le minimum vital juste pour passer mes classes, et non pour être parmi les meilleurs. J’étais très assidu aux cours, essayant d’étudier du mieux que je pouvais. Je pris conseil chez mon voisin qui était mon ainé académique de trois ans. Il y avait une notion qu’on appelait le fax15. En effet, les étudiants s’étaient rendu compte qu’il y avait plusieurs enseignants qui, à chaque contrôle continu (CC), donnait les mêmes épreuves (la plupart des fois des QCM) que les années précédentes. Donc, plusieurs étudiants, au lieu d’étudier convenablement, se contentaient juste de traiter toutes les anciennes épreuves et comme les mêmes questions revenaient fréquemment, ils avaient donc des bonnes notes. Moi-aussi je suis bien évidemment entré dans cette mouvance, c’est-à-dire qu’en dehors de mes cours que je lisais, je faxais les anciennes épreuves. Des fois ça fonctionnait, et d’autres fois pas ! En première année, il y a deux matières qui m’ont marqué, les mathématiques et l’informatique. En effet, nous avions deux unités de valeur dessus, et chaque fois que nous avions l’un de ces cours, j’étais comme en plein orgasme, tellement cela me plaisait. C’était ce qui me passionnait réellement. Alors, lorsqu’il s’agissait de ces matières, j’avais pratiquement toujours la meilleure note.