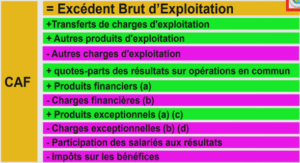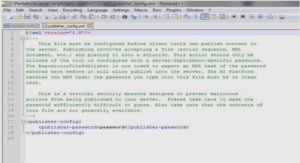Les anaphores associatives actancielles
Les anaphores associatives actancielles sont généralement illustrées par les énoncés suivants :
Paul se coupa du pain et posa le couteau.
Une vieille dame a été assassinée. Le meurtrier n’a pas été retrouvé.
La voiture a été volée et le voleur a été puni.
En pesant cet objet, il a cassé la balance.1
« Leur particularité réside dans le type de relation entre l’antécédent et l’expression anaphorique : l’antécédent est un prédicat et l’expression anaphorique correspond à un de ces arguments ou actants. Ainsi le couteau est l’instrument de couper le pain (…), le meurtrier est l’agent de l’assassinat, etc. »2
L’antécédent dans les actancielles est un SV ou un SN prédicatif ou processuel, c’est –à-dire un SN comportant un nom d’évènement, comme le montrent les exemples suivants : L’opération s’est bien passée. L’opéré et le chirurgien ont même blagué ensemble.
Il y a eu un assassinat. Le meurtrier a été très vite arrêté.3
Les actancielles sont donc définies « comme des expressions dont le référent correspond à un des arguments ou actants d’un prédicat déjà introduit dans le texte et dont la définitude provient précisément de ce rapport actanciel. Autrement dit, ils ne sont en somme « connus » ou si l’on veut « définis » que par leur intervention dans le schème prédicatif. » 1
Ajoutons dans cette définition des anaphores associatives actancielles, que comme à chaque prédicat se trouve associé un schéma d’arguments, il suffit de la mention du prédicat pour que ses arguments soient également disponibles. La simple évocation d’un assassinat, par exemple, implique en même temps l’existence d’un meurtrier, d’une victime, et facultativement celle de l’instrument du crime. Ces derniers sont « connus » et par conséquent « définis »puisqu’ils interviennent dans le schéma argumentatif.2
Les anaphores associatives fonctionnelles
En effet, les fonctionnelles, d’où leur nom, « comporte(nt) un N fonctionnel, c’est-à-dire un N dont le contenu sémantique indique qu’il s’agit d’un élément qui remplit une fonction ou un rôle caractéristique dans un ensemble ».
Un bus s’arrête. Le chauffeur fit sortir très vite les passagers.
Cet exemple illustre bien ce type d’anaphore où le référent le chauffeur dénoté par le SN anaphorique exerce une fonction ou un rôle dans ou vis-à-vis d’une entité Y dénotée par le N antécédent.
Kleiber4 présente une typologie des anaphores associatives assez variée mais précise –t-il encore qu’elles se réunissent toutes dans le fait qu’elles sont toutes inférentielles.
Les anaphores associatives méronymiques
La relation méronymique est définie comme étant le rapport partie-tout et les anaphores associatives méronymiques comme étant celles qui « mettent aux prises des types d’entités unies par rapport de dépendance ontologique particulier », selon l’expression de Kleiber.
Dans les séquences
Il s’abrita sous un vieux tilleul. Le tronc était tout craquelé.
Paul a lavé et nettoyé la voiture, mais il a oublié le capot / le toit / les roues / le volant / le tableau de bord / le siège.
La charrue avait du mal à labourer. Le soc était ébréché.1
« Le type d’entités de l’expression anaphorique (tronc, capot, toit, roues volant, tableau de bord, siège et soc.) apparaît comme étant ontologiquement subordonné au type d’entités de l’expression antécédent (tilleul, voiture et charrue), en ce que ses occurrences n’existent que comme composantes ou parties des occurrences de l’entité antécédent. »2
Kleiber précise également que
– « la suppression de l’occurrence du tout antécédent entraine également la suppression des occurrences des parties. » par exemple si on enlève tilleul, on fait disparaitre du même coup tronc.
– Les occurrences des parties peuvent certes être aliénées ; le volant d’une voiture peut figurer tout seul dans telle ou telle situation (les pièces détachées par exemple)
Mais même dans ce cas elles gardent leur statut de parties d’un tout : « un volant de voiture isolé reste un volant de voiture » affirme Kleiber.
Le trait définitoire décisif des anaphores associatives méronymiques réside, donc, dans le statut sémantique du nom anaphorique : il doit être marqué sémantiquement comme étant une partie de « ce qui impose de le définir relativement à une totalité »3.
L’exemple cité par Kleiber4 :
Paul aime sa voiture, parce que les sièges sont confortables, le tableau de bord comporte tous les accessoires possibles, le capot est aérodynamique et les roues sont en alu.illustre bien le cas de l’anaphore associative méronymique, dans la mesure où si on supprime l’antécédent voiture qui est l’holonyme, nous faisons disparaitre du même coup les expressions anaphoriques les sièges, le tableau de bord, le capot et les roues. Ce qui témoigne du caractère dépendant des méronymes par rapport à leurs antécédents. Précisons également que ce n’est pas le cas pour les holonymes qui ne sont pas dépendants de leurs parties mais « apparaissent comme des individus foncièrement autonomes. »1et présentent une catégorie différente.
Dans le chapitre suivant, nous allons présenter les caractéristiques des éléments qui entrent dans une relation méronymique, c’est-à-dire les unités linguistiques qui sont susceptibles d’assurer les rôles d’holonyme et de méronyme.