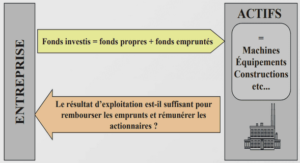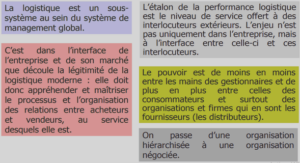Trois hypothèses et trois regards sur le corpus.
Le lecteur aura sans doute remarqué que dans le travail de définition notionnelle, nous n’avons pas défini un terme qui constamment revient dans notre propos : celui d’ « habitation ». Notre thèse fait de ce concept le centre d’attention puisqu’il est pris entre les incommunications dues au cadre, au dispositif fictionnel dans lequel les auteurs ancrent leur parole et à la liberté discursive de s’autopositionner. Afin de mettre en place notre problématique, nous proposons une première définition de ce concept inspirée des analyses de Michel de Certeau qui définit l’espace habité comme un espace approprié par la médiation du récit354, mais également de Barbara Skarga qui pointe la difficulté de retrouver un territoire habitable lorsque l’on a été exclu de sa maison natale355. Michèle Petit356 réfléchit à cette question de l’habitabilité et du pouvoir de la littérature de tisser le lieu, afin qu’il devienne un espace accueillant fait de relations, et extrait de son analyse ces réflexions de Georges Perec.
J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés ; des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources : Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais né, l’arbre que j’aurais vu grandir (que mon père aurait planté le jour de ma naissance), le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts…De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner ; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête.357
Cette citation de Perec montre que l’habitation n’est jamais un fait, mais une conquête, un processus afin de parvenir à un espace que le sujet s’approprie et à partir duquel il entre en relation, face à ce processus d’habitabilité apparaît toujours en filigrane la possibilité de basculer dans ce que Marc Augé nomme les « non-lieux »358 de la surmodernité. Aussi, notre thèse a pour but de s’intéresser à la façon dont les locuteurs de la francophonie choisie parviennent à tisser cet espace face aux trois incommunications qui risquent de les contraindre à un « non-lieu ». Nous ferons évoluer ce concept tout au long de notre travail, mais à partir d’une première définition nous pourrons comprendre les enjeux de notre recherche Ainsi nous pouvons définir l’habitation comme la possibilité d’être reconnu et d’entrer en relation dans un espace selon les critères souhaités par l’énonciateur. Notre question sera donc : comment un auteur allophone et exilique peut-il conquérir un espace de parole où celui-ci est reconnu en fonction de ses attentes et ainsi parvenir à dépasser l’ancrage de son visage pré-discursif.
Notre premier mouvement dessert deux objectifs : face à ce corpus d’auteurs souvent inaudibles, il nous incombe de présenter ces auteurs et montrer la façon dont ils se présentent sur la scène littéraire française. Cet aspect descriptif nous permettra de mettre en évidence la dialectique qui agit au sein de ce corpus : entre un visage pré-discursif saturé sémantiquement et leur volonté affichée d’exister selon un autre contrat de communication. Nous travaillerons alors sur l’ethos des auteurs et tenterons de montrer que leur travail sur la notion d’exil permet de jouer sur le positionnement énonciatif qu’ils souhaitent créer et que cette redéfinition tente de déjouer ce premier contrat de communication et de légitimer l’éclosion d’une figure d’auteur singulière. Ainsi, l’habitation leur serait rendue possible puisqu’ils s’exprimeraient en fonction d’un contrat de communication choisi grâce au récit de leur exil.
Dans notre deuxième mouvement, nous introduirons la pensée du non-lieu et réfléchirons à la possibilité d’un locuteur de refuser le contrat de communication pré-discursif qui le lie avec les interactants du discours. Face aux risques d’incommunication, nous pensons que les auteurs de la francophonie choisie d’Europe médiane mettent en place un contre discours qui fonctionne comme une structure d’appel à un regard particulier sur leurs œuvres. En effet, par une mythification de l’espace français et une reprise des mythes fédérateurs de la Nation française, les auteurs essaient de se présenter comme des héritiers de la culture franco-européenne. Nous étudierons alors comment leur habitation de l’espace français se fait par une révérence-inclusion au sein de la communauté de culture française.
Enfin, nous questionnerons la possibilité de parler de ce groupement d’auteurs comme étant assimilé. La mise en place d’un système de commémoration et de révérence à la culture française peut, en effet, faire penser à un mouvement d’assimilation. Cependant, il nous faudra prendre en compte les réponses des lecteurs et de la société française face à ces demandes de reconnaissance. En outre, nous nous demanderons si la mémoire déclarative des auteurs de la francophonie choisie peut parvenir à faire oublier leur « étrangeté » ou si celle-ci ne doit pas également être réappropriée afin de pouvoir parvenir à un oubli heureux. Enfin, ce dernier mouvement nous permettra de revenir sur les questions d’habitation et particulièrement de celle cosmopolite afin de voir la perspective singulière que les auteurs de ce corpus proposent.
Réciter son exil : dessiner les contours de son être. Portrait et ethos de l’écrivain exilique francophone choisi
« Français peut-être eussé-je été un poète génial »359 s’exclame Eugène Ionesco, encore en Roumanie. C’est par Non, livre affirmateur de la négativité, que l’auteur initie sa carrière d’écrivain roumain. Il ironise alors sur l’inanité de la critique littéraire et se conçoit comme condamné à n’occuper que la périphérie du monde intellectuel s’il reste dans son pays. Le mythe de la France360 comme « paradis perdu » prend une importance particulière dans l’œuvre du dramaturge361 qui deviendra académicien.
Afin de comprendre le visage particulier que les auteurs de la francophonie choisie d’Europe médiane présentent au public français, il faut selon nous, inclure notre étude dans un rapport ternaire : récit pré-exilique, récit d’habitation française et vécu post-exilique de cette habitation. En effet, si les œuvres que nous étudions ont toutes été conçues en France, au sein de celles-ci, les auteurs produisent un mouvement complexe puisque, à l’instar de tout écrivain, il s’agit de faire reconnaître l’émergence d’une parole singulière au sein du champ littéraire. Notre hypothèse consiste à percevoir que la configuration narrative qu’ils font de l’exil est un seuil identitaire, c’est-à-dire un « lieu » où ils s’engagent dans une certaine trame éthique leur permettant d’entrer en dialogue avec une nouvelle communauté culturelle. Nous plaçons au cœur de notre étude les problématiques des configurations identitaires. Pour comprendre celles-ci, nous nous orientons dans la lignée des études ricœuriennes puisqu’elles offrent la possibilité de comprendre le discours sur l’identité comme étant un mixte discursif362 entre fiction et histoire et étant toujours un lieu de médiation vers autrui. En effet le discours du moi n’est jamais un soliloque, mais toujours une ouverture au dialogue. Cette prise en compte du récit comme évènement dialogique permet de le comprendre comme étant toujours altéré et modifié par les représentations pré-discursives dont dispose l’auteur dans la nouvelle sphère communicationnelle, mais également de la projection produite par l’auteur des Autruis présents dans cette sphère. Selon nous, le mythe de la France formulé par ces auteurs ne peut pas être compris si nous ne le mettons pas en relation avec la configuration que les auteurs produisent des causes de leur exil dans le but d’établir une relation et de modifier leur visage pré-discursif. Nous pensons alors que le récit de la vie pré-exilique remplit deux fonctions : choisir des éléments du passé qu’ils jugent nécessaires à la compréhension de leurs prises de parole en français, mais il permet également de s’orienter dans le futur de leur réception française. En effet, nous pensons que la problématique éthique, comprise dans le sens d’ethos, doit adjoindre de manière nécessaire le récit du soi passé et son inclusion dans un futur proche. Le récit de soi n’est pas une simple fiction sur le passé, mais devient un engagement pratique dans le futur.