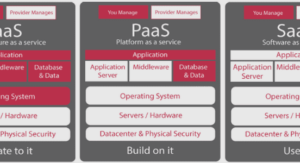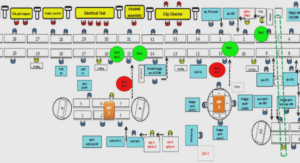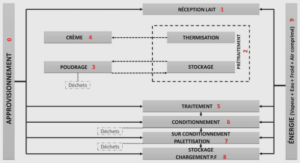La transition démographique dans le monde
Depuis la conférence mondiale de la population de Bucarest en 1974, la plupart des pays du monde ont pris conscience que la haute fécondité de leur population était un frein au développement économique et social. Alors que le processus de transition démographique était relativement avancé dans les pays occidentaux, les pays en voie de développement n’en avaient pas encore mesuré l’importance. C’est donc à la suite de cette conférence que commencent à se mettre en place des politiques de limitation des naissances et de planification familiale. Entre 1970 et 1990, la fécondité mondiale connait une baisse exceptionnelle. Seuls les pays d’Afrique subsaharienne ne connaissent pas cette baisse. Dans une grande partie d’Europe et d’Asie, la fécondité atteint des niveaux record, passant souvent sous le seuil de renouvellement des générations (2,1 enfants par femme). (Chesnais., 1990) Même si la plupart des pays du monde semblent avoir achevés leur transition démographique, les conséquences de cette transition ne sont pas encore toutes survenues.
Entre 1950 et 1987 la population mondiale a doublée, passant de 2.5 milliards à 5 milliards. La baisse de la fécondité dans les pays du nord a abouti à une prise de conscience de la part des autres pays du monde. Les pays avec les plus hautes fécondités tels que l’Iran ont pris conscience que cela ralentissait leur développement et ont donc pris des mesures, notamment au sujet de la planification familiale. (Grinblat., 2008)
La transition démographique dans les pays du sud a été facilitée par une observation de ses effets dans les pays l’ayant déjà achevée. Les avantages de cette transition, moteur du développement, ont été facilement compris par les états qui ont souvent mis en place des politiques de limitations de naissances dans les années 1980, à la suite de cette prise de conscience. Les pays les plus avancés ayant déjà tracé le chemin de la transition, celle-ci a souvent été plus rapide et mise en place de manière concertée dans les pays en voie de développement.
Cependant, comme le souligne Michel Louis Lévy, bien que la transition démographique avec ce schéma.
Justement, la croissance démographique a été d’autant plus forte dans les pays ayant récemment effectué leur transition, car la baisse de la mortalité y a été beaucoup plus rapide.
« On peut donc dire que la transition démographique, qui n’avait encore pratiquement pas commencé dans les pays du tiers-monde il y a 50 ans, est aujourd’hui terminée pour la plus grande partie du monde, mais qu’il reste encore 10 pour cent de la population du monde vivant dans un pays avec une fécondité en cours de transition, entre 3 et 5 enfants, et 9 pour cent dans un pays n’ayant pas encore commencé, ou ayant tout juste commencé, la transition. » (Grinblat., 2008., p 7)
Les conséquences
Selon Jacques Vallin, la fin de la transition dans tous les pays sera marquée par une stabilisation de la population mondiale vers 10 milliards d’habitants à la fin du 21e s. Mais en attendant, la population continuera à s’accroitre. Cela va faire augmenter le nombre de pauvres de manière considérable, car c’est dans les pays les plus pauvres que la transition n’est pas encore achevée. Le développement économique des régions les plus pauvres serait donc une solution à cet écueil. (Vallin., 2003)
Il ne faut pas oublier que la baisse de la fécondité ne résout pas immédiatement le problème de l’accroissement de la population. Même si la fécondité baisse brutalement, il faudra plusieurs générations pour absorber la croissance démographique antérieure.
Dans les années 2000, le démographe Alfred Grinblat soulève les problèmes que peuvent provoquer ces fluctuations extrêmes, tels que la diminution de la population dans les régions à basse fécondité en l’absence de migrations. En parallèle, les pays à la fécondité encore très élevée vont voir leur population beaucoup augmenter.
« Cette situation explique en grande partie les problèmes de l’immigration en provenance de l’Afrique vers l’Europe. D’une part l’Europe, malgré le chômage qui sévit dans certains pays, commence à manquer de main-d’œuvre, en manquera beaucoup plus dans l’avenir, et attire donc les immigrants. D’autre part, l’Afrique n’est pas en mesure de fournir des emplois aux larges cohortes de jeunes qui arrivent à l’âge de travailler, ce qui produit une pression forte à l’émigration. » (Grinblat., 2008., p.10)
Le vieillissement, origine et évolution et enjeux
La différence de fécondité entre l’Europe et le Maghreb a longtemps été un facteur de migration. En effets, les pays du Maghreb étaient fortement contraints avant 1970 par la part élevée des jeunes dans leur population, et le sont encore aujourd’hui. Cependant, les comportements ayant changé et la fécondité ayant baissé, les rapports entre les âges sont sur le point de s’inverser.
L’identification de la fin de cette transition divise les démographes. Selon J. Vallin, « On associe la fin de la transition au moment ou le taux d’accroissement de la population devient quasiment nul, permettant à l’effectif global de la population de se stabiliser » (J. VALLIN., 2003). Toutefois, on constate que dans bien des cas, particulièrement en Europe, le taux de fécondité ne cesse de diminuer arrivé au seuil de remplacement des générations. Une hypothèse pertinente de François Héran en 2005 fait état d’une seconde transition démographique. La fécondité de tous les pays passerait nécessairement en dessous du seuil de renouvellement des générations à terme, et, face à la baisse progressive de leur effectif de population, atteindraient une phase de ré-augmentation du taux de natalité. Cette approche est intéressante car la plupart des pays occidentaux sont actuellement dans le cas d’une diminution des naissances, qui aboutit inéluctablement à un vieillissement de la population. On peut donc dire que les trois principales conséquences de la transition démographique sont :
-La réduction de l’accroissement naturel (négatif dans les pays de moins de 2.1 enfants par femme)
-La diminution, à long terme, de la population des régions les moins fécondes (l’Europe en particulier, l’ONU y prévoit une baisse de 9% d’ici 2050) en l’absence de migrations. En parallèle, les pays dont la fécondité est encore très élevée vont voir leur population beaucoup augmenter (l’Afrique en particulier dont il est prévu que la population soit multipliée par 2 entre aujourd’hui et 2050.)
-Un vieillissement de la population, conséquence d’une fécondité basse qui provoque l’augmentation de l’âge moyen. Ce phénomène suppose un changement de cap des politiques gouvernementales. Une population jeune ne demande pas les mêmes infrastructures qu’une
population vieillissante. (Grinblat., 2008)
Le vieillissement, origine et évolution et enjeux
Les facteurs du vieillissement
Le vieillissement est une des conséquences de la transition démographique. Il pose de nouvelles questions de société, notamment en ce qui concerne les retraites. Alors qu’on observe en Europe une accélération de ce vieillissement et l’émergence de nouvelles problématiques sociales, il est essentiel de comprendre les facteurs de ce vieillissement pour prévoir et se préparer, dans les pays les plus jeunes, à une inversion de la situation démographique.
Le vieillissement peut être appréhendé selon deux manières. La baisse de la natalité entraine une augmentation de la population âgée, ce qui provoque un vieillissement par le bas. Aujourd’hui, ce vieillissement par le bas s’accompagne d’un vieillissement par le sommet, dû à la baisse de la mortalité aux âges avancés. D’autres facteurs sont également importants pour comprendre le vieillissement. Nous allons donc présenter le vieillissement et ses facteurs à travers plusieurs approches, qui sont, le plus souvent des phases complémentaires les unes des l’autres.
Les facteurs du vieillissement
Le vieillissement démographique dépend de plusieurs facteurs. A la suite de plusieurs événements, la structure par sexe et âge de la population est susceptible d’être modifiée. Il existe quatre facteurs qui interviennent dans le vieillissement de la population.
La composition de la population par sexe et âge au début de la période (composition initiale) a une influence sur la composition future de celle-ci. Les fluctuations de la mortalité et de la fécondité agissent sur la structure de la population pendant tout la durée de vie d’une génération.
D’autre part, l’évolution des migrations dans un espace donné peut modifier la structure de la population également. Ce sont souvent les jeunes hommes qui migrent, à l’étranger ou dans une région voisine, et cela peut créer des déséquilibres dans la pyramide des âges, plus ou moins importants selon la prégnance du phénomène. Si la part de jeunes diminue, on retrouve plus de personnes âgées en proportion de la population totale dans l’espace d’origine.
Le vieillissement, origine et évolution et enjeux
L’évolution de la fécondité, c’est-à-dire la diminution du nombre de naissances, est également un facteur de vieillissement important. Si la base de la pyramide des âges est réduite, le nombre d’adultes (15 ans et plus) augmente en proportion de la population totale. A ce propose, Jean-Claude Chesnais va jusqu’à parler d’une « inversion de la pyramides âges » (Chesnais., 1990., p.88). Ce phénomène commence à être visible dans certains pays, pour lesquels la fécondité très basse depuis plusieurs années provoque un rétrécissement de la base de la pyramide et une augmentation de la taille des classes actives et âgées.
Enfin, l’évolution de l’espérance de vie est un facteur direct d’augmentions de la part de personnes âgées. Lorsque les personnes âgées vivent plus vieilles, leur nombre augmente. (Calot., Sardon., 1999)
Toutes les variations de ces facteurs ont un effet sur le vieillissement, et sur la structure même de la population.
La composition initiale de la pyramide des âges reflète le comportement démographique d’une population et certains événements historiques qui s’y sont produits, et qui ont laissé des traces dans la composition par âge. Ainsi, une augmentation à un moment donné de la natalité (par exemple un baby-boom), et donc du nombre de jeunes, va, 60 ans plus tard, inverser le phénomène et provoquer un vieillissement. Chaque classe d’âge, arrivée aux âges avancés, fait varier l’importance du phénomène de vieillissement.
A l’échelle nationale, les effets des migrations sont minimes par rapport aux 2 facteurs suivants. « C’est la baisse à long terme de la fécondité, de la mortalité ou des deux simultanément qui provoque la progression du vieillissement. » (Calot., Sardon., 1999., p.520). Mais localement, le facteur migratoire prend de l’importance. Les phénomènes locaux sont parfois considérables, mais sont moins visibles à une échelle plus large compte tenu de l’effet de moyenne.
Cependant, un solde migratoire positif (phénomène d’immigration) fait augmenter la part de jeunes car la plupart du temps, ce sont les jeunes qui migrent. Cela ralentit donc le vieillissement. Un solde migratoire négatif (phénomène d’émigration) fait diminuer la part de jeunes, donc accélère le vieillissement. A noter que certains cas particuliers de migrations de personnes âgées ne répondant pas à cette logique seront développés dans ce mémoire. 2