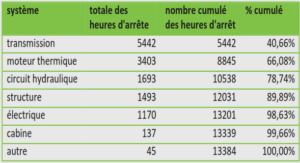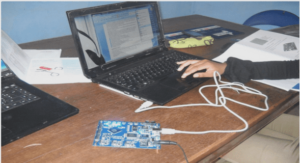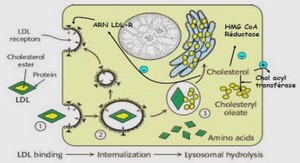Établissement de la réponse inflammatoire
L’inflammation est caractérisée par une augmentation locale du flux sangum, une dilatation des capillaires, l’ infiltration des leucocytes et la production de médiateurs chimiques. Elle est essentielle pour le retour à l’homéostasie tissulaire lors d’une blessure ou d’une infection, même si cela entraîne une baisse de fonction temporaire du tissu inflammé [22]. La réponse inflammatoire aigüe est principalement médiée par les M<ps et les neutrophiles. Elle comporte une cascade successive de processus pro-inflammatoires et anti-inflammatoires et peut être déclenchée par une grande variété de stimuli comme une blessure, une brûlure ou la présence d’un agent pathogène. Habituellement, le stimulus active les cellules immunitaires résidentes, dont les M<ps, et induit par ceux-ci la production de molécules pro-inflammatoires comme le TNFa et l’ILl~ . Leur activation et le relargage de molécules inflammatoires entraînent une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins au site de l’ inflammation, ce qui permet par la suite le recrutement des monocytes sanguins et des neutrophiles. Une fois activés, les M<ps et les neutrophiles participent alors activement à la phagocytose des cellules mortes ou infectées, causant également de dommages tissulaires qui doivent être réparés au cours de la phase de résolution. En effet, en présence des cytokines pro-inflammatoires et des pathogènes, les M<ps et les neutrophiles enclenchent une poussée oxydative et de production d’enzymes protéolytiques qui dégrade la matrice extracellulaire, affectant ainsi l ‘ homéostasie tissulaire.
Résolution de l’inflammatio
n Sans régulation, l’inflammation aigüe laisse place à l’ inflammation chronique et semble caractéristique de nombreuses maladies humaines, incluant l’Alzheimer, l’athérosclérose, les maladies cardiovasculaires et le cancer. En fait, l’inflammation chronique entraîne des dommages tissulaires et un dérèglement du processus de guérison (Figure 1.5). Nous avons longtemps cru que l’inflammation disparaissait passivement, résultant de la dilution des cytokines et chimiokines avec le temps, mais le laboratoire du professeur Serhan à Harvard a été l’un des premiers à montrer que la résolution de l’inflammation était un processus actif, impliquant la production de médiateurs anti-inflammatoires (Figure 1,6), Les M<ps ont un rôle important à jouer dans la résolution de la réponse inflammatoire, entre autres par la phagocytose des neutrophiles et M<ps proinflammatoires apoptotiques, ce qui entraîne une modification de leur phénotype vers un sous-type M2 et une augmentation de la production de cytokines anti-inflammatoires, ce qui promeut le retour à l’homéostasie tissulaire [23,24], Le recrutement des monocytes et leur différenciation en M<ps au site de l’inflammation sont des évènements déterminants dans le succès de la résolution de l’inflammation [25]. Par exemple, les M<ps sécrètent des protéases qui clivent les chimiokines afin d’empêcher le recrutement de nouveaux neutrophiles [26]. Les médiateurs de la réponse anti-inflammatoire sont nombreux et biochimiquement divers. Certains lipides (lipoxines, résolvines, protectines et maresines), protéines (annexine Al), peptides et gaz ont des rôles à jouer dans la résolution de l’inflammation [26]. Ces molécules sont produites majoritairement par les monocytes/M<ps et les neutrophiles, mais peuvent aussi être synthétisées dans les cellules endothéliales vasculaires [27-30]. Plusieurs cytokines ayant un effet anti-inflammatoire sont également sécrétées, comme décrit dans la section suivante consacrée aux cytokines. De plus, la production de cytokines associées à l’inflammation aigüe, comme TNFa, GM-CSF et IL8, est diminuée [26].
Macrophages, cytokines et inflammation
Durant la réponse inflammatoire, il y a non seulement une augmentation de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, mais aussi une diminution de cytokines anti-inflammatoires. Les principales cellules responsables de la production de cytokines pro-inflammatoires sont les macrophages activés [34J. Bien que les cytokines agissant sur les leucocytes soient très nombreuses, la section suivante traitera des celles agissant particulièrement sur les monocytes/macrophages et ayant un rôle physiologique ou pathologique dans la gestation humaine. L’interféron gamma L’IFNy est l’une des premières cytokines à avoir été identifiée [35]. On classe parmi les IFN les molécules solubles sécrétées lors d’ infections virales et ayant la capacité de les protéger contre les virus [36]. On divise les IFN en deux grands groupes: type 1 et type II. Les IFN de type 1 sont habituellement produits en réponse à une infection virale et sont subdivisés en plusieurs sous-types, dont IFNa et IFN~, selon les cellules d’origine, et un type identifié plus récemment, IFNI::. Les IFNa sont une famille de 17 protéines encodées par des gènes distincts et sont synthétisés principalement par les lymphocytes.
L’IFN~ est une protéine produite majoritairement par des fibroblastes. Contrairement à IFNa et IFN~, IFNI:: est exprimé constitutivement dans plusieurs organes, dont les poumons, le cerveau et les tissus reproducteurs [37]. Bien qu’ils soient utiles pour protéger la mère d’infections virales ou bactériennes, les IFNs de type 1 ne semblent pas être impliqués dans les complications gestationnelles liées à l’inflammation, contrairement à IFNy [38, 39]. L’IFN de type II ou IFNy est produit en réponse à des stimuli immuns inflammatoires, et ce, presque exclusivement par les lymphocytes T et les cellules NK [36,40]. Les IFNs, en plus de leur activité antivirale, peuvent inhiber la prolifération et exercer d’autres fonctions pro-inflammatoires comme polariser des M<ps en un sous-type pro-inflammatoire (Ml), sensibiliser ceux-ci à des signaux comme le LPS et induire la production d’oxyde nitrique (NO) et d’espèces réactives de l’oxygène [40,41].
IFNy est une petite protéine de 34 kDa qui entraîne des modifications dans l’expression génique par l’activation de son récepteur, composé de deux sous-unités: IFNy Receptor-1 et -2 (IFNGRI et IFNGR2). Le changement de conformation du récepteur en présence du ligand permet la phosphorylation des protéines Janus kinases (JAKs) attachées constitutivement à la portion intracellulaire des deux sous-unités du récepteur, plus précisément JAKI et JAK2 [42,43]. L’activation de ces protéines à activité kinasique induit la phosphorylation du domaine intracellulaire de IFNGR. Ce site de phosphorylation permet l’ancrage du facteur de transcription Statl (Signal Transducer and Activator ofTranscription-l) [43,44]. Une fois phosphorylés au niveau de la tyrosine 70 1, les Statl s’associent pour former des homodimères qui sont transloqués au noyau où ils peuvent induire l’expression de gènes cibles [43, 45]. La voie JAKIStat est régulée négativement par plusieurs mécanismes, les plus étudiés impliquant les protéines connues sous les acronymes PTP (protein tyrosine phosphatase), SOCS (suppressor of cytokine signaling) et PIAS (protein inhibitor of activated Stat). D’autres mécanismes inhibiteurs de Statl peuvent également co-exister, à savoir l’internalisation du récepteur IFNGR [46] ainsi que la sumoylation et la dégradation par le protéasome de Statl [47].
Pour réguler la voie JAKIStat1 , la PTP protein Src homology 2-containing phosphatase (SHP-2) déphosphoryle les JAKs et l’IFNGR1 afin d’entraver la signalisation de l’IFNy. SHP-2 est activé (phosphorylé) au niveau de ses tyrosines 542 et 580 en réponse à des facteurs de croissance comme l’ Epidermal growthfactor (EGF), et facilite la signalisation des Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) en activant les extracellular signal-regulated kinases (ERKs) [48]. Il semble d’ ailleurs qu’une réponse diminuée à l’IFNy serait accompagnée de l’activation de SHP-2 [49]. SOCS 1 exerce un contrôle sur la signalisation de l’IFNy en liant son domaine SH2 (Src homology 2) à des tyrosines phosphorylées de JAK1 (Tyr1034-1035) [50], JAK2 (Try1007) [51] et de non-receptor tyrosine-protein kinase-2 (TYK2) (Tyrl054-l055) [52], inhibant ainsi leur activité [50] . Il a été découvert récemment que SOCS 1 peut se lier à JAK non phosphorylé, suggérant un scénario où SOCS 1 peut empêcher l’autophosphory1ation des JAKs avant même que le récepteur soit activé par le ligand [50] . L’interleukine-IO (IL-IO), une cytokine anti-inflammatoire, peut induire l’expression de SOCSI et, donc, diminuer l’action de IFNy [53]. PIASl arrive à réduire l’expression de gènes cibles de l’IFNy non pas en inhibant l’activation de Statl, mais plutôt en empêchant son action. Il peut se lier au domaine de transactivation de Statl , augmenter sa SUMOylation ou se lier directement au promoteur des gènes cibles de IFNy (interferon-stimulated genes; ISGs) pour empêcher le recrutement de Statl [54-56].
Phase lutéale : décidualisation
La phase lutéale sert essentiellement à préparer l’utérus à un éventuel blastocyste prêt à s’implanter. D’abord, les cellules qui entouraient l’ovule, les cellules de la granulosa et de la thèque, se transfonnent sous l’influence de la LH pour fonner un organe endocrine éphémère: le corps jaune ou corpus lutheus. Celui-ci sécrète la progestérone qui constitue le deuxième signal que l’endomètre attendait, après l’oestradiol, pour enclencher la décidualisation. Donc, au niveau de l’utérus, ces changements honnonaux entraînent une panoplie de changements morphologiques et fonctionnels en passant du remodelage de la vasculature à la différenciation des cellules endométriales stromales en cellules déciduales spécialisées. Il est à noter que la décidualisation n’a lieu qu’après la fécondation chez la majorité des mammifères; seulement ceux dont la décidualisation est déclenchée par l’ovulation ont des menstruations [120-124]. Les cellules déciduales stromales ont un rôle majeur à jouer dans le bon succès de l’implantation embryonnaire, mais aussi dans la modulation de l’immunité maternelle [125]. En plus de contribuer au microenvironnement qui promeut le remodelage des artères et la fonnation du placenta par la production de cytokines comme IL-Il [126], LIF [127], ou d’honnones comme la prolactine [128], elles influencent le recrutement, la distribution et la fonction des cellules immunitaires de la décidue par la sécrétion de chimiokines et cytokines dont la monocyte chemoattractant protein-l (MCP-l), IL-6, IL-8 et IL-15 [129, 130]. Il y a un dialogue étroit entre les cellules déciduales et les leucocytes maternels. Durant la phase lutéale, une grande portion de ces leucocytes est constituée de cellules tueuses naturelles utérines (uterine natural killer cells; uNK), qui ne semblent pas avoir de fonctions cytotoxiques, comme les NK circulants. Dans le contexte gestationnel, les cellules uNK semblent plutôt impliquées dans le remodelage des artères spiralées et, si la fécondation est réussie, à l’invasion du trophoblaste [126, 131-133].
REMERCIEMENTS |