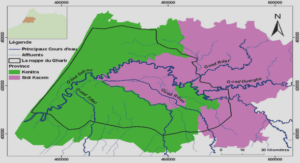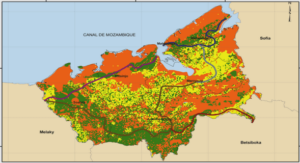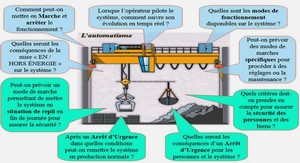En cette année du deux centième anniversaire de la naissance de Charles Darwin (1809) et du cent cinquantième anniversaire de l’édition de De l’origine des espèces (1859), de nombreux ouvrages et articles mettent en perspective les travaux de Darwin à la lumière des découvertes récentes en biologie. Peu font état cependant de l’impact que ses théories ont eu sur les travaux en sciences humaines. Pourtant, le darwinisme n’a eu de cesse d’influencer et d’inspirer les théories en sciences humaines et notamment en anthropologie..
L’anthropologie moderne est partie du point de vue évolutionniste. Elle y était invitée par le bonheur des interprétations darwiniennes concernant le développement biologique, et aussi par le désir d’hybrider les découvertes préhistoriques et les données ethnographiques. Il reste que, non seulement valides, ses propositions sont indispensables à l’homme de terrain comme au théoricien. (Malinowski, 1944).
Cette remarque de Malinowski est toujours d’actualité et, récemment, c’est-à-dire depuis la fin des années 1970, de nouvelles théories qui accordent une place importante au darwinisme se sont développées en sciences humaines (pour un rapide aperçu historique de certaines de ces théories voir Blute, 1987; Laland & Brown, 2002).
Au sein des théories ‘darwiniennes’ de la culture, deux emplois du terme darwinisme peuvent aisément être distingués, un usage plus littéral et un usage plus analogique. Dans un sens littéral, le darwinisme renvoie au fait que l’homme, comme tous les êtres vivants, est le résultat d’un processus d’évolution génétique. La question qui se pose est de savoir si cette évidence, une fois reconnue, peut instruire et informer les sciences humaines. Dans un sens analogique, l’évolution culturelle peut être largement indépendante de l’évolution génétique et être elle-même darwinienne. Cet usage est analogique car cela revient à considérer le darwinisme comme un ensemble de principes, certains diraient de lois ou d’algorithmes, qui sont indépendants de la biologie et peuvent s’appliquer à la culture. De nombreux évolutionnistes s’accorderaient pour dire que les virus informatiques évoluent de manière darwinienne par exemple.
Dans cette thèse nous parlerons peu de l’usage littéral du darwinisme et nous n’évoquerons l’évolution génétique du comportement humain qu’en tant qu’argument dans la discussion de l’usage analogique du darwinisme. La question qui sera l’objet de cette thèse est la suivante : peut-on dire que l’évolution culturelle est darwinienne dans un sens analogique ? Il s’agira donc de comprendre dans quelle mesure l’évolution culturelle est analogue à l’évolution biologique. Mais avant de rentrer dans le détail des théories qui font un usage analogique du darwinisme, il me semble important de dresser un aperçu rapide des théories qui en font un usage littéral, pour comprendre à la fois les origines historiques des théories dont nous allons parler et les limites de celles-ci.
La sociobiologie, l’écologie comportementale humaine et la psychologie évolutionniste cherchent, chacune à leur manière, à montrer que la connaissance de l’histoire évolutionnaire de l’homme permet de mieux comprendre son comportement moderne.
La sociobiologie, qui a pour fondement les travaux de Hamilton sur l’évolution de la socialité (les travaux de Hamilton seront discutés dans la partie 1.2.4, pp 49), a été développée par Edward O. Wilson comme une nouvelle discipline dont l’objet est «l’étude systématique des bases biologiques de tous les comportements sociaux » (E. O. Wilson, 1975). Le livre de Wilson, Sociobiology : the new synthesis constitue une synthèse des travaux permettant d’expliquer l’origine des comportements sociaux, animaux et humains. La publication de ce livre, et notamment du dernier chapitre sur les bases évolutionnaires du comportement humain, a entraîné une controverse politique importante qui a en partie masqué, ou du moins retardé, la discussion scientifique de cette question (pour une discussion historique et scientifique approfondie de la controverse qui a entouré la sociobiologie voir Segerstråle, 2000). De nombreux arguments scientifiques ont été développés pour montrer les limites de l’approche sociobiologique de Wilson appliquée à l’homme (voir en particulier Lewontin, 1976; Lewontin, 1979) et les tentatives de prises en compte de ces critiques (Lumsden & Wilson, 1981) n’ont pas été jugées satisfaisantes (Maynard Smith & Warren, 1982). Le débat scientifique qui a entouré l’application de la sociobiologie à l’homme est donc aujourd’hui largement en faveur d’un rejet des idées sociobiologiques, du moins telles qu’elles ont été élaborées par Wilson.
Un argument me paraît essentiel dans ce débat : celui du rôle de la sélection naturelle. Gould et Lewontin (1979) ont critiqué ce qu’ils ont nommé le programme adaptationniste (ou encore le paradigme Panglossien) dont la sociobiologie serait un exemple extrême (Lewontin, 1979). Selon ces auteurs, la sociobiologie postule, plus qu’elle ne démontre, le fait que tous les comportements sont le produit, plus ou moins direct, de l’évolution biologique et de la sélection naturelle. Autrement dit, la sociobiologie part du principe que tous les comportements, humains et non humains, sont des adaptations et construit ensuite une argumentation pour justifier ce postulat. C’est cette position de principe qui est généralement prise dans les sciences évolutionnaires que critiquent Gould et Lewontin. Ces auteurs insistent sur le fait que d’autres forces entrent en jeux dans l’explication de l’évolution des organismes (comme par exemple la dérive génétique qui résulte des variations stochastiques de la fréquence des gènes), donc qu’il n’est pas possible de postuler a priori que tous les comportements humains sont le produits de la sélection naturelle. Pour Gould et Lewontin, la sélection darwinienne n’est qu’un élément de l’explication de l’évolution des organismes, et en l’absence de preuves solides il n’est pas justifié de considérer que la sélection darwinienne est l’hypothèse par défaut. Selon eux cet argument est général et vaut aussi bien pour la biologie que pour la culture.
Pour Campbell par exemple, toute connaissance est le produit d’une génération aveugle d’alternatives et de la sélection des variantes les plus adaptées, ce qu’il appelle une ‘épistémologie évolutionnaire’ ou encore ‘une épistémologie de la sélection naturelle’ (Campbell, 1960, 1974, 1976). C’est cet argument particulier qui me paraît essentiel dans le débat entourant la sociobiologie et qui peut être éclairci par l’étude des relations entre l’évolution culturelle et l’évolution biologique. La sociobiologie nous pousse à trouver une nouvelle explication ultime des comportements, autre que la sélection naturelle, qui puisse justifier de l’indépendance entre évolution culturelle et évolution biologique. Nous reviendrons plusieurs fois sur cette question en montrant comment les différentes théories qui nous intéressent tentent d’y répondre.
La controverse qui a entouré la sociobiologie a ravivé l’intérêt des scientifiques pour l’étude des relations entre ‘nature et culture’ et favorisé l’émergence de nouvelles théories abordant cette question. D’une certaine manière, le travail de Wilson a stimulé le développement des théories darwiniennes modernes de la culture et notamment de l’écologie comportementale humaine et de la psychologie évolutionniste. L’écologie comportementale est en partie un prolongement des arguments sociobiologiques tandis que la psychologie évolutionniste est en partie une critique de la sociobiologie.
L’écologie comportementale humaine étudie les comportements humains d’un point de vue strictement adaptationniste : en cherchant à montrer que les comportements
humains maximisent le succès reproductif des individus (leur fitness) et comment cette maximisation peut être à l’origine de différences culturelles. L’hypothèse fondamentale de cette discipline est que les humains disposent de mécanismes psychologiques évolués qui leur permettent d’adapter leur comportement à l’environnement dans lequel ils se trouvent de manière à maximiser leur fitness (pour un aperçu voir Borgerhoff Mulder, 2004). Les études en écologie comportementale humaine se sont principalement concentrées sur les méthodes de fourragement, les modes de mariages, le choix des partenaires sexuels, l’investissement des parents dans les enfants ainsi que les intérêts collectifs et individuels, le plus souvent avec des études chez les chasseurs cueilleurs (Hawkes, O’Connell, & Rogers, 1997, mais voir l’exemple ci-dessous pour une exception).
Ruth Mace (1998, 2008) par exemple, a défendu l’idée selon laquelle la réduction postindustrielle de la natalité au sein des environnements urbains peut être expliquée en grande partie par des considérations évolutionnaires. Cette transition démographique pose un certain problème d’un point de vue adaptationniste : si les individus possèdent plus de richesses ils peuvent élever plus d’enfants et donc devraient avoir tendance à se reproduire davantage pour maximiser leur succès reproductif, or c’est justement le contraire qui est observé : une association entre une augmentation de la richesse et le déclin de la natalité a été observée à travers le monde entier. Mace fait remarquer que cette corrélation s’observe généralement à une échelle assez importante (typiquement celle d’un Etat), mais qu’elle disparaît si l’on considère des échelles plus fines : au niveau local on observe en général un lien positif entre la natalité et la richesse, que ce soit en environnement urbain ou rural. Le déclin de la natalité au niveau national pourrait donc s’expliquer par le phénomène suivant : dans les campagnes des pays en voie de développement, avoir un enfant supplémentaire n’implique pas un coût supplémentaire important car les investissements parentaux par enfant sont faibles (les coûts liés à l’éducation, aux soins médicaux… sont souvent moins importants et parfois absents, et la nourriture est produite directement). Si les individus cherchent à maximiser leur fitness, ils devraient, dans ce cas, avoir des familles nombreuses. Au contraire, dans les villes de ces mêmes pays, les investissements parentaux peuvent devenir très importants (logement, éducation, soins…) et le fait d’avoir un enfant supplémentaire peut entraîner un coût supplémentaire élevé. Dans ce cas, si les individus cherchent à maximiser leur fitness, ils devraient limiter leur nombre de descendants. Ce raisonnement prédit que la taille des familles devrait être globalement plus faible dans les villes que dans les campagnes, mais aussi que dans tous les cas les familles doivent être d’autant plus nombreuses qu’elles sont plus riches. Mace conclut : The cost of raising a child includes enabling it to compete with its peers—for marriage partners, for jobs, or for the means to support a family—and if that competition increases costs, then basic evolutionary ecology predicts that optimal fertility will decline. (Mace, 2008) .
Introduction |