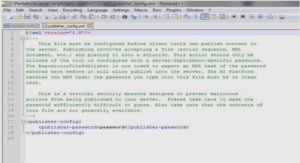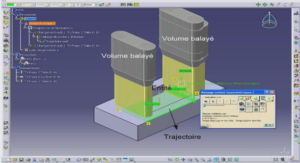TERET DE L’ADN TUMORALCIRCULANT DANS LE CBNPC
La prise en charge des patients avec un cancer bronchique passe aujourd’hui par une évaluation clinique, anatomopathologique et biologique à la recherche d’altérations moléculaires pouvant être la cible de nouvelles thérapies. L’identification d’au moins une altération génétique spécifique du tissu tumoral constitue un marqueur tumoral. La mise en évidence d’une mutation somatique dans le sang d’un patient peut alors être évaluée dans le cadre du suivi de la tumeur.
Les résultats récemment publiés de l’étude BIOMARQUEURS-France, réalisée par l’Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique (IFCT), confirment l’intérêt de l’utilisation des biomarqueurs pour guider les traitements anti-tumoraux et améliorer le pronostic de la maladie (Barlesi et al., 2016) (Figure 11).
Mais en pratique cette recherche de biomarqueurs ne peut être réalisée que chez 10 à 30% des patients en rechute (tissu non disponible, nouvelle biopsie non réalisable) (Ferte J, Massard C, AACR 2014) ce qui souligne la nécessité d’envisager des alternatives au prélèvement tissulaire pour accéder à l’ADN tumoral.
L’utilisation en routine de l’ADN tumoral circulant (ADNtc), biomarqueur sanguin tumoral, non invasif, spécifique, pourrait intervenir dans le dépistage, le diagnostic, la décision thérapeutique et le suivi des patients atteints de cancer.
Chez les patients avec un CBNPC, les mutations de la tumeur initiale peuvent être recherchées dans la plasma, avant, pendant et après traitement par exemple (Tsui and Berger, 2016a) (Figure 12). Figure 11 : Intérêt de l’étude du profil génomique. Courbe bleue : courbe de survie globale représentant la durée de survie de patients pour lesquels une altération génétique est présente et pour lesquels le traitement a été adapté. Courbe rouge : altération génétique absente (Barlesi et al., 2016).
Figure 12 : Suivi de l’efficacité du traitement et détection précoce de récidive via l’ADNt. Chez les patients avec un CBNPC, les mutations de la tumeur initiale sont recherchées dans la plasma, avant, pendant et après le traitement. Les mutations observées au diagnostic et au moment de la résistance au traitement sont représentées dans les diagrammes circulaires (Tsui and Berger, 2016a). Le graphique représente le niveau d’ADNtc dans le plasma en fonction du temps.
La courbe bleue correspond à la tumeur initiale, les courbes rouge et verte correspondent à l’émergence de métastases. Le taux d’ADNtc de la tumeur initale diminue au cours du traitment tandis que l’ADNtc des métastases émergent au cours du traitement.
Histoire de l’ADN circulant
La présence d’acide nucléique dans le plasma a été décrite en 1948 par Mendel et Metais. C’est en 1977 que Leon et al. mettent en évidence de l’ADN circulant dans le sérum de patients atteints de cancer en quantité plus importante que chez des sujets non cancéreux.
En 1994, Sorenson et ses collaborateurs démontrent l’origine tumorale de l’ADN circulant chez des patients atteints d’un cancer du pancréas, en mettant en évidence la même mutation de l’oncogène KRAS au niveau de l’ADN circulant et de la tumeur. Ainsi les mutations et les translocations identifiées dans les tumeurs peuvent être retrouvées dans l’ADN libre circulant (ADNlc) et signent la présence d’ADN d’origine tumoral.
L’une des caractéristiques majeures de l’ADNtc est sa très grande spécificité car les altérations recherchées dans le sang sont somatiques. Le patient est son propre témoin et la détection des anomalies moléculaires tumorales dans le sang confirme la présence d’ADNtc. Depuis, des altérations somatiques spécifiques de l’ADN tumoral ont pu être détectées dans le plasma dans de nombreux cas de cancers.