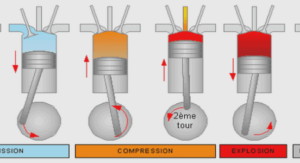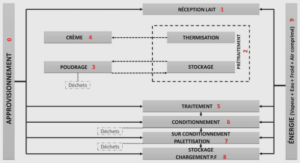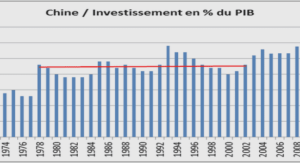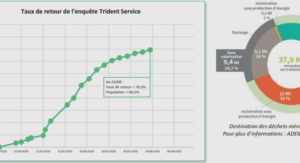Températures glaciaires-interglaciaires des eaux de surface de l’océan
Pacifique équatorial
La température des eaux de surface de l’océan Pacifique ouest équatorial est critique dans la circulation atmosphérique globale. Actuellement avec des températures annuelles supérieures à 28°C (Yan et al., 1992), la convection nuageuse à grande échelle existe toute l’année dans cette zone, formant la branche ascendante des cellules de Walker, de mousson transverse, et de mousson latérale (cf. introduction). En dessous du seuil de 27.5°C, cette convection dite « profonde » (« deep convection »), cesse de fonctionner, et le fonctionnement des trois cellules atmosphériques est modifié (Waliser and Graham, 1993). En dessus de 29.5°C, la convection nuageuse caractéristique du Pacifique ouest, est également arrêté (Waliser and Graham, 1993). Les variations de température au cours du temps dans la zone d’eaux chaudes du Pacifique ouest sont donc critiques pour la compréhension de la dynamique atmosphérique globale.
Les températures au dernier maximum glaciaire ont fait l’objet d’un grand débat depuis les estimations du groupe CLIMAP (CLIMAP, 1976). Ce groupe indiquait un refroidissement d’environ 1°C dans le cœur du réservoir d’eaux chaudes du Pacifique occidental. En contraste, les données continentales semblent indiquer un refroidissement plus marqué, d’environ 4°C, d’après la présence de glacier sur la Papouasie Nouvelle Guinée, et les données polliniques (Farrera et al., 1999). La compilation récente de toutes les données environnementales disponibles pointe vers des températures 2.5°C plus froides au dernier maximum glaciaire (Crowley, 2000).
La différence entre les estimations issues des données continentales et celles fournies par les marqueurs marins a fait l’objet de nombreuses interprétations. Pour le domaine océanique, un biais pourrait provenir de la dissolution des carbonates qui modifierait la composition des assemblages de foraminifères planctoniques utilisé dans les reconstructions des tempéraures des eaux de surface (Thompson, 1981). Une seconde hypothèse implique les faibles taux de sédimentation des carottes étudiées dans cette zone : les assemblages glaciaires et holocènes seraient affectés par la bioturbation qui atténuerait l’amplitude glaciaire-interglaciaire (Anderson et al., 1989). La dernière objection repose sur l’absence de carottes convenablement datées du dernier maximum glaciaire, même dans le travail de CLIMAP.
Dans ce chapitre, nous avons étudié la variabilité des températures des eaux de surface dans la carotte MD97-2138, située dans le cœur de la zone d’eaux chaudes du Pacifique ouest. Cette carotte possède un taux de sédimentation important, est peu affectée par la dissolution des carbonates et a été bien datée. Nous avons utilisé pour établir les paléotempératures des eaux de surface, deux marqueurs : l’insaturation des alkénones, lipides produits par les prymnesiophycées (coccolithophoridés) dont le degré d’insaturation est une fonction de la température de croissance, et les fonctions de transfert des assemblages de foraminifères planctoniques.
Températures des eaux de surface du Pacifique
Principe des fonctions de transfert :
La composition spécifique des assemblages de foraminifères planctoniques est contrôlée par différents facteurs environnementaux (biotiques et abiotiques) dans lequel vivaient les organismes. Les processus sédimentaires peuvent également modifier les assemblages. Les fonctions de transfert sont des méthodes statistiques qui permettent de quantifier la relation existant entre les assemblages de foraminifères planctoniques et ces paramètres environnementaux. La température des eaux de surface océaniques a depuis plus de 30 ans fait l’objet de reconstructions par des fonctions de transfert sur les foraminifères planctoniques. Depuis, les facteurs qui ont été considérés comme critiques pour la composition spécifique outre la température des eaux de surface sont la production primaire et la profondeur de la thermocline/ profondeur de la couche de mélange. Plus récemment, la modification induite par la dissolution préférentielle de certaines espèces a été utilisée pour reconstruire le pH des environnements sédimentaires (Anderson and Archer, 2002).
L’hypothèse fondamentale de ces méthodes est celle de l’actualisme : c’est à dire que les relations existantes entre les assemblages et les paramètres biotiques et abiotiques sont supposées ne pas avoir changé au cours du temps. Cette hypothèse est particulièrement problématique dans le cas d’assemblages fossiles n’ayant pas d’analogues actuels. Cette hypothèse peut également être problématique dans le cas d’assemblages modernes similaires mais liés à des conditions environnementales différentes.
Trois principales méthodes statistiques ont été utilisées pour les reconstitutions environnementales à partir des foraminifères planctoniques :
Les fonctions de transfert d’Imbrie et Kipp (1971) :
Ces méthodes désormais classiques en paléoclimatologie, se basent sur la diagonalisation de la matrice espèces-abondances relatives des échantillons de sédiment de surface. Le poids relatif des différentes espèces pour chaque facteur issu de la diagonalisation, fait alors l’objet d’une régression multiple avec le paramètre choisi, en l’occurrence, dans le travail original d’(Imbrie and Kipp, 1971), la température des eaux de surface. Cette régression multiple permet d’obtenir une équation reliant le paramètre voulu à l’assemblage fossile.
La méthode des analogues :
Cette méthode calcule une distance algébrique, appelée coefficient de dissimilarité, entre deux assemblages (Hutson, 1980; Prell, 1985). Chaque assemblage fossile est comparé avec une base de données d’assemblages modernes, pour trouver les n plus proches analogues en fonction du coefficient de dissimilarité (en moyenne 5 à 10). Les valeurs environnementales des analogues seront alors pondérées par ce coefficient pour reconstruire les paléo-environnements. Une révision de cette méthode permet de choisir dynamiquement le nombre d’analogues le plus approprié à chaque assemblage fossile (Waelbroeck et al., 1998).
Les réseaux neuronaux :
Cette méthode utilise les réseaux de neurones qui font l’apprentissage des assemblages en fonction du paramètre choisi pour prédire en fonction de cet assemblage les paléo-paramètres (Malmgren and Healy-Williams, 1978). Chaque neurone est une fonction non-linéaire. Cette méthode permet d’obtenir de très bons résultats sur les bases de données modernes. Cependant, la justesse des résultats obtenus ne peut pas être quantifiée.
Jusqu’à présent, la principale limitation des fonctions de transfert était l’absence d’analogues modernes pour des assemblages fossiles. Cet écueil a été résolu en diagonalisant non plus les sédiments modernes, mais les sédiments de carotte qui permettent de prendre en compte la variabilité temporelle (Cayre et al., 1999; Mix et al., 1999). L’autre problème des fonctions de transfert peut être la présence d’analogues modernes non pertinents, dans lesquels la composition des assemblages est influencée par un autre paramètre que celui reconstruit. Dans ce chapitre nous mettons en évidence que la suppression de la base de données de tels échantillons, en l’occurence non pas influencés par les températures mais par la structure trophique, permet de proposer une solution au paradoxe des températures du Pacifique Ouest pendant le dernier stade glaciaire.
Résumé de l’article en anglais (soumis le 13 mars 2002 à Paleoceanography)
Les températures des eaux de surface du Pacifique Ouest équatorial ont été reconstruites pour les 180 000 dernières années en utilisant deux méthodes indépendantes : les alkénones et les fonctions de transfert basées sur les foraminifères planctoniques dans la carotte IMAGES MD97-2138 située au Nord de la Papouasie Nouvelle Guinée. Pour la fonction de transfert basée sur les foraminifères planctoniques, pour éviter les biais liés à la dissolution et à la structure de la colonne d’eau, nous avons développé une nouvelle fonction de transfert régionale (TROP-2), que nous avons calibré avec des sédiments de sommets de carotte excluant la zone Est Pacifique où les abondances de Neogloboquadrina dutertrei. Cette anomalie résulterait plus probablement de l’écosystème particulier riche en nitrate et pauvre en chlorophylle (zone HNLC) que de la température ou de la profondeur de la thermocline. En utilisant cette nouvelle fonction de transfert, la différence de température des eaux de surface entre le dernier maximum glaciaire et le sommet de carotte est comprise entre 0.1-1.3°C en accord avec les estimations de CLIMAP. Toutefois, l’amplitude dernier stade glaciaire/Holocène atteint des valeurs plus grandes de 2.2°C, pour les deux méthodes. Pendant les 30 derniers ka, les températures les plus froides régnaient il y a environ 18 cal. Ka BP, postérieurement au dernier maximum glaciaire s.s. ; l’intervalle le plus chaud a eu lieu entre 9 et 5 cal. Ka BP, dans l’Holocène récent. La différence de température entre le stade 6 et le stade 5 est d’environ 2°C en utilisant les foraminifères planctoniques, et de 0.9°C avec la méthode des alkénones. Nous concluons que dans le Pacifique ouest équatorial, une stratégie de calibration des fonctions de transfert prenant en compte la structure des écosystèmes donne de meilleures estimations des températures des eaux de surface. En utilisant cette méthode les intervalles les plus chauds et les plus froids ne sont pas synchrones, respectivement, des périodes modernes et du dernier maximum glaciaire. L’amplitude totale de variations des températures des eaux de surface dans le Pacifique équatorial est d’environ 2-3°C au cours du Pléistocène récent.