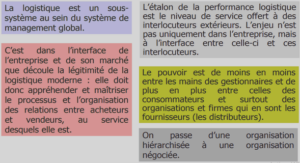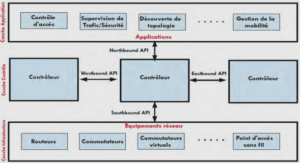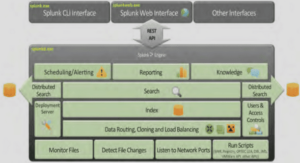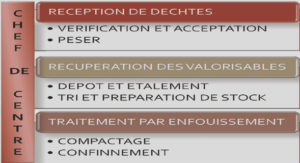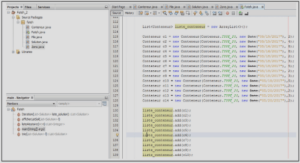Témoignage des totalitarismes à la compréhension française
Notre hypothèse de travail repose sur l’idée que l’identité personnelle se donne dans le récit de soi, qui lui-même se produit dans une relation d’interlocution avec la communauté choisie par l’auteur qui, par ses discours, tente de se lier avec la communauté de lecteurs.
Dans le cas de l’auteur exilique, la relation se complexifie puisque le territoire d’arrivée et la figure de l’auteur sont soumis à un imaginaire socio-discursif qui a tendance à agir comme une catégorisation figée et empêche toute modification ou adaptation de cet imaginaire.
Cependant, nous avons montré que l’arrivée en France génère une prise de conscience du caractère stéréotypique de leur portrait de la France. Cette déviation entre imaginaire et réalité implique alors une redéfinition de son rapport au territoire de l’habitabilité et modifie l’ethos de l’écrivain qui, d’une position extérieure voulant rejoindre le refuge spirituel, modifie son visage en se représentant comme héritier-défenseur de la culture française.
Ce positionnement au sein du champ français se légitime par une étrangeté réappropriée : elle n’est plus un stigmate qu’il faut effacer, mais le motif d’un regard singulier sur l’espace français. Nous pensons que les auteurs légitiment leurs prises de parole par le fait qu’ils se présentent comme des lecteurs des mutations du modèle français qu’ils estiment en voie de « rhinocérisation ». Toutefois, un des marqueurs de leur habitation de l’espace français est celui de la « commémoration négative » du totalitarisme.
Cette expérience est rejetée comme néfaste et les auteurs refusent d’en faire le centre de leurs œuvres puisqu’ils ne veulent pas être catégorisés comme produisant des témoignages exotiques. À l’image du propos de V. Čolić, que nous avons reproduit précédemment, les auteurs semblent « enterrer » leur passé pré-exilique afin de ne pas en faire un marqueur de leur identité narrative et de pouvoir s’assimiler à l’espace français.
Cependant leur lecture post-exilique de l’espace français génère un retour du sentiment d’intranquillité qui a marqué le choix de l’exil et le nécessaire questionnement de leur mémoire du soviétisme. Nous pensons que dans ce mouvement les auteurs opèrent le passage d’une commémoration négative du soviétisme à une réflexion sur celui-ci qui mène à l’intégration de la mémoire du soviétisme comme l’un des jalons de leur visage discursif.
Aussi, nous aimerions avancer l’idée que la mémoire des totalitarismes des francophones choisis d’Europe médiane refait jour dans leurs œuvres, non comme témoignage, mais comme outil de lecture de la société française.
Les études sur le lien entre communication et mémoire 489 ont mis en évidence le fait que la pensée testimoniale établit un lien particulier entre les interactants du discours : relation qui porte sur la fiabilité du témoignage1412, mais également sur la relation de confiance qui s’établit entre les récepteurs et le locuteur qui avoue une faute1413.
Si l’on s’intéresse à la rhétorique de l’aveu, la structure d’analyse mise en place par Emmanuelle Damblon peut venir nourrir notre analyse. En effet, elle note l’importance de l’aspect relationnel de cet acte. À première vue, on insistera sur le fait que les verbes « révéler » et « dévoiler » présupposent que le contenu propositionnel était caché jusque là. L’intérêt pragmatique de l’acte réside ainsi principalement dans ce que l’information apportera à l’auditoire.
Dans ce cas, le contexte pourra être nettement marqué institutionnellement alors que l’information fournie sera importante. En outre, cette information aura d’autant plus de valeur qu’elle dévoilera un contenu caché jusque-là : un secret. À l’inverse, on dira que le verbe « confesser » insiste sur l’acte lui-même et sur ce qu’il implique pour le locuteur qui se livre à la confession.
Ici, la relation entre l’orateur et l’auditoire ainsi que le contexte institutionnel qui le sous-tend prendra le pas sur le contenu propositionnel. Ce qui compte dans la confession est davantage le fait de se confesser que le contenu de l’information
L’aveu se démarque de la confession en ce qu’il concentre l’intérêt sur l’information, tandis que dans le cas de la confession, c’est l’acte qui agit comme contenu informationnel. Selon nous, la mémoire qu’usent les auteurs de la francophonie choisie ne porte ni sur l’aveu, ni sur la confession, mais réalise bien un acte communicationnel.
En effet, selon nous leur acte mémoriel ne vise pas principalement à apporter une connaissance historique méconnue par le public de réception, mais à accentuer l’importance de la mémoire l’infra-ordinaire du vécu soviétique.