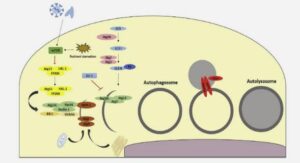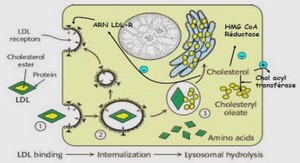Suivre la constitution de collectifs, un point d’articulation entre SIC et STS
Comment se forment les collectifs autour de la biodiversité ? Par quelles unités empiriques les saisir ? Interroger la recherche scientifique par les unités sociales que constituent les collectifs est une manière de reconnaître le caractère multiforme de l’activité de recherche, ainsi que l’hétérogénéité des intérêts et des ressources qui y sont mobilisés. Dans l’introduction au dossier récent « Science et collectifs », Granjou et Peerbaye (2011) réaffirment l’importance de « rendre compte du travail d’assemblage des collectifs » (p10) en reprenant des questions relatives à la division du travail ou aux identités professionnelles. En suivant ces auteurs, il s’agit de revenir ici sur deux déplacements7 centraux pour l’approche que j’ai construite des collectifs de science : il s’agit d’une part du déplacement désormais classique opéré par les études de science qui permet d’appréhender au nombre des acteurs également des objets et des non-humains ; il s’agit d’autre part de l’approche en terme de mondes sociaux plutôt que de réseau indifférencié toujours dans l’optique de suivre au plus près ces phénomènes subtils que sont les phénomènes de communication et de circulation des savoirs. L’interactionnisme symbolique mobilisé par les études des sciences (Fujimura Star et Gerson, 1987) est le ciment de l’articulation que je propose entre études des sciences et sciences de l’information et de la communication. Ces différentes approches théoriques mettent en effet l’accent sur la question de la signification. Ces deux déplacements sont indispensables pour interroger les processus de communication autour des collectifs sur la question de la biodiversité : quels sont les dispositifs par lesquels la biodiversité se structure dans le paysage de recherche français ? Comment interviennent-ils dans les déploiements et les agencements de thématiques et d’acteurs ? L’accent mis sur les pratiques scientifiques n’est pas nouveau, la version anglophone de La vie de laboratoire de Latour et Woolgar date par exemple de 1979, alors qu’en 1992 Science as practice and culture (Pickering(ed)) comprend quinze contributions et de vifs débats. Les études de laboratoires (Latour, 1989 ; Callon (dir.), 1988) apportent un éclairage sur la production des faits scientifiques en rupture avec l’épistémologie « classique » (Bachelard, Koyré, Popper) et la sociologie des sciences fonctionnalistes mertonienne (Pestre, 2006). Ces analyses partent du constat d’un fort contraste entre les pratiques telles qu’elles sont vécues et commentées sur le vif, et la manière dont elles sont représentées ou discutées a posteriori. Les études d’anthropologie de laboratoire s’intéressent à la constitution de « boîtes noires » et à la production des énoncés qualifiés d’objectifs. L’observation ethnographique permet la description des multiples inscriptions, médiations et représentations qui sont à la base de la constitution de réseaux d’alliés. Les promoteurs de la théorie de l’acteur-réseau ne font pas de la solidité des faits le point de passage obligé des débats portant sur la logique interne des propositions8 mais le résultat d’un processus d’intéressement et d’extension de réseaux. L’anthropologie des sciences a particulièrement mis l’accent sur l’hétérogénéité des ressources mobilisées par les chercheurs et notamment le rôle de ce qui est nommé « nature » par les acteurs. Le principe de symétrie entre humains et non-humains, particulièrement cher à Latour, conteste le partage fondateur entre nature et société (Latour, 1991, 2004). Dans Politiques de la nature, Latour (2004) fait le constat, fort arrogant au vu de sa méconnaissance de l’écologie politique (Bonneuil, 2000), de ce qu’il juge être un total échec de l’écologie politique à faire entrer la nature dans la vie politique. Cet essai philosophique, à la suite de Nous n’avons jamais été modernes, montre les effets de la purification des hybrides destinés à être classés dans les catégories de la nature ou de la société. Il fait état de l’incapacité à prendre en compte les non-humains dans l’analyse sociologique des activités scientifiques. De tels travaux impliquent le développement d’approches empiriques décrivant précisément ce que recouvre l’hétérogénéité de l’activité scientifique, notamment le mode d’existence et d’action des non-humains, tout en étant attentif aux effets des catégories cognitives mobilisées par les chercheurs. Il semble ainsi que la purification des hybrides, leur répartition selon les catégories naturelles ou sociales, leur confère une signification déterminante pour ce qui est de leur circulation. En effet, nous n’avons pas le même rapport à une centrifugeuse, un oiseau, un échantillon de terre ou un agriculteur. Leurs incapacités à parler pour eux-mêmes et à défendre des intérêts propres autorise que des non-humains fassent l’objet, de la part d’humains, de multiples revendications. Contrecarrer ce partage au nom d’un principe de symétrie est une chose à laquelle j’adhère de manière théorique. Mais nier les effets de ce partage sur des circulations et sur les dynamiques relationnelles qui en résulte en est une autre, constituant une limite de l’approche proposée par Latour. Tenter de prendre au sérieux l’action de non-humain ne doit pas dispenser de considérer aussi la spécificité des traitements dont chaque groupe fait l’objet sur le terrain ; sinon on risque de faire advenir en tant qu’artefact une symétrie souhaitée par l’observateur. Si la description à l’œuvre dans l’anthropologie de laboratoire ne se donne plus un contexte et un format premiers, comme c’est le cas de Bourdieu et la notion de champ scientifique (1975), et donne la primauté à la description ethnographique, cette description se réalise selon la théorie de l’acteur-réseau dans une forme privilégiée : le réseau. De nombreuses critiques ont été émises à ce sujet ; Dubois reproche par exemple à cette logique de ne pas rendre compte des phénomènes d’agrégation et de l’acquisition de nouvelles propriétés (Dubois, 2007). Pour Jeanneret (2008), cette métaphore du réseau rabat des processus de signification sur des dimensions logistiques de la communication. Ce sont les dimensions sémiotiques et normatives en jeu qui semblent être sous-estimées par une telle théorie. Si le principe de « mise à plat » est heuristique (Latour, 2006) puisqu’il permettre de décrire la production des localités et des globalités9 , il me semble que l’interactionnisme symbolique offre d’autres ressources pour saisir ce qui se joue dans les productions collectives, notamment la coordination et la négociation entre acteurs de différents mondes sociaux (Fujimura Star et Gerson, 1987). En effet, derrière l’idée de mondes sociaux se trouve la question du sens que les acteurs donnent à une même activité, ou à un même objet. Les chercheurs et chercheuses du Tremont Research Institute analysent la coordination au sein du travail scientifique et dans l’interaction avec des non-chercheurs. Dans un article devenu célèbre, Star et Greisemer (1989) analysent par exemple le partage de méthodes de collecte et de traitement des spécimens professionnels, d’amateurs et d’administrateurs à l’activité d’un Muséum ; ils s’intéressent particulièrement aux « objets-frontière » constituant des appui à la coordination du travail collectif. Une telle approche s’intéresse à « l’action performative des artefacts de connaissances dans la production des savoirs (classification, catégorisation, standardisation matérielle, etc.) » (Trompette et Vinck, 2009, p 5-6).
La biodiversité, un vecteur de rationalités environnementales ?
La biodiversité participe-t-elle à une nouvelle rationalité environnementale ? Elle constitue « une des figures de l’intérêt général dont la légitimité est fondée sur l’importance des questions environnementales au niveau international » (Lepart et Marty, 2006, p 487). Apparue lors du « National Forum on BioDiversity » aux États-Unis, la question de la biodiversité est indissociable des enjeux de sa protection (Marris, 2006). Les biologistes de la conservation américains à l’origine de cet événement cherchent explicitement des moyens d’alerter l’opinion publique et les décideurs sur une situation qu’ils jugent préoccupante, et urgente (Takacs, 1996). De fait, les collectifs de science ne s’en tiennent pas à la production de connaissances mais élaborent des discours, font exister des catégories, des espaces et des institutions à l’origine de nouvelles formes de rationalité. Les rapports entre savoirs et pouvoirs sont en effet très sensibles dans l’appropriation et la promotion des questions relatives à la biodiversité. Comment rendre compte précisément des phénomènes de rationalisation sans évacuer leur singularité, leur diversité ainsi que les mécanismes de résistance qui sont à l’œuvre ? L’analyse de l’articulation entre connaissance et pouvoir, développée par Foucault à l’occasion de travaux généalogiques sur le pouvoir disciplinaire (1975) ou sur la sexualité (1976) est à cet égard particulièrement stimulante. La force de l’analyse de Foucault réside dans la prise en compte de multiples dimensions – espaces, discours, pratiques, règles – dans la mise en place de formes de rationalité propres à l’épistémé d’une époque. Par exemple, il montre comment, du XVI au XIXe siècle, la discipline s’immisce, par des logiques convergentes liées notamment à la connaissance du corps dans l’atelier, l’école, l’armée et l’hôpital. Se diffuse alors l’idéologie d’un corps docile et utile ainsi qu’une forme de pouvoir sur les individus et leurs comportements. Reprenant ces analyses, notamment la notion de gouvernementalité, certains auteurs parlent d’environnementalité (Luke, 1995 ; Agrawal, 2005) ou d’éco-pouvoir comme « gouvernement rationnel du vivant » (Lascoumes, 1994, p 9). Les formes de rationalités environnementales sont un axe important du courant de la political ecology (Benjaminsen et Svarstad, 2009 ; Castro-larranga, 2009) dont le risque est néanmoins une conception homogène d’un ensemble de pratiques aux effets spécifiques. Dans le cas de la biodiversité, on en vient à l’idée d’une certaine convergence des évolutions vers la rationalité économique du vivant. Aubertin, Boivert et Vivien (1998) analysent la crise de la biodiversité comme une crise de la représentation du vivant marquée par une réduction de cette notion à celle de ressource génétique. En effet, avec l’essor du génie génétique, les enjeux économiques se cristallisent pour les industriels (semenciers, agroalimentaire, production animale, cosmétique, pharmacie) autour des biotechnologies. Le Sommet de la Terre de Rio et la signature de la Convention sur la diversité biologique (CDB) constituent alors des moments importants lors desquels la conservation de la biodiversité est abordée en termes de valorisation marchande de ses composantes. Cependant, une telle marchandisation n’est pas nouvelle, la notion de ressource génétique émerge de la biologie soviétique des années 1920 et, suite à une longue carrière comme problème public mondial, arrive au sommet de Rio où elle est requalifiée en termes de biodiversité cultivée (Bonneuil et Fenzi, 2011). Ainsi, l’analyse des modalités de (re)qualification des problèmes et de leur apparition dans les « arènes » internationales demande un travail à partir d’archives pour disposer d’une analyse fine des dynamiques en jeu. La Convention internationale sur la diversité biologique est aujourd’hui ratifiée par 188 pays, confirmée par le sommet de Johannesburg en 2002. Cette convention est un accord juridiquement contraignant avec trois objectifs : la conservation, l’utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques 24 de la biodiversité. Face à ce troisième objectif, la souveraineté nationale sur les ressources biologiques et les droits de propriété intellectuelle sur les innovations biotechnologiques sont reconnus, posant ainsi les principes d’un marché de la biodiversité entre pays du sud et industries du nord (Aubertin, Pinton et Boisvert, 2007). Ce marché prendra la forme de contrats bilatéraux pour permettre la « bioprospection » tout en évitant la « biopiraterie ». Ainsi, la négociation d’un cadre juridique se fait entre différents acteurs en présence (ONG, États, industriels, organisations internationales et organismes de recherche) regroupés au sein de ce que Hufty (2001) qualifie de « champ de la biodiversité » et qu’il caractérise par des asymétries de pouvoir. La biodiversité est investie par un ensemble d’acteurs à l’appui d’un large courant idéologique : « Elle [la biodiversité] a en revanche offert une belle opportunité politique aux ONG, qui y ont trouvé une légitimation pour leur stratégie de déploiement planétaire sous l’égide de la gouvernance mondiale. La légitimité que la biodiversité confère aux ONG est due à la fois à sa rhétorique de la diversité, qui fait écho aux injonctions idéologiques et esthétiques du néolibéralisme et ouvre ainsi un espace aux ONG, et à la séduction globaliste intrinsèque à la notion de biodiversité. » (Dumoulin et Rodary, 2005, p 60)