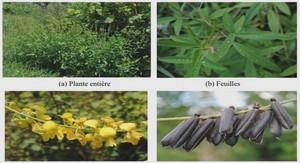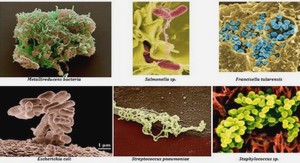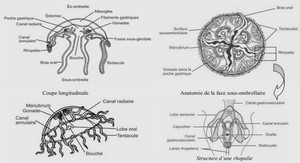Structure et fonctionnement des tannes du Sine Saloum
Le modèle des marais tempérés
Depuis longtemps de nombreux auteurs ont essayé de décrire le modèle des marais tempérés en se basant d’une part sur le mode de recouvrement par la marée (Massart, 1907; Jacquet, 1949) et plus récemment sur des critères hydrologiques, botaniques, sédimentologies ou pédologiques Verger (1968), d’autre part, pour distinguer la slikke et le schorre. Verger (1968) définit la slikke et le schorre à partir des trois critères : pédologiques ou sédimentologies, hydrologiques et botaniques. Avec le critère pédologique ou sédimentologie, la slikke est définie comme étant la zone constituée par des sédiments fins comprenant au moins 50% de vase sans évolution pédologique. L’utilisation du critère hydrographique caractérise la slikke comme étant une zone intertidale dont sa limite supérieure n’est pas atteinte par l’eau. Quant aux critères botaniques cette partie supérieure de la slikke peut posséder une végétation assez fournie. Avec le critère sédimentologie ou pédologique le sol du schorre est composé de matériel fin souvent lité ou stratifié, granulé plus ferme que celui de la slikke. Cependant le critère hydrographique le définit comme une zone inondable pendant les vives eaux ou pendant les tempêtes. Quant aux critères botaniques, cette zone présente une végétation halophile dense en dehors des marées et des chenaux.
Essai de superposition de la Slikke et du Schorre aux vasières et aux tannes
Tableau 2 : Essai de superposition de la Slikke et du Schorre aux vasières et aux tannes. Nous constatons que le schorre n’est atteint que pendant les marées de vives eaux et les tempêtes, alors que la tanne, peut être submergée ou non par les marées. Cette dynamique tidale peut induire des similitudes ; cependant, ce ne sont pas les mêmes types de marées qui les submergent. Sur les terrasses inondables, on rencontre les tannes vasières souvent assimilées à la slikke ; cependant, les particularités locales empêchent cette superposition. En revanche sur les terrasses moyennes, les terrasses hautes, le glacis de raccordement, dans les dépressions et sur les dunes, on retrouve des tannes d’aspects très variés et pourtant ces unités ne sont pas recouvertes par les marées basses ou hautes. Ainsi un autre aspect dynamique entre en jeu: la remontée des eaux de la nappe par capillarité. Ces nappes semblent être commandées par le rythme des marées.
Genèse des tannes
De nombreuses hypothèses ont été émises pour tenter de définir et d’expliquer l’existence des tannes soit par l’impact de l’homme sur le milieu, soit par les effets climatiques (vent, sécheresse), soit par la sédimentologie, soit par l’hydrologie. Les tannes présentent une dimension géographique considérable car on les rencontre au Sénégal, en Gambie, en Guinée, au Gabon, au Sierra Léone, à Madagascar, sur la façade Atlantique Américaine (au Costa Rica, à la Jamaïque, à Puerto Rico), en Inde, en Nouvelle Guinée, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, en Australie et sur la Côte Pacifique (Pérou, Equateur, Honduras et Salvador).
Le facteur anthropique
Gachet (1959) montre qu’à Madagascar les rapports forestiers de 1919 déplorent la formation des clairières au sein de la mangrove à la suite de l’exploitation abusive des essences les plus riches en tanins. Mais il note en même temps que ce phénomène est de courte durée. Gledhill (1963) estime qu’une partie des tannes de Sierra Léone est liée aux défrichements effectués pour l’aménagement des pêcheries au moins sur les sols les plus salés. Paradis (1979) fait un lien entre les nombreuses tannes de l’Afrique de l’Ouest, du Sénégal au Bénin, et l’extraction traditionnelle du sel (défrichement des palétuviers suivi de l’ablation par raclage de la partie superficielle du sol). A Madagascar, il semble plus exact d’affirmer que la destruction ou l’exploitation des palétuviers a précipité le processus de l’extension des tannes.
Facteur climatique
Certains facteurs climatiques comme le vent et la sécheresse sont pris en compte dans la genèse des tannes par certains auteurs.* Vents Certains auteurs comme Gledhill (1963) et Spenceley (1976) insistent sur l’action des vents et des cyclones tropicaux. Ces derniers, agents d’érosion, de transport et d’accumulation exhaussent la surface du sol, ce qui a pour conséquence la mort des palétuviers. * Sécheresse Des chercheurs comme Guilcher (1956), Baltzer et Lafond (1971) et Sneedaker (1978) ont mis l’accent sur les effets d’une sécheresse prolongée dans le processus de la tannification, tout en mettant en relief l’impact d’une forte évaporation qui est à l’origine de la dessication intense du sol. Cela a pour conséquence sur les secteurs touchés par les marées d’élever la salinité de l’eau interstitielle à des taux supérieurs à ceux de la mer et de créer soit une pellicule superficielle de sel à la surface du sol craquelé, soit de cristaux de sel dans le profil du sol. Dans le Bassin du Sine Saloum, cette sécheresse caractérisée par un déficit pluviométrique est l’un des facteurs permettant de mettre en évidence l’existence des tannes ainsi que leur extension par des processus géochimiques qui sont : la salure et l’acidification.
Le facteur sédimentologie
C’est sur le facteur sédimentologie qu’insiste Hervieu (1968) pour expliquer les tannes : « le changement dans la sédimentation n’est pas suffisant pour expliquer la disparition des palétuviers mais une progression du remblaiement de la mangrove vers l’aval qui cause l’émersion de plus en plus prolongée de ces zones ». Cependant, l’élévation du niveau du sol des mangroves résulte à la fois de l’accumulation de dépôts marins et terrigènes (poussières et sables d’origine éolienne, alluvions et parfois colluvions) notamment à la base des terrasses (Lebigre, 1983). Cette élévation est à l’origine de deux phénomènes : – d’une part, la diminution ou la disparition du mouvement quotidien du flux et du reflux de la marée sur le milieu, alors la mangrove n’étant plus touchée par les hautes mers de vives eaux, il découle un assèchement du sol superficiellement en dehors des périodes de pluies. – d’autre part par l’asphyxie des racines des palétuviers ; inversement avec ce que Lebigre (1983) a observé près de Tuléar des Avicennia officinalis qui maintenus ou reproduits dans ces secteurs complètement envahis par des dunes littorales. En d’autres termes, ce sont les phénomènes de compactage du sol et de salure qui sont les véritables instigateurs de la mort des palétuviers.
DEDICACES |