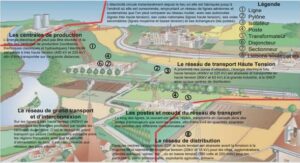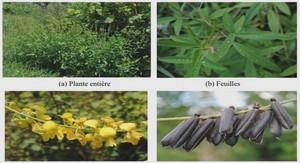L’agriculture n’a pas toujours été dans les préoccupations prioritaires dans le Monde. Pourtant ces dernières années, celle-ci a suscité un nouvel intérêt. Entre mi 2007-2008, la flambée des denrées alimentaires surtout des diverses céréales (mais, blés, riz…) a provoqué des émeutes de la faim dans de nombreux pays. Cette situation est particulièrement révélatrice de la dégradation de la situation agricole et alimentaire mondiale causée par une croissance de la demande en raison de l’accroissement démographique. Cette crise alimentaire s’est inscrite dans un contexte d’instabilité économique générale: la crise financière de 2008. En effet, 3/4 des habitants pauvres et ruraux vivent dans les PED. Cette population des PED demeure plus rurale qu’urbaine avec quelques 3 Milliard soit 55% de la population totale. Toutefois entre 2020 et 2025, la population rurale atteindra un pic avant d’entamer son déclin, ainsi la population urbaine de cette partie du monde dépassera sa population rurale.
A Madagascar, dans le monde rural, le secteur primaire y occupe une place prépondérante car près de 80% de la population active malgache vivent dans les zones rurales et tirent en partie leurs moyens de subsistance des activités agricoles (agriculture, élevage, pêche et forêt). Les exploitations agricoles de petite taille dominent puisque 70% des ruraux disposent d’une superficie cultivée annuelle de moins de 1,5 ha (AGRI 2014). Les paysans vivant dans ces zones rurales ont recours à leurs propres stratégies pour atteindre leur sécurité alimentaire et pour acquérir leurs propres besoins de base. Il en est ainsi des ruraux de la Commune d’Ambohibary Sambaina.
LOCALISATION DE LA ZONE DE RECHERCHE
Localisation administrative et géographique
La Région Vakinankaratra est limitée au Nord par les Régions Analamanga, Itasy et Bongolava, au Sud par la Région Amoron’i Mania, à l’Est par les Régions Alaotra Mangoro et Atsinanana et à l’Ouest par la Région Menabe. Elle est composée de 7 Districts dont : Antsirabe I, Antsirabe II, Betafo, Mandoto, Faratsiho, Ambatolampy, Antanifotsy.
Notre zone de recherche, la commune rurale d’Ambohibary Sambaina fait partie du District d’Antsirabe II. Elle est délimitée au Nord par la commune d’Antsapanimahazo, au Sud par la commune d’Antsoantany, à l’est par Mandrosohasina et à l’ouest par Vinaninony Atsimo.Sa localisation géographique est de 19°28’0’’ de Latitude Sud et 47°12’0’’ de Longitude Est. Elle est à 140 km de la capitale vers le Sud et à 38 km d’Antsirabe chef-lieu de la Région au Nord. Elle est desservie par la RN 7 qui relie Antananarivo à Tuléar, et la RN43 qui va de la commune d’Ambohibary au district de Faratsiho. Elle s’étend sur 220,69 km² avec une densité égale à 254 habitants au km² . Administrativement elle compte 19 Fokontany.
Géographiquement, Ambohibary Sambaina se trouve dans la bordure Sud Est du massif montagneux de l’Ankaratra, et culmine à 1 650 m d’altitude .Elle s’ouvre comme une immense cuvette lacustre, une des plus vastes et importante à l’intérieur de l’Ankaratra.
Historique de la zone de recherche
L’Ankaratra fut pour des raisons historiques, une montagne presque vide. Elle servait de frontière entre les deux royaumes ennemis Merina et Betsileo et n’était peuplée que par des groupes de hors la loi ou de bannis. Les riziculteurs des Hautes Terres Centrales considéraient l’Ankaratra avec ses marécages insalubres comme une région redoutable et mal fréquentée au climat hostile.
L’origine du peuplement de la plaine d’Ambohibary ne remonte pas très loin dans le passé cela s’est fait lors de l’expansion du royaume merina vers le sud. Au XIXe siècle, Andrianampoinimerina conquit le Vakinankaratra pour assurer la sécurité de ses liaisons avec la plaine de Tananarive, il tenta de « pacifier » l’ Ankaratra et créa un certain nombre de postes militaires, en particulier à Sambaina, au sud de la plaine d’Ambohibary.
La colonisation, au début timide, prit de l’ampleur au fur et à mesure que la conquête Merina, en se raffermissant assurait la sécurité. Ces premiers migrants ont apporté dans la cuvette ce qu’ils ont trouvé d’essentiel à leur survie : la riziculture. C’est ainsi que l’espace a été mis en valeur. Ce dernier offre aussi de vastes plaines pour cette culture du riz. Ils y ont su adapter la riziculture malgré les conditions climatologiques défavorables. La colonisation de la plaine d’Ambohibary s’est ainsi poursuivie tout au long du XIXe siècle. En 1920, la plupart des villages actuels de la plaine d’Ambohibary existaient déjà.
L’origine de la toponymie de la cuvette vient d’une personne dénommée «RANDRIATSISAKANANA dit RAVORONA » qui fut pionnier à Ambohibary et a baptisé le lieu de « Vohitry nyvary » qui est devenu ensuite « Ambohibary » ou village à vocation rizicole. C’étaient des ressortissants des Régions Nord qui ont migré à Ambohimahasoa avant de s’installer à Ambohibary. De nos jours Ambohibary fait partie du versant de l’Ankaratra où il ya une forte concentration de la population particulièrement dynamique pour les activités agricoles.
Agriculture familiale
Définition
« L’agriculture familiale (family farming) désigne une des formes d’organisation de la production agricole regroupant des exploitations caractérisées par des liens organiques entre la famille et l’unité de production et par la mobilisation du travail familial excluant le salariat permanent. Ces liens se matérialisent par l’inclusion du capital productif dans le patrimoine familial et par la combinaison de logiques domestiques et d’exploitation, marchandes et non marchandes, dans les processus d’allocation du travail familial et de sa rémunération, ainsi que dans les choix de répartition des produits entre consommations finales, consommations intermédiaires, investissements et accumulation » .Le type de travail auquel il est fait recours est un marqueur du caractère familial de l’exploitation.
Caractéristiques de l’agriculture familiale
Selon SOS FAIM à travers le site www.agriculturesfamiliales.org, les agricultures familiales ont cinq principales caractéristiques qui les différencient d’autres formes d’agriculture, à savoir : la structure familiale, la fonction nourricière, la fonction environnementale, la fonction culturelle et la fonction sociétale.
L’agriculture familiale à Madagascar
Définition
Les exploitations agricoles familiales nourrissent la population en riz, mais aussi en viande, légumes et fruits et produisent pour l’exportation : girofle, vanille, sucre, litchis, huiles essentielles, vanille, sucre, café, etc. Elles utilisent des stratégies issues de leur expérience pour gérer efficacement leur espace cultural.
Caractéristiques de ces agricultures familiales malgaches
La majorité des exploitations familiales ont de faibles capacités productives : elles ont de petites superficies (70% cultivent moins de 1,5 ha), peu d’équipements, et utilisent peu d’intrants. Les contraintes sont fortes (cyclones, inondations et sécheresses, attaques acridiennes, variabilité de la pluviométrie, sols fragiles) et les rendements souvent faibles.
L’agriculture familiale malgache est essentiellement orientée vers la production pour l’autoconsommation, puisqu’environ 75% de la production vivrière des ménages ruraux est autoconsommée (INSTAT, 2011). Ainsi, les exploitations familiales produisent d’abord pour leur propre consommation, et les stratégies de production développées par les chefs de ménage visent à assurer la satisfaction des besoins alimentaires. L’agriculture familiale serait surtout de subsistance avec des productions vivrières diversifiées, alors que le modèle souvent promu correspond à des exploitations spécialisées et orientées vers la production commerciale. Mais ces stratégies de sécurité alimentaire trouvent leur raison d’être dans les risques auxquels doivent faire face à la fois d’une part le chef d’exploitation dans ses choix de production et d’autre part ceux du chef de famille pour satisfaire les besoins de sa famille. Importants, ces risques sont à la fois naturels et économiques tels les fluctuations de prix et surtout la faible rémunération du travail que permettent les prix à la production, la grande asymétrie d’informations, l’enclavement et le manque de débouchés, les rapports de prix défavorables entre prix des produits agricoles à la production / prix des intrants, prix à la production des produits agricoles / prix des denrées alimentaires dans la zone de production.
Comme les données l’attestent, l’agriculture familiale assure aussi la plus grande part de la production commercialisée. Les exploitations familiales commercialisent 25% de leurs productions vivrières (riz, manioc, etc.), produisent 45% des productions industrielles nationales (arachide, canne à sucre) et plus de 90% des produits de rente comme la vanille, le café et le girofle (INSTAT, 2011) .
INTRODUCTION GENERALE |