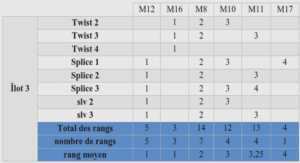L’importance accordée à la communication au sein des organisations travaillant à Madagascar ne cesse de s’accroître chaque jour. Considéré comme un élément optionnel à son apparition, la communication est devenue aujourd’hui un pilier fondamental et stratégique dans le plan de développement des organismes. Nous remarquons également au niveau des entreprises à vocation commerciale, notamment les filiales de groupes internationaux, le développement de la communication institutionnelle, c’est-à-dire la communication axée sur l’identité et les valeurs de l’entreprise, et en particulier la multiplication des activités de mécénat et de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE).
L’Ethnographie de la Communication
L’Ethnographie est la discipline scientifique chargée de décrire l’origine, les mœurs et le développement économique et social des peuples. Préconisée par les anthropologues, l’approche ethnographique est une façon d’aborder une étude qui privilégie l’observation, plus précisément le travail sur terrain, afin d’éviter l’introspection. L’observation peut être directe (travail sur le terrain) ou indirecte (travail sur des documentations).
Origines de l’Ethnographie de la Communication
Dell Hymes, un linguiste et anthropologue américain, est le précurseur de l’Ethnographie de la Communication. Partant du constat que « la communication est un phénomène social et culturel », il propose en 1962 d’étudier la communication à travers ses réalisations effectives et concrètes (la parole) et en la replaçant dans son contexte naturel (la société). En 1970, D. Hymes constate que la parole ne constitue pas le seul moyen de communication de l’homme, mais il existe aussi l’écrit (communication verbale) et les autres codes, notamment le comportement. L’ethnographie de la communication est donc née. La publication de l’ouvrage Vers la compétence de communication en 1972 consacre la discipline.
Rôle fondamental du comportement
D’après D. Hymes, tout comportement est une communication, tout comportement communique quelque chose. Son décodage est compliqué pour deux raisons :
– les attitudes varient suivant la culture des individus en présence,
– les participants à la communication peuvent percevoir différentes communications simultanément.
Implications théoriques
Des compétences indispensables
La communication étant un phénomène complexe, elle requiert une aptitude à communiquer, une compétence, de la part des individus communiquants. Nous pouvons distinguer deux types de compétences : les compétences linguistiques et les compétences de communication.
Les compétences linguistiques
Il s’agit de la capacité que doit posséder l’usager d’une langue pour satisfaire le profil du « locuteur idéal », autrement dit « l’idéal type » pour « les situations idiomatiques ». Le profil de « locuteur idéal » se réfère donc à la capacité d’un sujet à : produire des phrases appartenant à une langue donnée, à comprendre ou interpréter des phrases appartenant à cette langue et à rejeter les phrases n’appartenant pas à cette langue.
La compétence linguistique d’un sujet se mesure par le biais de trois composantes:
– les aptitudes linguistiques (l’expression orale, l’expression écrite, la compréhension orale, la compréhension écrite),
– les niveaux d’analyse linguistiques (quatre branches de la linguistique)
– les niveaux de langue (le niveau soigné ou élaboré, le niveau courant, le niveau familier ou relâché).
Les compétences de communication
Les compétences de communication sont au nombre de cinq :
– la maîtrise linguistique qui fait référence au code verbal et donc, à la compétence linguistique ;
– la maîtrise discursive, autrement dit la « cohérence textuelle » : savoir agencer son texte/discours, car communiquer équivaut à émettre un ensemble de phrases et non des phrases isolées ;
– la maîtrise référentielle : le contrôle des éléments de la réalité extra linguistique, attendu que c’est la langue qui découpe la réalité ;
– la maîtrise relationnelle : la propension à identifier le statut et le rôle du partenaire en communication et à en tenir compte ensuite par le respect des règles qui conviennent à son identité ;
– la maîtrise situationnelle : l’aptitude à produire des énoncés adaptés aux différentes situations ou circonstances de communication.
Le modèle « SPEAKING »
Les SIC distinguent deux types de situation de communication :
– la situation immédiate : la situation de communication proprement dite,
– la situation globale : la situation non présente au moment où l’on communique mais qui influe sur le déroulement de la communication. Cette définition fait surtout allusion aux systèmes d’appartenance des participants évoqués par Riley et Riley .
Dans l’objectif de déterminer les paramètres d’une situation de communication (immédiate), D. Hymes remanie en 1972, le modèle « SPEAKING », qu’il a conçu dix ansplus tôt en vue d’étudier les mécanismes des échanges langagiers. Le modèle doit son nom au fait qu’il se compose de huit éléments dont les initiales en langue anglaise forment le mot « SPEAKING ». Ces huit paramètres renvoient aux différentes composantes de la situation de communication :
Setting (la situation ou le cadre) : Le cadre se décompose en deux éléments : le cadre « physique et matériel» et le cadre socioculturel ou « scène ». Le cadre « physique » luimême comprend deux éléments : le lieu cadre et le moment où se déroule la communication. La « scène » ou le cadre socioculturel touche les différents domaines sociaux et culturels concernés par la communication.
Participants (les participants) : Chaque individu pouvant être à la fois émetteur et récepteur, les SIC préfèrent le terme « participants ». Ce paramètre définit la situation en fonction de l’importance numérique de participants, de leur répartition, des relations qu’ils entretiennent, du caractère direct ou médiatisé de la communication, et, enfin, s’il s’agit d’une communication publique ou privée.
Ends (les finalités) : Il s’agit de la finalité et des objectifs de la communication – «Communiquer pour quoi faire ? », et la notion de « finalité » renvoie en fait aux différentes fonctions de R. Jakobson .
Acts sequences (les actes) : Le déroulement de la situation est composé de plusieurs étapes à observer. En effet, la situation de communication se divise en événements qui se subdivisent eux-mêmes en actes de communication. On peut ensuite distinguer entre communication ritualisée et non ritualisée.
Keys (le ton) : La tonalité de la communication couvre l’atmosphère, l’accent, la manière et l’esprit dans lesquels se déroule une communication. La tonalité peut être positive, négative ou neutre. Elle peut être également conflictuelle (agressive) ou coopérative.
Instrumentalities (les instruments) : La communication peut utiliser trois types d’instruments : le code, le canal et les variétés linguistiques.
Norms (les normes) : La communication est régie par trois types de normes : les normes langagières, les normes d’interaction et les normes d’interprétation.
Gender (le genre) : Il s’agit de la catégorie formelle dans laquelle s’inscrit une communication. Elle dépend de trois critères : la fonction (objectif), le secteur et les éléments-cadres de la communication.
INTRODUCTION |