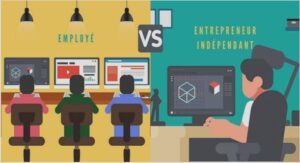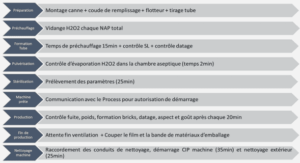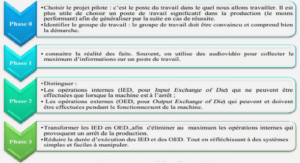Sartre, Jankélévitch, Nabert : temps et morale au cœur du XXème siècle
Bergson retrouvé : De la critique de la psychologie à la reprise de la morale ouverte
De l’Essai aux Deux Sources : Nabert et le bergsonisme retrouvé « L’instance suprême et l’unique juridiction du philosophe, c’est l’expérience intérieure ». Ce sont les mots de Jankélévitch246 pour qualifier la philosophie de Bergson, mais ils pourraient tout aussi bien ressaisir à eux-seuls toute la pensée de Nabert. Alors que les références bibliographiques sont rares dans le corpus nabertien247, et s’effacent plutôt derrière un commentaire implicite des doctrines, le nom de Bergson apparaît explicitement dans tous les livres de Nabert. La relation de Nabert à Bergson a considérablement évolué depuis L’Expérience intérieure de la liberté, dans laquelle il lui reproche une conception irrationaliste de la liberté, jusqu’aux Eléments pour une éthique, qui reprennent des traits caractéristiques de la morale bergsonienne. Suivons alors trois moments marquant de la relation de Nabert à Bergson : la confrontation à la conception bergsonienne de la liberté entre l’Essai sur les données immédiates de la conscience et l’Expérience intérieure de la liberté248 ; l’analyse de l’instinct virtuel dans les Deux Sources qui a particulièrement intéressé Nabert ; l’intégration dans les Eléments pour une éthique de la morale ouverte au chapitre consacré à la vénération. L’instinct virtuel dans les Deux Sources Nabert propose d’entrer dans les Deux Sources par la notion d’instinct virtuel, qui est effectivement centrale dans le livre. L’instinct virtuel joue une fonction analogue à celle que joue l’instinct pour l’animal mais en agissant par l’intermédiaire de moyens humains, psychologiques qui relient le vital au social. L’obligation sociale, qui fait l’objet du chapitre I, est un instinct virtuel, tout comme la fonction fabulatrice du chapitre II qui a également pour vocation « d’attacher l’homme à la vie249 ». Comme le note Frédéric Worms, « ce qui permet à Bergson (…) de passer du social au vital, de l’obligation à l’instinct, ce n’est pas l’habitude en elle-même, c’est la solidarité organique entre toutes les habitudes au sein d’une société250. » L’organisation des volontés par l’obligation imite un organisme et c’est l’habitude qui joue le rôle de la nécessité dans la nature251. Ce qui intéresse particulièrement Nabert dans sa lecture des Deux Sources, comme beaucoup de critiques à l’époque252, c’est le lien entre l’Evolution créatrice et le dernier livre de Bergson. Le statut de la sociabilité lui semble ainsi indécidable dans l’Evolution créatrice, apparentée à l’intelligence plutôt qu’à l’instinct. La lecture de Nabert part donc du concept d’instinct virtuel, il en fait même le point de départ des Deux Sources qui, en affrontant le problème de l’instinct dans les relations humaines, découvrent ensuite la distinction du clos et de l’ouvert. On comprend alors, grâce au concept d’instinct virtuel, le lien que beaucoup de critiques ont manqué entre l’Evolution créatrice et les Deux Sources. C’est donc bien, pour Nabert, « par les instincts virtuels et par l’expérience mystique253 » que Bergson rencontre le problèmes de la vie morale et religieuse. C’est le rapport aux instincts virtuels qui marque le départ entre l’humanité obéissant à l’obligation pure avec son intelligence et sa frange d’instinct et la sublimité morale de la surhumanité mue par l’émotion créatrice. L’instinct, fût-il virtuel, fût-il une imitation psychologique et sociale de l’instinct biologique, maintient l’humanité en-deçà de la moralité sublime, en la soumettant aux contraintes de la vie, de l’espèce – c’est toute la différence entre « la religion de l’espèce », la religion statique, et « la religion de la création », la religion dynamique. La conception de l’intelligence formulée par l’Evolution créatrice permettaitelle de comprendre le rôle des religions dans l’histoire humaine ? Pouvait-on faire de ces croyances l’œuvre de l’intelligence ? C’est précisément là que l’instinct virtuel entre en scène, comme ce qui lie l’intelligence et l’instinct, le social et le vital. Nabert voit dans l’instinct virtuel toute la continuité qu’on a voulu nier à l’œuvre bergsonienne entre l’Evolution créatrice et les Deux Sources. La religion est donc liée à une exigence de la vie, incorporée au phénomène social par l’instinct virtuel de la fonction fabulatrice : « Faite pour la vie, la religion est tenue d’inscrire ses fables sur le registre de l’intelligence254. » Dans l’obligation comme dans la fable, c’est bien l’instinct qui s’insinue et se dissimule dans l’intelligence. Si la discussion de l’instinct virtuel permet à Nabert de penser la continuité de la doctrine « bio-spiritualiste » bergsonienne, ce qu’il retiendra des Deux Sources, c’est sans doute que, dans la philosophie de la durée, « le message mystique et son contenu font corps avec le moment historique, personnel, concret de la révélation255. » Dans les Eléments pour une éthique, Nabert rejoindra Bergson dans la même opposition aux idéalismes qui attribuent, de l’extérieur et a posteriori, une dimension éternitaire aux religions historiques. Au contraire, Nabert, comme Bergson, conçoit la révélation comme coïncidence du devenir et de l’éternité, de l’histoire et du transhistorique. Alors que l’idéalisme la fera coïncider avec un moment dialectique du développement de l’esprit, qu’il attribuera une direction à l’histoire, Nabert et Bergson la conçoivent comme l’inscription de l’absolu dans le temporel, ne donnant pas à l’histoire un sens univoque mais au contraire appelant à fermer l’histoire et à « la rouvrir sans cesse ». Il y a pour Nabert quelque chose comme une transfiguration du bergsonisme entre l’Evolution créatrice et les Deux Sources : l’intuition telle qu’elle était conçue dans le cadre d’un naturalisme spiritualisme ne pouvait saisir adéquatement l’élan d’amour de l’émotion créatrice – « une nouvelle lumière baigne toute la doctrine256. » C’est pour cela que l’expérience mystique prend le relais de l’intuition. Plutôt que de partir de l’histoire pour la transcender vers la métaphysique, Bergson part de l’expérience mystique, moment où la métaphysique s’est faite parfaitement histoire. Entre l’Evolution créatrice et les Deux Sources, on passe d’une métaphysique de la durée à une métaphysique de l’amour, et dans ce passage, si l’on peut dire, Nabert se convertit au bergsonisme.
L’appel du héros et la vénération
Les Deux Sources, cette « œuvre de si haute portée259 » pour Nabert260, produit des effets inattendus sur sa propre philosophie. Alors que la morale ouverte et l’exemple des grands mystiques surgissaient tel un coup de théâtre dans les Deux Sources, le chapitre conclusif des Eléments consacré à la vénération a été préparé par la réflexion des données de l’expérience pour la conscience seule, puis par l’approfondissement de la communication dans le commerce des consciences. Il y a comme un élargissement progressif qui étend l’envergure de la réflexion de chapitre en chapitre pour culminer dans un moment mystique final ; il y a comme un élargissement de la conscience qui, passée par l’épreuve de la faute, de l’échec, de la solitude, s’est confrontée à l’ascèse des fins et qui ne fait plus qu’une avec la dialectique de l’aspiration. La morale exemplaire des grands mystiques semble bien être la reprise la plus essentielle de Bergson par Nabert. Dans le chapitre final des Eléments, consacré aux sources de la vénération, Nabert part du même constat que Bergson, celui de la réalité du mysticisme, de son occurrence dans l’histoire : « de tout temps ont surgi des hommes exceptionnels en lesquels cette morale s’incarnait261 ». L’expérience mystique atteste bien, dans l’histoire, l’existence effective de cette morale ouverte. La morale ouverte est mue par l’émotion, principe psychologique et non pas rationnelle, qui se substitue à l’instinct. « en approfondissant ce nouvel aspect de la morale, on y trouverait le sentiment d’une coïncidence, réelle ou illusoire, avec l’effort générateur de la vie262 ». La vénération a-t-elle également cette dimension vitale chez Nabert ? Les sources de la vénération Une autre surprise attend le lecture qui parvient à la fin du livre III des Eléments. Alors que Nabert a pris ses distances avec la conception bergsonienne de la temporalité263, un trait de la moralité des Deux Sources réapparaît soudain : « la conscience peut et doit recourir aux exemples historiques de sublimité morale qui opposent à l’expérience de l’inachèvement de son ambition une preuve irrécusable en faveur de ce qui est au principe de son propre effort264. » Si la dialectique de l’aspiration a signé la distinction entre la temporalité bergsonienne et nabertienne, la dialectique de l’aspiration les réunit dans une conception commune de l’exemplarité morale. C’est donc dans l’histoire que la conscience peut trouver les occurrences d’actions qui incarnent l’absolu du principe – c’est l’éthique du témoignage qui développera le Désir de Dieu.
Chapitre I Vie, Existence, Temps : Discontinuité et oubli de la durée |