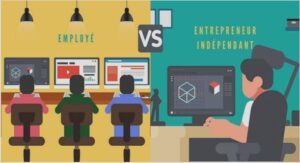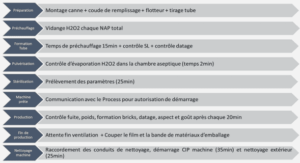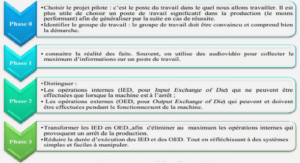Ressources limitées pour la mobilité : utilisation,
réutilisation, garanties
A l’intersection entre nature et culture : le paysage
Le paysage est une interface qui témoigne extrêmement bien de la multiplicité des perceptions, et des relations entre l’homme et la nature. Une multiplicité de facteurs entrent en ligne de compte dans la détermination de ces relations, à la croisée entre les facteurs dits objectifs, qui sont ceux des caractéristiques physiques et topographiques, et les facteurs subjectifs c’est-à-dire construits culturellement tels que les spiritualités. Le paysage est une interrelation particulière entre l’homme et la nature, un triptyque à la fois nature objective, mais aussi nature façonnée par l’homme et perçue par l’homme. Le paysage a tout d’abord une existence objective, hormis à être entièrement artificialisé par l’homme, il présente des caractéristiques naturelles objectives dépendant notamment de la géographie physique. Mais il devient réellement paysage, c’est-à-dire une unité de perception englobant des aspects naturels et culturels, à travers l’homme en deux façons distinctes : 1) la transformation de la nature par l’homme (agriculture, construction) 2) la perception à travers un prisme culturel de cette nature. Il est en cela représentatif de la perception de la nature par l’homme : la nature perçue passe par un double médium culturel, à la fois celui de l’action que l’homme a porté sur lui pour le façonner, mais aussi le médium de schèmes perceptifs forgés par la culture. Ainsi, face à un même paysage, à une unité à la croisée entre nature et culture, deux individus venant chacun avec un prisme culturel spécifique vont percevoir deux réalités différentes. Le paysage agit donc comme système de représentation de la nature. Cette nature est familière pour ceux qui l’ont intégrée à leur prisme culturel, elle s’est co-construite objectivement et subjectivement parallèlement à une histoire culturelle. Le paysage devient ainsi par là même un espace connexe où la nature et la culture se rencontrent et s’enrichissent mutuellement. Philippe Descola explique ainsi dans son cours sur « Les formes du paysage » au Collège de France que le paysage est une interaction entre un sujet qui perçoit et un site géographique. Tout support pour la perception est déjà perçu : cela implique l’existence de schèmes perceptifs et une idéalisation par le sujet pour qu’elle entre dans un stéréotype. Et ainsi de donner un exemple concret rencontré sur le terrain, en revenant sur un épisode qu’il a relaté dans son ouvrage Les lances du crépuscule, pour l’analyser a posteriori. En 1977, alors qu’il traverse la forêt équatoriale lors d’une visite à un village Achuar, il émerge après deux jours de marche en forêt interfluviale sur une vue de grand angle sur la plaine du Pastaza. Après une description très romantique de la sortie de cette forêt presque étouffante et de la découverte ébahie du spectacle de ce paysage, Philippe Descola décrit brièvement la réaction de son guide par les mots suivants : « Même les indiens paraissaient heureux d’émerger enfin de l’interminable tunnel verdâtre où nous progressions depuis deux jours. Ils s’assirent quelques temps sur les galets pour contempler en silence la vision majestueuse du grand fleuve, fixant d’un œil rêveur la mince ligne verte qui signalait la 120 reprise de la forêt sur l’autre rive. Wajari prononça un laconique “C’est beau”, seul jugement esthétique que je l’ai jamais entendu faire sur un paysage. » 92 En analysant cet épisode a posteriori, Philippe Descola prend conscience que ce qu’il avait analysé à l’époque comme un jugement de valeur n’en était peut-être (certainement même) pas un, car l’expression jivaro qu’il avait à l’époque traduit par « C’est beau » pouvait aussi dire « C’est bien », le même mot étant utilisé en jivaro pour exprimer les deux notions. Cela charge la scène d’une signification toute différente car le guide de Philippe Descola pouvait en cet instant n’exprimer que sa satisfaction sur le chemin parcouru, l’avancée réalisée et non pas un jugement de valeur sur ce paysage. Il n’en exprimait d’ailleurs probablement pas un, ce paysage lui étant habituel, alors qu’il coupait le souffle de l’anthropologue. Philippe Descola, lui, projetait une perception artistique sur ce paysage qui lui apparaissait comme édénique, vierge de l’empreinte de l’homme, et projetait ainsi sa culture sur le paysage qu’il voyait mais aussi sur la réaction de son guide. Il transformait donc le paysage en lui donnant une dimension qu’il projetait sur lui. De ce constat découle une évolution fondamentale, le sujet n’est plus un observateur d’un objet, mais il interprète un espace géographique qu’il a déjà transformé par son action. Il ne peut donc plus se placer sur une position extérieure mais il est un sujet pensant dont la pensée influe sur sa perception de la réalité, comme nous l’explique Merleau-Ponty : « Le paysage n’est un pur objet en face duquel le sujet pourrait se situer dans une relation d’extériorité ; il se révèle dans une expérience où sujet et objet sont inséparables, non seulement parce que l’objet spatial est constitué par le sujet, mais aussi parce que le sujet à son tour s’y trouve englobé par l’espace. Il constitue un excellent exemple d’espace habité, déployé en perspective à partir de ce que Moles appelle le point Ici-Moi-Maintenant, et s’oppose en tant que tel à la représentation cartésienne de l’étendue, fondée sur la séparation de la res extensa et de la res cognitans : “l’espace n’(y) est plus celui dont parle la Dioptrique, réseau de relations entre objets, tel que le verrait un tiers témoin de ma vision, ou un géomètre qui la reconstruit, ou la survole, c’est un espace compté à partir de moi comme un point ou degré zéro de la spatialité. Je ne le vois pas selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans, j’y suis englobé. Après tout le monde est autour de moi, non devant.” » 93 L’œil n’est donc ici plus qu’un outil, un support au service de la perception et de la production d’un réel conforme à un prisme culturel intégré et perpétué. La perception du paysage n’est pas uniquement le produit d’une image réceptionnée par l’œil et assemblée par notre cerveau, elle est aussi analysée et co-produite par notre cerveau. Ainsi, la frontière entre un existant objectif et un percevant extérieur n’est plus valable. En effaçant cette frontière, un nouveau questionnement apparaît : si notre perception du paysage est influencée par notre 92 Philippe Descola, Les formes du paysage, cours au Collège de France, 2012, https://www.college-defrance.fr/site/philippe-descola/course-2012-02-29-14h00.htm, consulté le 22 novembre 2016 93 Michel Collot, « Points de vue sur la perception des paysages », in : Espace géographique, Tome 15 n°3, 1986, pp.211-217, p.212, citation de Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit 121 culture, dans quelle mesure cette perception ne devient-elle pas la norme au point d’en modifier totalement le paysage jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’un reflet de notre interprétation de la nature par notre culture ? Où commence le sauvage et où commence le cultivé ? Reste-til même encore du sauvage ? Cette perception va même orienter le système de valeurs sur lequel nous pouvons nous baser pour évaluer la nature qui entoure, la nature sauvage au cours de l’histoire américaine a ainsi été tour à tour honnie puis encensée. Aujourd’hui, la wilderness est un terme piégeur, encensant à la fois les espaces de nature sauvage, exaltant les grands espaces en les aménageant pour que le grand public profite de ces espaces purs, mais en les aménageant on dénature la wilderness elle-même et la transforme en construction culturelle. Comme l’écrit aussi Merleau-Ponty, le paysage remet l’homme en son cœur, le rend acteur et non plus uniquement sujet extérieur. C’est une révolution à laquelle la peinture a énormément contribué, avec le paysagisme. L’homme ou l’inerte (nature morte) n’était plus l’unique sujet, mais se construit une représentation d’une réalité bien plus vaste, dépassant tout à fait l’homme et l’englobant, comme une partie naturelle de son tout. L’histoire de l’art est très intéressante à cet égard avec le passage pendant la Renaissance du paysage décor au paysage sujet. Prenons l’exemple de Patinir, qui fit de la peinture de paysage sa spécialité, au point que Dürer l’appelait le « Gut Landschaftmaster ». S’inspirant de Bosch, il fit sa spécialité des paysages en plans très larges au sein desquels des personnages minuscules apparaissent comme perdus dans l’immensité. Son œuvre Paysage avec Saint Jérôme montre une construction de l’espace et du paysage très complexe, avec une multitude de plans et une profondeur d’un paysage vaste dans lequel viennent s’intégrer des scènes de la vie quotidienne de personnages minuscules. Ainsi le paysage, et son appréhension, participent-ils d’une compréhension plus large d’un homme qui s’intègre désormais dans un environnement plus large.
De la nature merveilleuse à la nature dévoilée
Si dès la civilisation grecque les mouvements d’enquête de la nature se mettent en place, la nature reste en grande partie un mystère. Certains processus ont été pour partie dévoilés, mais la nature recèle encore de nombreux secrets, elle demeure encore cosmique et réservée au 139 domaine du divin. La notion de « phusis » grecque ne témoigne d’ailleurs pas seulement d’un aspect de spontanéité mais aussi de par la caractérisation même de la spontanéité du mouvement, d’un aveu de méconnaissance des causes du mouvement : « Quand le processus n’est pas encore en mouvement, la phusis, la Nature, Dieu, la Providence, la Raison divine sont identiques et Dieu est seul. Quand le processus cosmique se déploie, la Nature s’enfonce dans la matière pour former et diriger de l’intérieur les corps et leurs interactions. […] C’est ainsi que le mot phusis, qui signifiait primitivement un évènement, un processus, la réalisation d’une chose, en est venu à signifier la puissance invisible qui réalise cet évènement. » 94 On voit ainsi comment le caractère spontané de la création dans la nature semble être résolument lié à l’existence d’une puissance supérieure. De fait, l’absence d’explication, d’action ou d’intention n’étant pas envisageable pour l’esprit humain, comment expliquer l’absence d’explication si ce n’est par une forme qui n’est pas accessible à l’humain ? Ainsi, jusqu’à la Renaissance, la nature reste une forme de mystère, appartenant au royaume du divin. Jusqu’à la fin du Moyen-Âge, en dépit des volontés de dévoiler les secrets de la nature, celleci reste enveloppée d’un voile mystérieux, comme se dérobant à la compréhension des mortels. La progression des sciences ne permet certes pas de pouvoir en comprendre le processus, mais aussi l’emprise religieuse empêche une avancée trop rapide – comme en témoignent les déboires de Giordano Bruno, dont la théorie héliocentriste arrive dans un moment de crise de croissance entre la science et l’Eglise. A cet égard, le Moyen-Âge est une période charnière qui, prépare les révolutions de la pensée de la Renaissance, comme en témoigne l’analyse originale de William Eamon. Dans son ouvrage, Science and the Secrets of Nature, Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture, il s’emploie à analyser les ouvrages d’alchimistes ou de magiciens de l’époque, mis de côté par les historiens qui les classaient comme des formes de littérature ésotériques témoignant de l’emprise de la superstition à l’époque. Mais un examen plus détaillé de ce corpus d’ouvrages montre le rôle fondamental joué par cette littérature dans la progression de la connaissance populaire, préparant ainsi l’avènement des sciences modernes. De fait, en replaçant leur rôle dans l’histoire des idées plus large, les Livres des Secrets ont apporté une évolution fondamentale, celle du passage de la magie à l’expérimentation scientifique. Plus particulièrement en ce qui concerne les secrets de la nature, l’expérimentation est devenue, dans un contexte de recul progressif de la scolastique, comme le moyen de percer à jour les secrets du monde naturel, et en tant que tel de se rapprocher de la présence divine. 94 Pierre Hadot, Le Voile d’Isis, Gallimard, Paris, 2004, p.50-51 140 Parler de la nature au Moyen-Âge serait presque un anachronisme puisque la nature en tant que concept unifié n’a pas encore vu le jour. Celle-ci n’existe alors que dans les perceptions individuelles et uniques, non sous la forme unifiée de paysage. C’est ce que nous enseigne la lecture du poème « Ciel, air et vents » issu du premier Livre des Amours de Pierre Ronsard (annexe 3). Dès l’incipit, le poète annonce une programmatique du poème, d’ailleurs très utilisée à l’époque, celle du thème de la nature et de l’amour. Les deux premières strophes sont uniquement consacrées non pas à la description d’un paysage unifié mais à celle d’éléments individuels de la nature. On y retrouve une forme de nature magnifiée, presque sublime, habitée de couleurs variées (« verdoyantes » au vers 2, « roussoyantes » au vers 6 ou encore « blondoyantes » au vers 7). La liste des éléments naturels formerait presque une forme de paysage sublime s’il ne s’agissait pas d’une juxtaposition : « plaines », « forêts », « taillis », « prés », « plages », « rochers » relèvent ainsi plus de l’énumération que du paysage. Pas une seule fois la nature n’est citée dans son ensemble alors qu’elle habite le poème au point qu’elle pourrait presque incarner la bien-aimée dont nous entretient le poète, s’il n’y avait pas l’évocation de « ce bel œil ». Ainsi, ce poème s’inscrit dans la plus pure tradition de la poésie du Moyen-Âge, associant le thème de la nature à celui de l’amour. Mais comme l’écrit Michel Zink, il ne s’agit pas d’un « spectacle de la nature » comme chez les Romantiques plus tard, mais plutôt d’une « participation à la nature ». 95 Ainsi, l’époque médiévale est marquée par l’homme dans la nature, il est encore une force agissante au milieu d’elle et n’a pas encore opéré son retrait. En effet, à celui-ci est nécessaire le médium de la science, et l’affirmation du sujet, qui repousse au dehors de l’individu tout ce qui ne lui est pas propre. Mais cette période est fondamentale pour permettre l’émergence de la science moderne qui réalisera le déchirement. L’émergence de la science est permise par le changement de perception de celle-ci pendant cette période, la connaissance étant progressivement perçue comme un moyen d’accéder à la sagesse, à la connaissance du divin : « Pour l’auteur de l’Image du monde […] (Gossuin de Metz), comme avant lui pour Boèce, la “science” n’est qu’une étape vers la “sapience”. Il ne fait que refléter ainsi l’idée médiévale selon laquelle la compréhension de la nature mène à la connaissance de son créateur. [Le] Moyen-Âge sut 95 Michel Zink, « Nature et sentiment », Littérature – Altérités du Moyen-Âge, N°130, Juin 2003, p.44 : « [S]i le Moyen-Âge a bien imposé l’association de la nature et de l’amour, il ignore le spectacle de la nature et ne connaît que la participation à la nature. Si délicates, si précises, si évocatrice que soient les strophes printanières du lyrisme médiéval, elles ne décrivent jamais un paysage, mais suggèrent un contact avec la nature. C’est précisément que le Moyen-Âge ignore le sens moderne du mot nature, et voit dans la nature la puissance génératrice de l’homme et de la création, une puissance dont l’homme est trop dépendant et dans laquelle il est trop englobé pour pouvoir la contempler. » 141 faire la distinction entre la raison et la foi, il n’est pas inutile de la répéter, tant l’historiographie se complaît parfois à placer la civilisation de ces longs siècles sous la seule marque de la religion. » 96 Le Moyen-Âge a préparé la Renaissance à bien des égards, permis le développement des sciences et de la compréhension de la nature en faisant de la connaissance de la nature un prérequis pour accéder la compréhension du divin, à la sagesse. Le clergé, dans cette optique et pour Gossuin de Metz, est un passeur de connaissance, il est l’intermédiaire entre l’homme et Dieu, le passeur de connaissance de la nature. Comme l’écrit Dominique de Courcelles, la connaissance de la nature est un moyen de se rapprocher de la présence du divin : « La connaissance de la nature est une médiation sur le chemin de la connaissance de Dieu, cette connaissance qui fonde le sujet croyant et le sujet mystique ». 97 Le recours à la rationalité scientifique se trouve ainsi justifié dans une perspective théologique. Le clerc accompagne l’homme sur le chemin de la connaissance de la nature, et donc de Dieu, pour qu’il ne se perde pas. Le développement de la scolastique permet d’ailleurs de concilier l’héritage de la philosophie grecque et la théologie chrétienne, renforçant l’idée d’une nature système mystérieuse et puissante qui mène à la connaissance d’une puissance supérieure.98 La philosophie thomiste est à cet égard très intéressante car Saint Thomas d’Aquin est un des premiers à s’interroger sur la raison et la foi, à distinguer la théologie naturelle de la doctrine de la religion. Bien que s’appuyant beaucoup sur Aristote, il en réfute notamment le syllogisme, démontrant par là même que le fondement du thomisme est l’intelligence de la foi, la dissociation de la raison et de la nature.
INTRODUCTION |