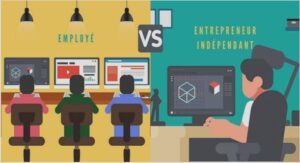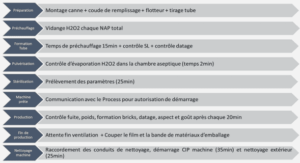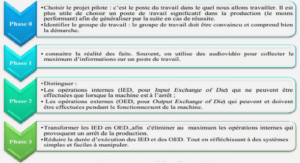Responsabilité sociétale : quelles contributions des entreprises à la conservation de la biodiversité ?
Contexte écologique, sociétal et institutionnel
Les conclusions de la communauté scientifique sont sans appel : nous connaissons une érosion sans précédent de la diversité du vivant à l’échelle des gènes, des espèces et des écosystèmes (SCBD 2010). Nous entrons ainsi dans la sixième extinction de masse de la biosphère (Ceballos et al. 2017). Les conséquences de cette dégradation de la biodiversité sont nombreuses et revêtent aussi bien des dimensions écologiques, que sociales et économiques, dans la mesure où cette érosion biologique conduit à une altération du fonctionnement des écosystèmes et de leur capacité à fournir des services dont nos sociétés dépendent (Chapin et al. 2000; Millennium Ecosystem Assessment 2005). La conservation de la biodiversité a été reconnue comme un enjeu majeur du développement durable dès 1992, à travers l’adoption de la Convention pour la diversité biologique (CDB) (Nations Unies 1992). Alors que l’objectif d’enrayer la régression de la biodiversité avant 2010 a été repoussé faute de résultats, le bilan de mi-parcours des objectifs d’Aichi (Annxe 2), qui cadrent l’agenda international 2011-2020 pour la conservation de la biodiversité, n’est guère plus encourageant (Tittensor et al. 2014). L’incommensurabilité de la biodiversité reste aujourd’hui pensée comme un frein à l’action. La complexité des interactions écologiques, des cycles biogéochimiques, les multiples dimensions que recouvre le concept de biodiversité sont régulièrement mises en avant pour relativiser les conclusions scientifiques. L’avis émis par l’Académie des technologies en décembre 2015 sur les liens entre biodiversité et aménagement du territoire est un cas d’école du développement du « biodiversité-scepticisme » (Barot et al. 2016) et de son utilisation pour différer le passage à l’action. Alors que l’objectif d’enrayer l’érosion de la biodiversité est inscrit dans des conventions internationales et dans les Objectifs de développement durable 2015-2030 (ODD 14 et 15), la communauté de la conservation dépense encore beaucoup d’énergie à démontrer, dans un effort de pédagogie, l’intérêt sociétal de conserver la biodiversité (ex : Barbault & Weber 2010). De nouveaux paradigmes relatifs à l’évaluation monétaire du capital naturel et aux services écosystémiques (Millenium Ecosystem Assessment 2003) se sont ainsi développés pour interpeler les décideurs en des termes qui leur sont ‘familiers’ (TEEB 2012) et ont infusé les sphères de gouvernance (Suarez & Corson 2013). Ces évolutions conceptuelles se sont accompagnées d’une évolution du positionnement de certains acteurs du champ de la conservation. Les institutions, mais aussi certaines organisations non gouvernementales (ONGs), ont ainsi démultiplié les appels aux entreprises à s’engager en faveur de la biodiversité. Ceci s’est traduit par l’adoption au sein de la CDB de décisions relatives à l’engagement du secteur privé qui reconnaissent « l’importance d’attirer les capacités des entreprises privées et commerciales » (COP10 CDB 2010) et invitent « les entreprises à aligner plus explicitement leurs politiques et leurs pratiques avec les trois objectifs de la Convention1 ainsi que ses buts stratégiques et cibles » 2 (COP8 CDB 2006). En France, cette orientation s’est retranscrite dans la création, par exemple, d’un dispositif d’engagement volontaire à la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). Elle se reflète également dans l’évolution de la posture de certaines ONGs environnementales vis-à-vis des entreprises. Nombreuses sont celles qui ont réduit leur activisme visant à dénoncer des pratiques illégales et/ou non durables, pour se focaliser davantage sur des activités de conseils aux entreprises et les accompagner dans une meilleure prise en compte de la biodiversité (Robinson 2012). Les entreprises ne sont ainsi plus seulement présentées comme des agents à réguler, mais aussi comme des partenaires, dont les ressources techniques, managériales et financières pourraient être mises à contribution pour conserver la biodiversité. Les liens de causalités entre activités anthropiques et dégradations écologiques sont à rapprocher de cinq mécanismes : la perte et dégradation des habitats naturels, le changement climatique, les pollutions (physiques et chimiques), la surexploitation des populations sauvages et enfin la diffusion des espèces exotiques envahissantes (Millennium Ecosystem Assessment 2005; SCBD 2010). Toutes les entreprises contribuent ainsi, à plus ou moins grande échelle, à ces pressions via leurs activités, leurs chaînes d’approvisionnement et les produits qu’elles délivrent. Parce qu’elles sont pour partie responsables de la crise écologique et qu’elles représentent des capacités opérationnelles et financières importantes, des attentes sociétales se sont ainsi 1 Ces trois objectifs sont : « la conservation de la diversité biologique; l’utilisation durable de la diversité biologique; le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques ». 2 “invites businesses to align their policies and practices more explicitly with the three objectives of the Convention and its goals and targets” (COP8 CDB 2006) (traduction personnelle). cristallisées autours des entreprises. Leur rôle dans la conservation de la biodiversité ne se limiterait pas au seul respect de la réglementation. L’hypothèse sous-jacente est double. Elle est à la fois (i) d’ordre normative : les entreprises ont des responsabilités écologiques au-delà de leurs obligations réglementaires, et (ii) d’ordre pratique : les entreprises sont en capacité de favoriser l’efficacité et l’ampleur des actions de conservation. Cette mobilisation des entreprises dans la conservation de la biodiversité s’inscrit dans leur responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), définie comme la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui : – contribue au développement durable […] ; – prend en compte les attentes des parties prenantes ; – respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; – est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations » (ISO 26000 2010; p.4). Si différentes définitions de la RSE existent (Dahlsrud 2008), nous adoptons dans le cadre de cette thèse, la présente définition proposée dans l’ISO 26 000, document issu d’un processus de négociation international et multi-acteurs, posant les lignes directrices de la RSE (Brodhag 2010). Considérant le respect de la réglementation comme un prérequis, nous délimitons comme relevant de la RSE, la contribution d’une organisation au développement durable allant au-delà des prescriptions juridiquement contraignantes. La RSE est donc comprise comme un complément, et non comme un substitut, aux instruments coercitifs. L’intégration concrète des enjeux de biodiversité aux stratégies RSE est encore relativement immature, voire embryonnaire, dans de nombreuses entreprises. Cela se reflète notamment dans les informations communiquées dans le cadre du reporting, qui sont souvent lacunaires (Boiral 2014; Boucherand et al. 2015). On observe cependant depuis quelques années, une structuration de la mobilisation des entreprises. Elle se concrétise notamment via l’émergence de plateformes permettant la coordination de groupes de travail et le partage des bonnes pratiques, via le développement très important d’outils d’évaluation des enjeux écologiques et via l’inscription de la biodiversité dans les cadres normatifs de la RSE. Si la contribution actuelle de la RSE à la conservation de la biodiversité paraît a priori restreinte, le sujet gagne clairement en importance, et la place accordée à la RSE évolue.
Construction de la problématique et questions de recherche
Cette thèse a pour objet d’analyser, d’évaluer et de faire évoluer la contribution des entreprises à la conservation de la biodiversité dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Elle couple ainsi deux objets traités dans des champs disciplinaires classiquement distincts : la biodiversité d’une part (principalement étudiée en écologie et en sciences de l’environnement), et d’autre part la RSE (principalement appréhendée par les sciences de gestion). Alors que la conservation de la biodiversité est reconnue 3 “What are the conservation impacts of corporate social responsibility regimes that are biodiversity oriented?” (Sutherland et al. 2009; p.566) comme un enjeu critique du développement durable, ce sujet est en grande partie resté en dehors de la recherche consacrée à l’étude des organisations et de la gestion des entreprises (Winn & Pogutz, 2013). Le rapprochement de ces deux concepts est de fait mis en tension par leurs représentations les plus communément employées : – la RSE est généralement comprise comme une démarche individuelle d’entreprise, alors que la biodiversité a une dimension intrinsèquement systémique et que sa protection résulte de démarches collectives ; – la gestion de la biodiversité est le plus souvent étudiée et organisée à l’échelle locale, alors que les moteurs de son érosion sont pour une large part globaux. Les étudier au sein d’un même projet de recherche implique donc de positionner la RSE dans un contexte de responsabilités partagées vis-à-vis de la dégradation de la biosphère, et d’appréhender la conservation de la biodiversité comme un enjeu de développement durable local et global. La RSE n’est pas étudiée dans les présents travaux de recherche sous l’ensemble des dimensions qu’elle recoupe. Sa dimension sociale, par exemple, n’est pas abordée alors qu’elle est au cœur du troisième objectif de la CDB sur le partage des bénéfices tirés de l’utilisation des ressources génétiques. L’angle d’attaque retenu est clairement instrumental, à savoir quels intérêts peut représenter la RSE pour la conservation de la biodiversité. La thèse s’articule autour de quatre questions de recherche : Q1 : Comment qualifier les responsabilités d’une entreprise vis-à-vis de la biodiversité ? Cette question d’ordre analytique pose le problème de la formalisation du cadre d’analyse des responsabilités écologiques d’une entreprise. Comment imputer les responsabilités d’un acteur quand la dégradation de la biodiversité est la résultante de pressions anthropiques cumulées, s’exprimant au niveau local et global ? Se place-t-on dans une perspective d’évaluation des moyens mis en œuvre ou des résultats obtenus ? Par rapport à quel référentiel : la performance relative (amélioration continue, benchmark sectoriel) ou l’atteinte d’un objectif spécifique (défini sur quelle base ?) ? Comment rendre compte, dans ce cadre d’analyse, du contexte économique dans lequel s’inscrit l’entreprise, des spécificités du système écologique affecté par ses activités, tout en restant à un niveau de généralité suffisant pour qu’il soit applicable à un ensemble de secteurs ? Q2 : Quelles formes prennent les initiatives de responsabilité sociétale portées par les entreprises en faveur de la biodiversité ? Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit de décrire et de classifier ce que proposent les entreprises. Quelles réponses les entreprises apportent-elles ? Avec qui les portentelles ? Quels enjeux écologiques sont pris en charge via ces pratiques ? Q3 : Les responsabilités écologiques sont-elles prises en charge de façon à rendre compatibles les activités de l’entreprise avec la conservation de la biodiversité ? C’est le passage du « test à l’acide ». Il s’agit d’évaluer si les pressions exercées sur la biodiversité par une entreprise paraissent compatibles avec les objectifs de conservation. Le postulat est que le respect des capacités de charge des écosystèmes est une condition nécessaire à la conservation effective de la biodiversité. Comment évaluer si les activités d’une entreprise respectent les limites écologiques ? Les pressions « étendues » sont-elles suffisamment bien prises en charge ? Q4 : Si cela est souhaitable, comment renforcer la contribution de la RSE à l’atteinte des objectifs institutionnels de conservation ? Cette dernière question a un caractère plus politique. Il s’agit de proposer des orientations stratégiques susceptibles de faire converger la trajectoire des acteurs vers le respect des limites écologiques et, autant que faire se peut, vers une contribution positive à la conservation de la biodiversité. Où se situent les marges de manœuvre des entreprises ? De quelle nature sont-elles ? Quelles implications cela peut-il avoir pour les politiques publiques ? Cette synthèse générale s’organise en quatre chapitres, complétés par six manuscrits (Figure 1). Le premier chapitre précise le positionnement académique dans lequel s’inscrit cette thèse, la stratégie de recherche adoptée et les terrains de recherche mobilisés. Le deuxième chapitre développe une analyse critique de la façon dont les responsabilités vis-à-vis de la biodiversité sont construites et traduites par les acteurs, pour ensuite proposer un cadre d’analyse des responsabilités écologiques d’une entreprise qui se veut générique. Dans le troisième chapitre, la gestion intentionnelle des enjeux de biodiversité est analysée et confrontée à une évaluation de la durabilité écologique des activités industrielles. Enfin, le quatrième chapitre discute les apports de ces travaux et ouvre des perspectives sur les plans scientifiques, opérationnels et institutionnels.
Positionnement académique
Cette thèse s’inscrit dans les sciences du développement durable. Il s’agit d’un champ disciplinaire en cours de structuration, qui s’organise autour d’objets et d’objectifs sociétaux (Kates 2011). La revue Proceedings of the National Academy of Sciences en propose la définition suivante : “an emerging field of research dealing with the interactions between natural and social systems, and with how those interactions affect the challenge of sustainability: meeting the needs of present and future generations while substantially reducing poverty and conserving the planet’s life support systems” (PNAS, consulté le 12/07/2017). Le développement de cette discipline s’inscrit dans la filiation du concept dont elle porte le nom, et qu’elle modèle en retour. La définition proposée par PNAS reprend ainsi un point essentiel de la définition du développement durable publiée en 1987 dans le rapport Our common future, dit « Brundtand », à savoir l’équité intergénérationnelle dans la prise en compte des besoins (WCED 1987), et la précise dans ses dimensions sociales et écologiques. La conservation des composantes nécessaires au fonctionnement des écosystèmes est considérée comme une dimension pleine et entière du développement durable. Ce champ disciplinaire s’appuie également sur des concepts issus des sciences écologiques (conservation de la biodiversité, résilience des écosystèmes) et des sciences de gestion (responsabilité sociétale, instruments de gestion), et emprunte aux sciences environnementales des méthodes d’évaluation telles que l’analyse de cycle de vie (ACV) (Gondran 2015). Si aucune science n’est absolument neutre en termes de valeurs et de choix sociétaux, les enjeux relatifs au développement durable ont une dimension normative et politique (Boutaud 2005; Kemp & Martens 2007) qu’il semble plus sain et constructif d’assumer, que de passer sous silence. Dans le cadre de ces travaux de recherche, une perspective de durabilité forte est adoptée, en opposition aux conceptions dites « faibles » du développement durable4 . Les tenants de la durabilité faible considèrent les capitaux naturels, sociaux et économiques comme substituables. La représentation schématique des trois piliers du développement durable s’inscrit dans cette perspective de durabilité faible, en considérant que l’on doit trouver un ‘juste’ équilibre entre les composantes écologiques, sociales et économiques (Figure 2a). La vision proposée par René Passet est, elle, inclusive : l’homme fait partie intégrante de la biosphère, le maintien de son bon état écologique est un prérequis pour satisfaire les besoins humains et l’économie un ensemble de moyens (et non une fin en soi) pour y répondre (Passet 1996). Figure 2 – Représentations de deux conceptions du développement durable. (a) les trois piliers du développement durable, (b) la hiérarchie inclusive de la durabilité forte (d’après Passet 1996)). Rarement explicité, le postulat de substituabilité des capitaux, qui sous-tend de nombreuses évaluations monétaires (analyses coûts-bénéfices par exemple), a été remis en cause dès le début des années 80 par Ehrlich et Mooney, alertant sur la faible substituabilité des composantes écologiques disparues et des services écosystémiques altérés (Ehrlich & Mooney 1983). La possibilité de faire des compromis entre capitaux naturels, d’une part, et capitaux économiques et sociaux, d’autre part, est donc ici rejetée. Il s’agit de reconnaître la finitude des ressources naturelles, mais aussi la valeur des engagements internationaux et nationaux de conserver la biodiversité. Les activités humaines sont ainsi considérées comme contraintes par un espace délimité par les limites écologiques, c’est-à-dire la capacité des écosystèmes à supporter sur le long terme les stress associés à ces activités (Goodland 1995). Rockström et al. ont proposé une définition de l’espace des contraintes environnementales à l’échelle planétaire. Le choix de s’appuyer sur la paradigme de la soutenabilité forte est cohérent avec les orientations prises par le principal opérateur français de la conservation, l’Agence française pour la biodiversité, dont les missions s’inscrivent dans la « [construction d’]un modèle de développement à soutenabilité forte » (Aubel 2016). (Rockström et al. 2009). Cet espace est défini par les limites (“planetary boundaries”) de neuf processus biogéochimiques à respecter pour maintenir la Terre dans des conditions comparables à celles de l’Holocène. Ce cadre d’analyse de la durabilité écologique, qui a eu un important retentissement dans les sphères académiques et politiques, délimite ainsi un espace sécurisé pour l’humanité5 . Le parti pris de cette thèse est de mobiliser le même type de raisonnement pour définir un espace de contraintes compatible avec la conservation de la biodiversité. Cette perspective est cohérente avec les travaux en comptabilité environnementale de type fort, qui ont débouché entre autre sur la proposition du modèle « Comptabilité adaptée au Renouvellement de l’Environnement » (CARE), et du « Modèle de gestion pour la viabilité des socio-écosystèmes » (conditions de co-viabilité écologique et économique basées sur le respect des limites écologiques et la profitabilité des organisations) (Richard 2012; Ionescu 2016). 2. Terrains de recherche Mes travaux de recherche se sont appuyés sur trois terrains d’étude. Le dispositif d’engagement adossé à la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) française m’a servi de premier terrain d’exploration, pour dresser un panorama des motivations et des actions volontaires portées par les entreprises. Deux partenariats de recherche ont ensuite permis d’approfondir les réflexions et de tester le cadre méthodologique développé : l’un avec une entreprise de la grande distribution, le Groupe Casino, l’autre dans le secteur de la gestion des déchets, avec le Pôle Stockage et dépollution de SARP Industries (filiale de Véolia). La CDB a appelé « à promouvoir un environnement de politiques publiques qui permette l’engagement du secteur privé » (COP10 CDB 2010). En ce sens, la SNB 2011-2020 introduit un instrument de mobilisation volontaire afin d’élargir l’implication des acteurs dans la conservation de la biodiversité (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 2011). Entre 2012 et 2016, ce sont ainsi 49 plans d’engagement d’entreprises privées et publiques qui ont été reconnus au titre de la SNB. Alors que le traitement des enjeux de biodiversité dans la RSE est encore très disparate, ce dispositif a ainsi permis d’identifier un ensemble d’entreprises avec des stratégies structurées et des plans d’action précis. Ce terrain d’étude a nourri la thèse en deux temps. Il a tout d’abord permis d’explorer les pratiques et les motivations d’entreprises souhaitant, à travers leur engagement dans la SNB, afficher une certaine proactivité. Cette phase a également été l’opportunité de nouer des contacts et de développer un réseau. Outre l’analyse des dossiers d’engagement et documents de cadrage du dispositif, ce sont quatorze entretiens semi-directifs qui ont été conduits entre décembre 2014 et mai 2015 auprès de treize managers en charge des plans d’engagement SNB de leur organisation, 5 “a safe operating space for humanity” (Rockström et al. 2009) deux experts impliqués dans le processus d’évaluation et deux représentants institutionnels. De ces premiers travaux ont émergé les réflexions suivantes : – alors que les motivations initiales des entreprises à s’engager dans un dispositif tel que la SNB étaient d’améliorer les relations avec leurs parties prenantes externes et de gagner en compétitivité (visibilité et différenciation), il est apparu que la plus-value s’est en fait concrétisée dans les processus et interactions internes : gain de légitimité des porteurs de projet6 , aussi bien auprès de la direction que des acteurs opérationnels, structuration et cohérence de la politique interne. « quand c’est porté par une personne, qui en général est responsable biodiversité ou développement durable, il saute sur cette occasion-là pour faire parler de biodiv en interne, […]la structure elle dit aller bon pourquoi pas si tu veux. Elle fait un dossier qui était à son échelle donc elle se fait bananer. Alors elle est revenue en disant là on s’est fait refuser et là, tout d’un coup, en haut lieu ça pique au vif, et on dit bon il faut vraiment faire quelque chose, et on repense, et on rediscute de ces enjeux. Là ça entraîne une vraie réflexion et une vraie réappropriation en interne » (personne interviewée X, 2014). « le fait que les politiques soient plus structurées ça donne plus de crédit, ça ancre, ça devient une habitude, une évidence, alors qu’avant c’était de l’exotisme. Tant mieux. Ça consolide les choses » (personne interviewée Y, 2014). – les actions engagées, bien que très diverses entre et au sein des secteurs, semblent s’inscrire dans des thèmes récurrents. Cela se reflète notamment au travers des axes stratégiques définis par les acteurs qui gravitent autour (i) de la sensibilisation, de la formation et de la communication, (ii) du développement et de la diffusion de connaissances, (iii) de la gestion de l’emprise foncière et du territoire, (iv) de l’évolution des modes de production et de l’offre ; – les plans d’action développés contribuent aux objectifs de la SNB de façon hétérogène (certains reviennent très fréquemment alors que d’autres ne sont presque jamais mentionnés) (Wolff et al. 2015). Ces objectifs sont rarement utilisés comme données d’entrée pour orienter les projets, car considérés comme peu lisibles pour une entreprise. Les liens avec ces objectifs sont généralement explicités a posteriori.
Introduction |