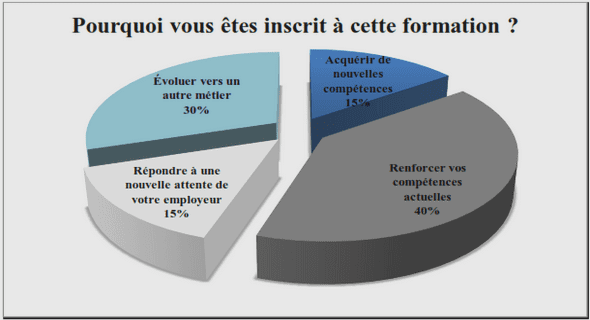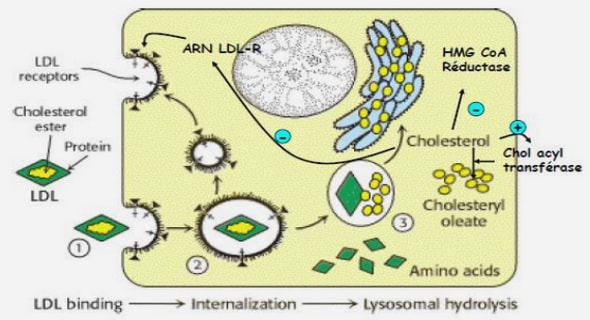Rendement et la tolérance aux moisissures des grains
Généralités sur le Sorgho
Origine et diversification du sorgho Plusieurs données archéologiques et botaniques considèrent la zone soudano-sahélienne au sudest du Sahara comme le lieu vraisemblable de la domestication du sorgho. Car c’est dans cette vaste aire qu’on a découvert les plus anciens restes archéologiques de sorgho et ces restes ont été datés entre 6000 à 4000 ans avant J.C. Cela laisse penser que la domestication a eu lieu environ en cette période. C’est en Afrique, particulièrement en Nubie que les premiers restes archéologiques identifiés de sorgho cultivés ont été trouvé et datant du premier millénaire avant J.C. Ils ont été reconnus comme la race bicolore avec ces caractères les plus primitifs. La domestication de cette race aurait daté du troisième millénaire avant J.C. Par la suite, ces sorghos bicolor auraient diffusé en direction d’Afrique de l’Ouest et du Sud faisant de ces régions des centres secondaires de domestication pour les sorghos. On note ainsi en Afrique trois centres géographiques actifs dans la diversification du sorgho cultivé : le centre-Ouest africain qui a contribué à l’établissement des sorghos de race guinea ; le centre-Est africain riche en sorgho des races caudatum et durra ; le centre-Sud-africain à l’origine des sorghos de race kafir Dès le troisième millénaire ces sorghos auraient rallié le continent Asiatique sur deux voies : une voie essentiellement terrestre et une voie maritime. Les sorghos de types durra et bicolore auraient été les premiers arrivés dans le continent asiatique en passant par la voie terrestre. Ceci est confirmé par des restes de sorghos cultivés retrouvés par les archéologues dans la péninsule arabique et qui dataient environ 2500 avant J.C, en Inde d’environ 2000 avant J.C. et en Chine du troisième millénaire avant J.C. Les sorghos de l’Afrique de l’Ouest et du Sud (guigne et guinea-kafir) auraient atterri en Asie dès le deuxième millénaire avant J.C. Ce passage de sorgho vers les autres continents est globalement étayé sur cette Figure 1 (Chantereau et al., 2013). Le sorgho serait venu en Europe depuis l’Inde et l’Afrique à travers l’Arabie et la Perse premier siècle après J.C et il était totalement marginalisé (Chantereau & Nicou, 1991). Le sorgho a été introduit en Amérique à l’époque du commerce triangulaire, Où les sorghos de l’Afrique ont été amenés en Amérique au XIXe siècle. A la fin du XIX siècle le sorgho été présent sur tous les continents (Chantereau et al., 2013). 4 Figure 1 : Historique possible de la domestication et la diffusion du sorgho. Source : (Chantereau et al., 2013)
Classification botanique du sorgho
Le sorgho est une plante diploïde avec un nombre chromosome de base n=10. C’est une espèce annuelle monocotylédone. Il fait partir de la famille des Graminées actuellement nommées Poacées et à la tribu des Andropogonées. Le sorgho cultivé appartient au genre Sorghum, espèce bicolore et sous-espèce bicolore (Chantereau et al., 2013). Il présente une grande diversité morphologiques et plusieurs variétés existantes qui font l’objet de nombreuses classifications botaniques différentes. La classification la plus récente basée sur la forme des panicules et des caractères des épillets fait par Harlan et De Wet (1972) est la plus fonctionnelle et la plus utilisée. C’est une classification simplifiée qui distingue cinq races de bases qui sont : les races bicolore, guinea, caudatum, durra et kafir, dans laquelle il y’a les 10 combinaisons deux à deux de ces races de guinea, kafir et caudutum, durra. Le sorgho bicolor : On le trouve en Asie mais surtout dans toute l’Afrique. Il présente les caractères les plus primitifs avec une panicule lâche, des grains très petits, enveloppés par des glumes de grande taille et fermées. 5 Le sorgho guinea : cette race se distingue par sa panicule lâche avec ces épillets dont les glumes sont baillantes longues renfermant un grain elliptique. On le trouve en Afrique Australe et surtout en Afrique de l’Ouest. Le sorgho guinea est généralement de grande taille et photosensible. Il existe trois à quatre types dans la race guinea qui se distinguent actuellement dont : -le type G. margaritiferum, qui se distingue par l’ouverture des glumes à la maturité avec des grains petits et vitreux, -le type G. gambicum caractérisé par des glumes semi-ouvertes à la maturité avec de gros grains assez vitreux, -le type G. guineense avec des glumes semi-ouvertes à maturité et de gros grains peu vitreux (Deu et Hamon, 1994 ; Chantereau et al., 2013). Le sorgho caudatum : présent une panicule à forme variable. On distingue les grains par leur forme dissymétrique aplatie sur la face ventrale et bombée sur la face dorsale s’inséré dans des glumes courtes. Cette race est cultivée en Afrique centrale et de l’Est. Le sorgho durra : on le trouve essentiellement en Afrique de l’Est, au Moyen-Orient et en Inde. Sa panicule est compacte portée par un pédoncule crossé et les glumes sont petites avec des grains gros globuleux. Le sorgho kafir : est surtout cultivé en Afrique de l’Est, au Sud de l’équateur et en Afrique Australe. La panicule est relativement compacte et cylindrique, les glumes sont de taille variable et les grains sont symétriques. Ce sont des sorghos de petite taille (Chantereau et al., 2013).
Appareil végétatif de sorgho
Les racines Le sorgho détient un système racinaire puissant capable de croître à la fois latéralement et en profondeur facilitant l’exploitation rapide et efficace de ces besoins en eau et en éléments minéraux dans le sol. Ce qui explique sa capacité à supporter les manques d’eaux importants. Il présente des racines adventives qui naissent au niveau du collet et peuvent s’enfoncer jusqu’à 2m de profondeur. La tige La plante de sorgho présente une tige principale constituée de nœud et des entres nœuds qui portent chacun une feuille. Elle a une hauteur qui varie entre 50 cm à 5 m. La tige de sorgho a une épaisseur très variable et un diamètre basal qui va de 5 mm à 3 cm. Elle comprend des talles 7 qui prennent naissance dans les bourgeons adventifs sur le collet de la principale. Leur présence par pied est en fonction des variétés et des conditions de culture. On les trouve très rarement dans les variétés hybrides. Les feuilles Les feuilles se retrouvent au niveau des nœuds de la tige et elles sont constituées d’un faux limbe et d’une gaine. A la maturité, elles peuvent avoir une longueur de 30 à 135 cm avec une largeur qui varie de 1,5 cm à 13 cm au point le plus large. Le nombre de feuilles par tige principale dépend de la phase végétative de la variété considérée. Pareillement les tiges comme les feuilles peuvent contenir de l’acide cyanhydrique très toxique pour les animaux. Le pédoncule Le pédoncule est l’entre nœud supérieur qui porte la panicule. Il est indépendant de la croissance des autres parties de la tige. Il est généralement droit pour toutes les races du sorgho sauf chez la race durra où l’on voit souvent des écotypes à pédoncule crossé. Cependant en raison de caractères variétaux ou de l’influence du milieu, on observe des sorghos avec un pédoncule court dégageant mal l’inflorescence de la dernière gaine foliaire. Dans ce cas, on parle alors de mauvaise exsertion.
Appareil reproductif du sorgho
La panicule L’inflorescence chez le sorgho est une panicule. Son initiation correspond à la phase reproductive. Elle est composée d’un axe central, le rachis, où partent des branches primaires. Ces dernières produisent des branches secondaires et même tertiaires. La ramification ultime est un racème. Il porte les épillets par paire. Il consiste toujours en un ou plusieurs épillets. L’un des épillets est sessile et fertile, l’autre est pédicellé et stérile. Il est accompagné de deux épillets pédicellés. La panicule peut être courte et compacte ou bien lâche et ouverte. La graine La graine de sorgho est un fruit sec ou caryopse. Elle est constituée de trois parties principales : l’enveloppe ou péricarpe, le tissu de la réserve ou albumen ou endosperme et l’embryon. Le péricarpe est l’enveloppe externe de la graine. Son épaisseur est caractérisée par un gène majeur appelle testa. C’est une couche fortement concentrée en tanin de couleur rouge foncé ou brun foncé qui peut se situer entre le péricarpe et l’endosperme. Les graines en tanin donnent une coloration et une certaine amertume à la préparation culinaire. Cependant la testa est un composé tannique qui a des qualités de résistance aux moisissures des graines. La moitié voir 8 les 2/3 de la longueur du grain sont occupées par l’embryon. Le hile ou le point d’attachement du grain à la panicule se trouve à la base de la graine sur le côté opposé à celui de l’embryon. Il présente une couleur noire à la maturation physiologique de la graine.