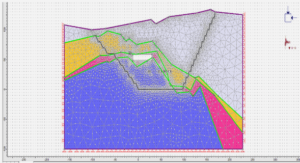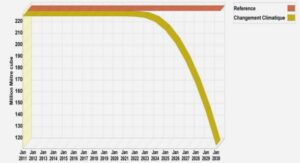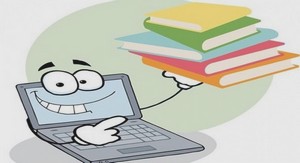Quand on cherche à définir la spiritualité, une des premières sources de difficulté à laquelle il est souvent fait allusion dans la littérature consultée est la relation entre la religion et la spiritualité. Comment ces deux termes s’imbriquent-ils, se définissent-ils?
Selon Jobin (2012), la distinction entre spiritualité et religion est assez récente puisqu’elle apparaît dans les années 60 dans le monde occidental. Elle est due à deux phénomènes : la sécularisation et la dé-traditionalisation des spiritualités. Par « dé-traditionalisation », il veut dire que la spiritualité n’est plus nécessairement liée à une tradition religieuse, à une religion. En effet, tout homme a une dimension spirituelle, c’est « une dimension intrinsèquement liée à la nature de l’être humain » (p. 87). De fait, « il n’est pas nécessaire d’appartenir à une tradition religieuse précise pour qu’elle soit effective » (p. 87).
Ainsi, spiritualité n’est pas synonyme de religion. Cela est corroboré par la majorité des auteurs. Jobin (2012), qui a recensé 30 manuels de formation en psychologie, médecine, service social et soins infirmiers publiés depuis l’an 2000, affirme que tous distinguent la religion de la spiritualité (p. 12), et que cette distinction, dans les manuels de soins infirmiers, se fait depuis 25 ans (p. 25). D’ailleurs, il est intéressant de remarquer que la classification de la NANDA-I (North America Nursing Diagnoses Association International) distingue les diagnostics infirmiers se référant à la pratique religieuse de ceux se référant à la spiritualité. Par exemple, la « motivation à améliorer son bien-être spirituel » est distinguée de la « motivation à améliorer sa pratique religieuse » (Doenges, Moorhouse, & Geissler-Murr, 2012, p. 159 et 718) .
Mais que comprendre derrière ces termes de religion et de spiritualité ? Toujours selon les recherches de Jobin (2012, p. 13-17), la religion se définit par
1. un aspect collectif et institutionnel,
2. des croyances codifiées par des dogmes,
3. des comportements ritualisés,
4. des règles et une (des) hiérarchie(s).
Pour la spiritualité, il nomme quatre caractéristiques majeures :
1. la quête de sens et d’authenticité,
2. la relationalité – c’est-à-dire la faculté d’entrer en relation avec l’autre (être humain, nature, cosmos, divinité),
3. l’universalité – c’est-à-dire que tout être humain est spirituel, c’est une dimension intrinsèque et essentielle,
4. l’harmonie – c’est-à-dire que la spiritualité devrait aider à atteindre « une forme d’adéquation du soi avec les différentes figures (immanentes et transcendantes) de l’altérité » (p. 17).
Ces quatre points aident à élaborer une définition de la spiritualité retenue ici : elle serait la quête de sens et d’authenticité habitant tout être humain, en vue d’atteindre une harmonie – une paix pourrait-on dire aussi, et elle comporte une dimension d’ouverture à l’altérité. Cet essai de définition recouvre les quatre mots clés proposés par Honoré (2011) pour décrire la spiritualité : le sens, la transcendance (avec la dimension d’ouverture à l’altérité), les valeurs et l’identité (avec la quête d’authenticité) (p. 54).
Définies ainsi, spiritualité et religion apparaissent bien distinctes, voire même opposées : d’un côté l’individu et sa recherche de sens, de l’autre l’institution et ses préceptes de croyances. Opposer religion et spiritualité est d’ailleurs une position tenue par certains auteurs. D’autres, par contre, préfèrent parler d’englobement : « la spiritualité dépasse et englobe toute forme de religions, ainsi que les institutions qui s’y rattachent » (Jobin, 2012, p. 12). Parmi eux se trouve Xerri (2011) qui parle de spiritualités au pluriel et en distingue trois. Premièrement, la « spiritualité religieuse » (p. 164) qui s’appuie sur une tradition religieuse. Deuxièmement, la spiritualité qui développe une relation à Dieu en dehors de toute institution religieuse. Troisièmement, la spiritualité qui ne se réfère ni à Dieu ni à une institution religieuse, la spiritualité vécue « dans un itinéraire de transcendance horizontale » (p. 106).
Considérer la spiritualité comme englobant la religion est la posture retenue ici, car c’est celle qui semble la plus équilibrée. En effet, comment affirmer qu’une personne appartenant à une religion ne vit pas une spiritualité également ? Si l’on va au bout de ce type de raisonnement, on pourrait même affirmer que les personnes se référant à une religion ne sont pas spirituelles. Si la religion comporte effectivement un aspect collectif, des règles, des croyances, des dogmes et des rites, elle peut se vivre de manière spirituelle ou de manière non spirituelle (Xerri, 2011, p. 163) – c’est à-dire que l’on peut, ou non, y trouver sens, harmonie, relationalité.
Enfin, si l’on revient au champ proprement disciplinaire, il est intéressant de remarquer que la NANDA-I relie la spiritualité au sens et à la relationalité ; et la religion à la croyance et aux rites. Par exemple :
– « motivation à améliorer son bien-être spirituel », définie comme « capacité de ressentir et d’intégrer le sens et le but de la vie à travers les liens avec soi, les autres, l’art, la musique, la littérature, la nature ou une force supérieure, et qui peut être renforcée » (Doenges et al., 2012, p. 159),
– et : « motivation à améliorer sa pratique religieuse », définie comme « capacité d’augmenter sa confiance en des croyances religieuses et/ou de participer à des rites religieux » (Doenges et al., 2012, p. 718-719).
La réflexion qui précède sur le sens à donner à la spiritualité et à la religion s’inscrit donc dans le champ disciplinaire infirmier. Par contre, la NANDA-I ne semble pas se positionner sur la relation entre ces deux concepts : juxtaposition, englobement ? Rien ne l’indique clairement dans les six diagnostics proposés autour de ces termes.
1 INTRODUCTION |