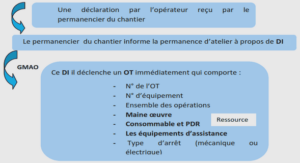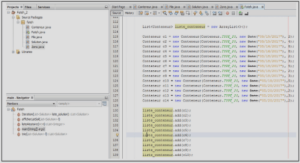Réexamen de la notion d’arbitraire linguistique
Le sens d’imposant, d’involontaire
L’arbitraire au sens d’involontaire va bien évidemment à l’encontre de l’arbitraire au sens de libre choix. Il signifie que l’institution du langage ne dépend pas de la volonté de l’homme, que le rôle de ce dernier est si passif qu’il se limite uniquement en tant qu’utilisateur. Le langage en ce sens est une institution indépendante qui agit tout seule aux caprices de son gré et de son arbitraire. Comment alors ce sens fut adopté et raisonné par ceux qui le préconisent? En fait, dans l’histoire des idées linguistiques, les explications et les opinions proposées par les philosophes sur le statut du langage sont tellement variables qu’elles n’arrivent pas à se réunir autour d’un point de vue commun qui peut définir la nature du signe linguistique. La relation entre la forme et le contenu apparaît arbitrairement choisie, mais une étude logique ne finit pas par l’affirmer. En revanche, les conventionnalistes, les nominalistes, les rationalistes qui généralement soutiennent l’arbitraire se trouvent en face des éléments, fournis par ceux qui prennent une position opposée, qui contredisent leur thèse. Pourtant, on peut aisément constater que le manque de rapport que révèlent les signes d’une langue parlée se montre plus évident en suivant leur évolution historique, dans la mesure où s’il y avait un rapport entre la forme et le contenu, ils ne sauraient subir, ensemble ou séparément, des changements au fil du temps. Du coup, le fait de ne pas trouver un moyen pour comprendre le fonctionnement du langage en sa vérité, le fait qu’il ne répond pas de façon satisfaisante à aucune des hypothèses proposées, le fait qu’il nous apparaît comme agissant tout seul, tout cela fait que notre langage se transforme en une institution incompréhensible, indépendante dans son mécanisme. C’est de ce point de vue qu’il porte encore le caractère arbitraire; mais cette fois dans le sens d’imposant, d’indiscutable, d’inchangeable, par conséquent d’involontaire1 . Un penseur de la Renaissance, Charles Bovelles (1475-1566), serait peut-être le premier à préciser ce sens d’arbitraire. Il est, selon M-L Demonet, l’un des auteurs chez qui, l’arbitraire du signe est le plus clairement exprimé2 . Bovelles définit alors l’arbitraire de la langue par le fait que «c’est justement de n’avoir pas de volonté de maîtrise, dont Adam avait fait preuve en instituant la première langue.»3 Mais en effet c’est Saussure qui a le plus manifestement parlé de ce sens d’arbitraire en décrivant la nature de la langue en terme de convention qui, selon le maître genevois, se caractérise par le fait qu’«il est impossible à l’individu de n’y rien changer, le communauté entière ne peut rien y changer non plus… Cette convention volontaire au début ne l’est plus dans la suite : une fois choisie par la première génération, les autres la subissent passivement… Nous voyons que cette convention, parfaitement libre, arbitraire, étant faite, nous nous trouvons en face du deuxième caractère: les générations suivantes ne pourront rien y changer.»1 Saussure réunit ici dans son raisonnement les deux sens opposés de l’arbitraire, à savoir le libre choix et l’imposant. Il soutient que la nature des signes linguistiques porte les deux attributs, non pas en même temps, mais en deux moments de l’histoire: au départ, ils étaient volontaires, par la suite, involontaires. Cela signifie que le langage finalement ne dépend pas de la volonté de l’individu; il est déjà là, apparaissant comme une institution tout à fait autonome dans son fonctionnement et faisant en sorte qu’elle s’impose à la société qui se contente de s’en servir. Que le signe change au fil du temps, ou maintienne sa forme sans changement, ce n’est pas à l’homme de le décider. Toute modification dans le langage est faite par décision de l’institution du langage lui-même. Le phénomène est expliqué du reste par des raisons et circonstances propres à la société à laquelle la langue appartient; l’homme représente un des facteurs de ces circonstances. Or, l’idée qui fait montrer le langage comme quelque chose d’imposé à l’homme, comme fonctionnant hors de sa volonté, serait empruntée au sociologue Émile Durkheim (1858-1917) qui, dans ses Règles de la méthode sociologique, définit les faits sociaux par leur caractère contraignant. C’est-à-dire que ces faits consistent en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui.2 Parmi les faits sociaux, l’institution du langage qui, étant antérieure à nous, donc légitime, s’impose bon gré mal gré à l’individu: «Le système de signes dont je me sers pour exprimer ma pensée, le système de monnaies que j’emploie pour payer mes dettes … Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils sont doués d’une puissance impérative et coercitive en vertu de laquelle ils s’imposent à lui, qu’il le veuille ou non… Nous sommes alors dupes d’une illusion qui nous fait croire que nous avons élaboré nous-même ce qui s’est imposé à nous du dehors.»3 C’est par là qu’on ne peut ni changer ni remplacer rien de ce qui est déjà établi dans l’institution du langage.
L’arbitraire apparent, irréel
La conception de l’arbitraire apparent consiste en ce que les signes d’une langue se montrent de prime abord arbitrairement liés à ce qu’ils représentent, quand en réalité ce jugement n’est délibéré que par ignorance de la cause qui justifie leur liaison. Ce genre d’arbitraire n’est donc pas réel, il est apparent. Pourtant nous l’avons classé sous la catégorie des définitions données de l’arbitraire; d’abord parce qu’on a trouvé une telle réflexion sur l’arbitraire dans la pensée des philosophes, ensuite, parce que le rapport entre les deux parties du signe est qualifié aussi d’arbitraire par ceux même qui ne l’estiment pas réel. La thèse de l’arbitraire apparent repose sur le fait qu’aucun signe n’est donné arbitrairement et qu’il y a toujours, derrière le choix du signe, une raison liée à quelque circonstance naturelle ou artificielle qui fait en sorte d’expliquer pourquoi une telle forme est appropriée à signifier une telle idée. Mais en aucun cas, la formation du mot ne peut être considérée comme un effet de pur hasard, sans règle ou par caprice. En l’occurrence, l’arbitraire apparent se caractérise par les points suivants: o La question qui consiste à penser ou non à l’arbitraire de relation dépend de l’esprit qui s’en fait une idée. A ce stade, il faut distinguer entre deux esprits: celui du sujet ordinaire, et celui du savant. o L’arbitraire apparent qui est le contraire de l’arbitraire de relation, s’oppose aussi à ce titre au sens de hasard et d’immotivation du signe. o L’arbitraire apparent est en rapport pertinent avec l’origine naturelle du langage et l’étymologie des mots. Malgré ces trois points qui nient l’inexistence de relation, les philosophes qui présentent ce genre de pensée continuent de qualifier le signe d’arbitraire. Quelles que soient les raisons qui les ont portés, elles ne dépassent pas le fait qu’elles sont uniquement apparentes, sans aucun rapport avec la vraie relation du mot à la chose telle qu’ils l’ont décrite dans leurs oeuvres. Les principaux noms représentant ce sens d’arbitraire sont Turgot, Beauzée, De Gérando et Stuart Mill. La théorie du signe chez Anne Robert Turgot (1727-1781) est formée sur la base des sensations. La façon dont il décrit la dénomination des choses n’est pas fondée sur un choix libre de l’homme au sens de caprice, mais suit certaines circonstances qui gèrent et modulent la forme du rapport unissant un mot à la chose. Pour comprendre en détail comment s’est élaborée la théorie du signe chez Turgot, et comment elle l’a conduit à adopter un point de vue qu’on appelle d’arbitraire apparent, il convient de suivre chronologiquement ses idées: En 1750, au cours de ses critiques des thèses de Maupertius, Turgot s’accorde avec ce dernier en ce que nous n’attachons aucune idée nette à nos mots; mais il ajoute 1ère Partie : Les constituants de l’arbitraire 76 qu’au départ ils ne sont jamais inventés sans une idée répondant à une sensation. Bien plus, «il n’y a nulle part aucune autre base que les sensations.»1 Pour Turgot, les premiers pas du langage commencent alors par exprimer les objets et non les percevoir; celui-ci vient plus tard dans une seconde étape, «lorsque dans le sang-froid du retour sur soi-même, la perception devient à son tour un objet de perception. Cela paraîtra d’autant plus évident que les premières idées sont des sensations, et que, par l’effet naturel des sensations, nous les rapportons promptement aux objet extérieurs.»2 Ainsi, d’autres langages ont été établis sur la base des sensations. La différence vient dans les progrès: «Souvent, on a donné pour nom, aux choses que l’on voyait, un mot analogue au cri que le sentiment de la chose faisait naître.»3 Turgot explique ensuite les conditions qui permettent de former les mots et d’engendrer les différentes langues: «Suivant qu’un sens était plus exercé ou plus flatté qu’un autre, et suivant qu’un objet était plus familier, plus frappant qu’un autre, il fut la source des métaphores»4 . Celles-ci font d’abord presque tout le fond d’une langue, et naissent d’un sens plutôt que d’un autre suivant les circonstances. De là, selon Turgot, sont venues les différentes langues. Les métaphores basées sur les sensations ne caractérisent pas encore l’harmonie des langues ou tracent l’intelligence humaine, ce n’est qu’après un long temps que « l’analogie put s’établir, parce qu’il fallut le temps de sentir la similitude… Cette analogie fit disparaître beaucoup d’onomatopées et de métaphores… (Lesquelles) dans l’emprunt ou dans le long usage, durent disparaître aussi.»5 Les analogies dont parle Turgot prennent le sens de ces choses «plutôt senties qu’aperçues, et que le peuple sent longtemps avant que le philosophe ne sache rendre raison».6 Un an après, et sous le titre Autres réflexions sur les langues, Turgot reste fidèle à ses idées concernant l’origine et la formation des premiers mots. Mais il parle maintenant d’une autre étape dans leur formation: le besoin de communiquer. Celui-ci fait que les premiers hommes emploient quelques signes accompagnés d’un geste indicatif. Turgot qualifie ces signes d’arbitraires. Et c’est la seule fois où figure le caractère dans ses articles sur le langage. Mais dans quel sens entend-il l’arbitraire? «Ces signes, dit-il, sont arbitraires, dans ce sens qu’ils ne sont pas liés nécessairement avec ce qu’ils signifient, mais il ne faut pas croire qu’ils soient uniquement l’effet d’un choix libre et réfléchi.»7 C’est là qu’il interprète les premiers signes du langage sur la base de l’onomatopée: «Le premier signe du besoin ou du désir fut vraisemblablement d’étendre la main vers l’objet et de la ramener vers soi, en y joignant quelques sons inarticulés. Si cet objet faisait quelque impression sur le sens de l’ouïe, quelque bruit, ce but devenait son nom».1 Selon Turgot, l’onomatopée et la ressemblance de son expliquent en quelque sorte la cause pour laquelle les peuples parlant des langues différentes donnent souvent aux mêmes choses les mêmes noms2 . Il y a d’autre part des objets qui ne frappent pas ou n’affectent pas le sens de l’ouïe; comment ont-ils été nommés? Turgot les rapporte à quelques circonstances qui frappaient à l’instant l’esprit de celui qui le premier leur imposait des noms. Ces objets, qui sont en petit nombre, «ont souvent dû leur noms à des rencontres fortuites qu’il est inutile de chercher et impossible de deviner.»3 Rien donc de tous ces signes ne trouve le jour arbitrairement, tout est lié soit à la ressemblance des sons de la nature soit à d’autres circonstances qui accompagnent l’imposition des noms; ce qui permet de sentir l’analogie entre nos sens et les idées attachées aux signes, sans pouvoir d’ailleurs la déterminer. Pour chercher son origine, l’analogie exige beaucoup de recherche, d’analyse et d’observation. Cela explique pourquoi dans son article Etymologie (1756) Turgot évite d’employer le terme arbitraire quoiqu’il dise: «Les mots n’ont point avec ce qu’ils expriment un rapport nécessaire» . Car, les sons ne réveillent rien dans l’esprit, et c’est l’effet de l’habitude sur laquelle l’homme se trompe inconsciemment. Mais la recherche étymologique peut seule révéler la liaison entre les mots et les choses qu’ils expriment. Voilà l’idée qu’il manifeste dans son article Etymologie. 5 Comment alors, et en quoi consiste le manque de rapport nécessaire entre le mot et ce qu’il exprime? Turgot y répond dans son observation sur l’étymologie, selon laquelle, plus on remonte à l’origine, plus on envisage des altérations: «Il est bien vrai, dit-il, qu’à mesure qu’on suit l’origine des mots, en remontant de degré en degré, les altérations se multiplient, soit dans la prononciation, soit dans le sens, parce que, excepté les seules inflexions grammaticales, chaque passage est une altération dans l’un et dans l’autre».6 Cette altération vient d’ailleurs de deux raisons: Turgot parle d’un côté du glissement du mot d’une idée principale sur l’accessoire, de façon à perdre la trace du primitif et à présenter un sens contradictoire avec le sens propre. De l’autre côté, il y a cet embarras dans l’imposition des noms aux objets qui ne frappent en rien le sens de l’ouïe, et qui n’avaient avec les autres objets de la nature que des rapports très éloignés.7 Cela vient graduellement; on voit les hommes, pour donner les noms «partir des premières images des objets qui frappent les sens, et s’élever par degrés jusqu’aux idées des êtres invisibles et aux abstractions les plus générales. On voit les échelons sur lesquels ils se sont appuyés, les métaphores et les analogies qui les ont aidés, surtout les combinaisons qu’ils ont faites de signes déjà inventés et l’artifice de ce calcul de mots par lequel ils ont formé, composé, analysé toutes sortes d’abstractions inaccessibles aux sens et à l’imagination»1 . L’étymologiste ajoute plus tard une autre raison, extérieure cette fois: les mélanges des langues.
Types d’arbitraire
La question de l’arbitraire linguistique suppose la présence de trois éléments: le mot, l’idée et la chose. L’arbitraire peut concerner l’un en deçà de l’autre, ou deux éléments ensemble. C’est pourquoi, afin de répondre à la question des types de l’arbitraire de manière adéquate, nous les avons classés en trois sujets : arbitraire des mots et caractères, arbitraire des idées et arbitraire de rapport (mots/ choses; mots / idées). II.0. Avant-propos : la notion d’idée Pour accéder à la problématique de tous les types d’arbitraire, il est absolument nécessaire de comprendre la notion de l’idée: ses rapports avec l’objet et la manière dont elle est représentée dans la pensée, puisqu’elle est le premier élément essentiel dans le fait du langage. Que ce soit dans l’arbitraire des mots et caractères, dans l’arbitraire des idées ou dans l’arbitraire de rapport, cette étude va nous aider à mieux percevoir sur quel terrain s’appuie l’arbitraire linguistique de chaque type. Nous aurons pour cela deux sujets à traiter: 1- La relation entre les idées et les choses. 2- La relation entre les mots et l’ensemble des idées/choses Il va sans dire que l’interaction de l’homme avec la réalité fait de lui un être pensant. Quand on dit pensant ce n’est pas simplement représenter l’objet de la réalité dans son esprit, car nous avons dès lors deux mondes qu’il faut profondément sonder: le monde des idées et le monde des choses. Il est préférable de partir des questions suivantes: est-ce que les idées que nous avons des choses sont les choses elles-mêmes? Sont-elles adéquates ou conformes aux choses? Et à quel point peut-on parler de cette conformité? Sommes-nous dans l’équation du fixe et du variable, c’est-à-dire est-ce que les choses sont immuables faces aux idées changeantes ou est-ce le contraire? Ces questions nous incitent à connaître l’origine des idées; à chercher si elles viennent de nos sens, de nos perceptions, de l’âme, de Dieu, ou bien ce sont des idées innées. L’Encyclopédie de 1765 ne donne à aucune une raison d’être: l’hypothèse des idées innées par exemple, critiquée par Malebranche (1638-1715)1 , signifie que notre âme est créée avec toutes les idées, mais elle anéantit en l’occurrence toutes nos sensations issues de notre expérience, puisque «l’âme n’ait point d’autres idées que celles qu’elle aperçoit, en sorte que la perception soit le sentiment même, ou la conscience qui avertit l’âme de ce qui se passe en elle».2 Pour les autres thèses posées comme origine des idées, la plupart des philosophes, Malebranche, Descartes, Régis, Voltaire1 les rapportent toutes à Dieu. Entre autres, nous avons opté pour la définition et l’analogie qu’a données Régis dans son Système de philosophie (1690) sur l’origine des idées, car elles nous semblent plus adéquates et plus globales que les autres définitions: « comme les tableaux dépendent absolument de quatre différentes causes, savoir d’un peintre, d’un original, d’un pinceau pour appliquer les couleurs, et d’une toile pour les recevoir, il faut penser aussi que les idées et les sensations de l’âme dépendent nécessairement de quatre principes, savoir de Dieu comme de leur cause efficiente première, des objets comme de leur cause exemplaire, de l’action des objets sur les organes du corps, comme de leur cause efficiente seconde, et de l’âme même comme de leur cause matérielle.» Passons maintenant aux idées par rapport aux objets représentés. L’auteur de l’article idée figurant dans l’Encyclopédie, qui emprunte la plupart des idées à celle de Leibniz, les répartit en trois catégories: 1- Des êtres réels existant hors de nous et dans nous, soit que nous y pensions, soit que nous n’y pensions pas; tels sont les corps, les esprits, l’Être suprême. 2- Des êtres idéales n’existant que dans nos idées. «Ce sont ou des êtres de raison, des manières de penser qui nous servent à imaginer, à composer, à retenir, à expliquer plus facilement ce que nous concevons; telles sont les relations, les privations, les signes, les idées universelles, etc. Ou ce sont des fictions distinguées des êtres de raison, en ce qu’elles sont formées par la réunion ou la séparation de plusieurs idées simples. »3 – Des êtres qui ne sont ni réels, ni idéales, n’existant que dans nos discours; ils ont simplement une existence verbale, «tel est un cercle quarré, le plus grand de tous les nombres, et si l’on voulait en donner d’autres exemples, on les trouverait aisément dans les idées contradictoires, que les hommes et même les philosophes joignent ensemble, sans avoir produit autre chose que des mots dénués de sens et de réalité.» II.0.1. La vérité de l’idée est subordonnée à la chose: Cette hypothèse attache la latitude de la validité de nos idées à sa conformité aux objets de représentation. La conformité à son tour ne sera validée qu’en dépendant de celle de nos connaissances des propriétés et des qualités des objets. Selon le même article, les objets ont deux qualités: celles appelées premières, considérées indépendamment des autres objets, et celles appelées secondes, considérées par rapport aux autres objets : «Les qualités des objets, ou tout ce qui est dans un objet, se trouve propre à exciter en nous une idée. Ces qualités sont premières et essentielles, c’est-à-dire, indépendantes de toutes relations de cet objet avec les autres êtres, et telles qu’il les conserverait, quand même il existerait seul. Ou elles sont des qualités secondes, qui ne consistent que dans les relations que l’objet a avec d’autres, dans la puissance qu’il a d’agir sur d’autres, d’en changer l’état, ou de changer lui – même d’état, étant appliqué à un autre objet; si c’est sur nous qu’il agit, nous appelons ces qualités sensibles; si c’est sur d’autres, nous les appelons puissances ou facultés.»1 Ces deux qualités des objets se représentent dans la pensée à travers une série d’opérations mentales qui finissent par former l’idée. «La manière de voir, d’envisager un objet, de le considérer avec attention sous toutes ses faces, de l’étudier, de ranger dans son esprit sous un certain ordre les idées particulières qui en dépendent, de s’appliquer à se rendre familiers les premiers principes et les propositions générales, de se les rappeler souvent, de ne pas s’occuper de trop d’objets à la fois, ni d’objets qui ayant trop de rapports peuvent se confondre; de ne point passer d’un objet à l’autre qu’on ne s’en soit fait une idée distincte s’il est possible. Tout cela forme une méthode de se représenter les objets, de connaître, d’étudier, sur laquelle on ne peut prescrire ici toutes les règles, que l’on trouvera dans un traité de logique bien fait.»2 Le résultat de ces opérations donne des idées claires ou obscures: l’idée claire se donne quand elle suffit pour nous faire connaître ce qu’elle représente, dès que l’objet vient à s’offrir à nous, l’idée obscure est celle qui ne produit pas cet effet.3 Or, ces mêmes idées claires et obscures varient et peuvent avoir divers degrés selon qu’elles portent des marques propres à les discerner de toute autre. L’idée d’une même chose peut être plus claire chez les uns, moins claire chez les autres; obscure pour ceux-ci, très obscure à ceux-là; de même elles peuvent être obscures dans un temps, et devenir très claires dans un autre. Pour cette raison, la philosophie logique de l’Encyclopédie distingue encore, au sein d’une idée claire, entre idées distinctes et idées confuses: «Ainsi, une idée claire peut être subdivisée en idée distincte et confuse. Distincte, quand nous pouvons détailler ce que nous avons observé dans cette idée, indiquer les marques qui nous les font reconnaître, rendre compte des différences qui distinguent cette idée d’autres à peu près 1ère Partie : Les constituants de l’arbitraire 86 semblables; mais on doit appeler une idée confuse, lorsque étant claire, c’est-à-dire distinguée de toute autre, on n’est pas en état d’entrer dans le détail de ses parties.»1 La différence entre une idée simplement claire et une idée distincte s’éclaire mieux dans la communication des idées: celui qui a simplement une idée claire d’une chose ne saurait la communiquer aux autres. Toutefois, la clarté des idées dépend, selon Voltaire, de la bonne qualité de notre capacité d’observation. Cette qualité rend l’idée claire et même distincte. Cela permet à un autre courant philosophique de supposer que la vérité des idées ne se réfère pas aux objets mais au sujet de la connaissance, comme nous allons voir dans le thème suivant.
La vérité de l’idée est indépendante de la chose
Cette thèse prend l’idée comme un objet immédiat de la pensée, elle est validée dès qu’elle s’offre à nous, indépendamment de la chose qu’on représente par cette idée-là. En ce sens, elle ne dépend pas de la volonté de l’homme qui cherche sa conformité à l’objet, mais elle se présente directement dans l’esprit et affirme ainsi son existence réelle. Pour Malebranche, il est indubitable que les idées ont une existence réelle, puisque le néant n’a aucune propriété4 . La simple conscience du fait que nous pensons affirme l’existence réelle de l’objet de la pensée qui est l’idée: «Tout ce que l’esprit aperçoit immédiatement et directement est quelque chose ou existe… tout ce que l’esprit aperçoit immédiatement est réellement. Or je pense à l’infini, j’aperçois immédiatement et directement l’infini. Donc il est. Car, s’il n’était point, en l’apercevant je n’apercevrais rien, donc je n’apercevrais point.»5 L’idée est donc pour lui un objet immédiat de l’esprit, comme il le dit lui-même6 ; et cela affirme non seulement l’existence de l’objet pensé, qui est l’idée, mais aussi de l’être pensant, à savoir l’esprit, comme le dit Léon Ollé-Laprune (1839-1898) qui étudie la philosophie de Malebranche: «La certitude de l’existence de la chose pensante ou de l’esprit et la certitude de l’existence de la chose pensée ou de l’idée sont tout d’abord posées.»7 Un exemple fourni par Spinoza (1632-1677) va dans le même sens de cette opinion: «Percevoir un cheval ailé, qu’est-ce autre chose en effet qu’affirmer de ce cheval qu’il a des ailes. Car enfin si l’âme ne concevait rien de plus que ce cheval, elle le verrait comme présent, sans avoir aucune raison de douter de son existence, ni aucune puissance de refuser son assentiment; et les choses ne peuvent se passer autrement, à moins que cette représentation d’un cheval ailé ne soit associée à une idée qui exprime qu’un tel cheval n’existe pas.»1 Or, la vérité de l’idée n’implique pas nécessairement une référence ou une ressemblance avec la chose, car il arrive très souvent que l’on aperçoive des choses qui ne sont pas, ou qui n’ont jamais été: «Afin que l’esprit aperçoive quelque objet, dit Malebranche, il est absolument nécessaire que l’idée de cet objet lui soit actuellement présente, il n’est pas possible d’en douter; mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait au dehors quelque chose de semblable à cette idée»2 , car les choses que l’âme aperçoit, soit qu’elles sont dans l’âme3 ou hors de l’âme, ne sont pas liées à l’âme, elles ne sont aperçues qu’au moyen des idées : «L’objet immédiat de notre esprit, lorsqu’il voit le soleil, par exemple, n’est pas le soleil, mais quelque chose qui est intimement unie à notre âme, et c’est ce que j’appelle idée, je n’entends ici autre chose que ce qui est l’objet immédiat.»4 De même pour Spinoza, dont la vue est élaborée d’une façon différente, la vérité de l’idée n’est pas définie par rapport à l’objet, mais par rapport au sujet de la connaissance. Il justifie son point de vue par un recours aux mathématiques, science dans laquelle la vérité n’est pas subordonnée à l’existence de l’objet: lorsqu’un mathématicien étudie un objet (un triangle par exemple) et ses propriétés (la somme des angles du triangle égale deux angles droits), il ne se demande pas si cet objet existe effectivement en dehors de son esprit qui le conçoit. La vérité est une qualité intrinsèque de l’idée et se révèle d’elle-même sans aucune référence à son être formel: « Certes, dit Spinoza, comme la lumière se fait connaître elle-même et fait connaître les ténèbres, la vérité est norme d’elle-même et du faux.».
Introduction |