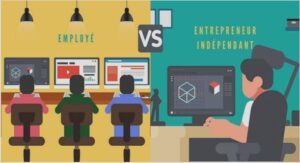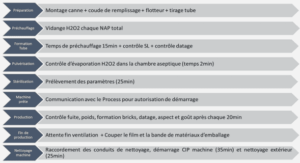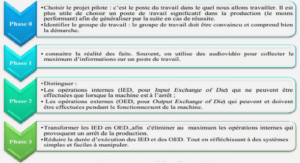Comment penser et dire différemment l’insoutenable altérité
Une autorité pour écrire
En 1453, la prise de Constantinople par les Turcs ramène en Europe de nombreux érudits grecs chargés de manuscrits précieux. Cet événement fondamental, associé à d’autres circonstances comme l’invention de l’imprimerie, donne naissance au mouvement humaniste, caractérisé par une démarche de retour aux textes d’origine comme base du savoir. Cette préoccupation philologique s’étend au domaine religieux, et certains penseurs, mus par le souci de se rapprocher de la signification première des Evangiles, ne tarderont pas à faire basculer la Chrétienté. La littérature ne reste pas en marge de ce grand bouillonnement d’idées ; la redécouverte de la Poétique d’Aristote et les commentaires qu’en font Francesco Robortello pour l’Italie (Explicationes in librum Aristotelis de arte poetica, 1548) ou Alonso López Pinciano pour l’Espagne (Philosophía antigua poética, 1596) relancent les débats sur la nature et la justification de la fiction. C’est, par exemple, le thème que fixe le Pinciano pour sa troisième épître, intitulée « De la essencia y causas de la poética ». La légitimation du texte fictionnel passe alors, entre autres, par la recherche d’un modèle qui fasse déjà autorité ; les lignes ironiques que Cervantès consacre à cette pratique témoignent de son importance au Siècle d’or : En lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacárades las sentencias y dichos que pusiéredes en vuestra historia, no hay más sino hacer de manera que vengan a pelo algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o a lo menos que os cuesten poco trabajo el buscalle […] En resolución, no hay más sino que vos procuréis nombrar estos nombres, o tocar estas historias en la vuestra, que aquí he dicho, y dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y acotaciones; que yo os voto a tal de llenaros las márgenes y de gastar cuatro pliegos en el fin del libro. Vengamos ahora a la citación de los autores que los otros libros tienen, que en el vuestro os faltan. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A hasta la Z, como vos decís. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro; que puesto que a la clara se vea la mentira, no importa nada, y quizá alguno habrá tan simple que crea que de todos os habéis aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra; y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. (I, prologue, p. 10-13) Malgré cette souriante tirade, il n’en reste pas moins vrai que pour les auteurs des XVIe et XVIIe siècles, pouvoir s’appuyer sur un précédent reconnu et indiscuté fait l’objet d’une véritable préoccupation. Or, le roman grec fut l’une des rares formes de fiction à n’être pas décriée par les humanistes ; il devient un point d’appui sûr pour les créateurs du Siècle d’or –le Pinciano qualifie d’ailleurs les Ethiopique de « poema muy loado »189 . Nous retrouvons des traces de cet engouement dans notre corpus, puisque la captivité et la séparation des amants –des situations vécues sous des modalités différentes par Abindarráez et Jarifa, Ozmín et Daraja, ou encore Ana Félix et don Gregorio– constituent une péripétie classique de ces récits. Le roman byzantin a également servi de base à la littérature de captivité, à tel point qu’il en arrive souvent à éclipser la réalité des bagnes d’Alger et de Constantinople, même chez des auteurs qui ont traversé cette épreuve0 . C’est dire si l’expérience individuelle ne suffit pas à justifier l’écriture ; Jacqueline Steinbach souligne que les autobiographies de soldats qu’elle étudie mettent en lumière une conception nouvelle de la personne, qui témoigne d’une notion d’individualité émergente : L’individu prend de plus en plus conscience qu’il possède des qualités et des talents qui lui permettent de se créer une identité indépendante de son groupe social. Les faits d’armes que ces soldats-auteurs consignent dans leurs écrits sont autant d’objets de récit dans lesquels ils peuvent élaborer la représentation d’un destin choisi, assumé, unique, personnel, et qui révèle une noblesse et une dignité acquises et non héritées. Cependant, le chemin jusqu’aux Confessions de Rousseau est encore long. L’écriture à la première personne, au XVIe siècle, fait l’objet de justifications de la part des auteurs : bien conscients que « la nouveauté de leur expérience personnelle ne suffisait pas à susciter l’intérêt de leur lecteur », ils incluent de nombreux passages didactiques destinés à délivrer un savoir de type académique, acquis en particulier à travers la lecture de traités descriptifs anciens ou contemporains. Le précepte horacien du placere et docere s’en trouve préservé : c’est là une exigence de la littérature du Siècle d’or, comme nous en convainc la Philosophía antigua poética du Pinciano : « La obra que fuere imitación en lenguaje, será poema en rigor lógico. Y el que enseñare y deleitare (porque estos dos son sus fines) será bueno y el que no, malo ». Le cas de Diego Galán est particulièrement intéressant à cet égard. Le récit de sa captivité et des péripéties de son retour est unique, notamment en raison du regard curieux et vif qu’il pose sur le monde qu’il découvre. Contrairement à d’autres relations d’anciens captifs, Galán ne se plaint guère des rigueurs qu’il a subies étant jeune : tout ce qui l’entoure est propice à l’observation et à l’émerveillement, et bien qu’il ne soit pas un homme de lettres, il produit, de l’avis de George Camamis, l’un des récits les plus passionnants de la période sur le monde musulman. Et pourtant, tout, dans ce récit autobiographique, n’est pas du cru de Galán : lui aussi cherche à s’abriter derrière une (ou plusieurs) autorité(s). Ce n’est pas seulement l’« attitude textuelle » dont nous avons déjà parlé qui est en jeu ici : tout se passe comme si Diego Galán, 0 George CAMAMIS donne l’exemple de Luis del Mármol Carvajal : captif pendant sept ans, il voyage énormément avec son maître : « Pues bien, este cautivo español, que hubiera podido componer una verdadera odisea sahariana, no hace más que escribir una aburrida Descripción general de África, siguiendo, en su forma y en gran parte del contenido, la obra mucho más original de Juan León el Africano. » (Estudios sobre el cautiverio en el Siglo de ancien soldat, ancien captif, lecteur probablement assidu mais dépourvu de toute formation universitaire, était à la recherche d’une autorisation d’écrire, d’une légitimité qui ne peut provenir que d’œuvres précédentes, reconnues et applaudies. Cette nécessité de la justification est d’autant plus palpable que Galán nous a légué deux versions différentes de son autobiographie, ayant réélaboré et considérablement amplifié la première en vue d’une éventuelle publication. Or, dans la seconde version, qu’il a conçue en fonction des exigences de la littérature de l’époque, nous trouvons des reprises littérales ou des résumés d’œuvres historiques comme celles de Gil González Dávila, Florián de Ocampo, et surtout de la Topographia e historia general de Argel, attribuée à Diego de Haedo : Todo indica que Diego Galán estudió a fondo los tratados de Haedo antes de componer su propia obra. […] En cierto sentido, es lícito incluso preguntarse si Diego Galán no recibiría el primer impulso para narrar sus aventuras de cautiverio al leer los interesantes relatos recopilados por el autor de la Topographia.4 D’autre part, si Jacqueline Steinbach a bien montré que le récit de Galán faisait appel aux stratégies narratives de la picaresque, la deuxième version de son texte, pensée pour la publication, affiche une influence particulièrement prononcée du Guzmán de Alfarache, dans son versant moralisateur : Esto es perceptible no sólo en la fórmula de la narración en primera persona de las aventuras de un adolescente, sino también en la tendencia a añadir moralizaciones, además de la interpolación de episodios secundarios, algunos novelescos como hemos visto en el caso de la historia de Pablo. Mucho más importante aún es que en varios casos, en especial al comienzo de la historia, Galán llega al plagio.5 En adoptant des traits caractéristiques du Guzmán, voire en copiant littéralement certains passages, Galán espère retenir l’attention d’un lecteur qui a fait très bon accueil aux aventures du prolixe gueux, et qui voit dans l’œuvre de divertissement une occasion de recevoir conseils et réflexions de toutes sortes. Le deuxième manuscrit de Galán fonctionne à cet égard comme un révélateur des pratiques littéraires du XVIIe siècle. Nous y percevons l’importance de pouvoir renvoyer à des hypotextes qui font autorité, mais également l’angoisse de la justification morale de la littérature, qui occupe encore singulièrement les esprits au Siècle d’or. Comme l’explique Anne Cayuela dans son article « Las justificaciones y críticas de la lectura », l’intensification de la production et de la distribution des livres, à partir du XVIe siècle et surtout au XVIIe , placent la question de la légitimité de la littérature de fiction au centre des préoccupations des moralistes : De ahí que la lectura empezara a constituir un peligro social para los detentores del saber, especialmente los religiosos y las elites. Un mismo libro, un mismo texto podía circular entre varios públicos lectores, ser “descifrado” de múltiples maneras, a veces alejadas e incluso contrarias a la intención del autor.6 Cette inquiétude est propre à l’Espagne, comme le souligne l’étude de Jean-Michel Laspéras : les traductions en espagnol des novellieri italiens montrent dès le XVIe siècle une volonté de moralisation censée corriger et réorienter ces récits jugés trop légers7 . C’est ainsi que le concept classique de divertissement se nuance et se teinte d’exemplarité morale : Les modifications apportées aux titres des œuvres, le « chastoiement » de ces dernières, les classements ambigus lorsque cuento ou novela deviennent ejemplo ou lorsque l’ambiguïté s’institutionnalise dans le syntagme cervantin de Novelas ejemplares, tout cela dénote une intentionnalité didactique et morale et sous-entend, par les affirmations de bienséance et d’honnêteté sans cesse répétées des prologues, ce que Marthe Robert nomme la “mauvaise conscience” du récit de fiction.8 Le texte fictionnel aux XVIe et XVIIe siècles est donc pris dans une démarche de justification, d’autant plus nécessaire dans le cas des récits morisques que les thèmes qu’ils mobilisent font partie d’une actualité brûlante et polémique, et pourraient facilement glisser vers l’inacceptable. Des stratégies de légitimation Les textes morisques sont fondamentalement des narrations inconfortables, à plusieurs niveaux. Nous avons déjà pu constater que les questions qui y sont abordées sont sources de conflits et de divisions, tant dans la sphère politique que religieuse, et très probablement dans l’opinion publique également ; pour ajouter à la complexité des thèmes, les personnages mis en scène sont à leur tour pétris de tensions, et échappent souvent à la compréhension du lecteur. Les modalisateurs de l’incertitude se multiplient ainsi sous la plume cervantine dès la première apparition de Zoraida dans la Première partie. Alors que l’homme qui l’accompagne est immédiatement identifié comme « cristiano recién venido de tierra de moros » (I, 37, p. 388), l’identité de la jeune Maure ne se dévoile que peu à peu, « a base de reticencias y ambigüedades » pour reprendre les mots de Michel Moner9 . En effet, elle est tout d’abord qualifiée de « mujer a la morisca vestida » (I, 37, p. 389), puis la narration la désigne comme « la que en el traje parecía mora » (I, 37, p. 389). Le verbe « parecer » utilisé pour se référer à Zoraida s’oppose au « mostrar » employé deux fois dans le cas de Ruy Pérez, dont l’identité ne fait aucun doute pour elle de Zoraida mobilise des signes qui ne font pas partie de l’univers mental des Espagnols vieux-chrétiens de l’auberge ; aussi le doute subsiste-t-il au moment où ils pensent avoir levé le mystère qui entoure la nouvelle venue : No respondió nada a eso la embozada, ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se había, y puestas entrambas manos cruzadas sobre el pecho, inclinada la cabeza, dobló el cuerpo en señal de que lo agradecía. Por su silencio imaginaron que, sin duda alguna, debía de ser mora, y que no sabía hablar cristiano. (I, 37, p. 389) Les gestes et le silence de Zoraida permettent aux femmes de l’auberge de déduire que, « sin duda alguna », l’étrangère est une Maure ; cependant, cette conviction, à peine acquise, se trouve remise en cause par un nouveau modal, « debía de », qui réintroduit le doute au sujet de l’identité de la jeune femme. L’ambiguïté de cette figure insaisissable est encore renforcée par le point de vue interne de Ruy Pérez, bien incapable de dévoiler les motivations profondes des personnages qui peuplent son récit. Nous reviendrons sur cette question clé dans la dernière partie de ce travail ; signalons d’emblée que nous ignorons tout des raisons qui ont poussé Zoraida à se faire chrétienne, au-delà d’une vague affection enfantine pour la figure mariale. De fait, elle rejette le débat théologique sollicité par son père qui l’interroge précisément sur le sens de sa conversion – ou apostasie–, et elle le renvoie aussitôt à la Vierge Marie : “Y ¿qué bien es el que te has hecho, hija?” – “Eso,” respondió ella, “pregúntaselo tú a Lela Marién; que ella te lo sabrá decir mejor que no yo.” […] “Plega a Alá, padre mío, que Lela Marién, que ha sido la causa de que yo sea cristiana, ella te consuele en tu tristeza. Alá sabe bien que no pude hacer otra cosa de la que he hecho, y que estos cristianos no deben nada a mi voluntad, pues aunque quisiera no venir con ellos y quedarme en mi casa, me fuera imposible, según la priesa que me daba mi alma a poner por obra esta que a mí me parece tan buena como tú, padre amado, la juzgas por mala. (I, 41, p. 430-433) L’incertitude quant aux motivations de Zoraida reste donc entière à l’issue de l’épisode, d’autant plus qu’une réplique d’Agi Morato, « ¿Que en efecto –replicó el viejo–, tú eres cristiana y la que ha puesto a su padre en poder de sus enemigos? » (I, 41, p. 430), a jeté un sérieux doute sur le bien-fondé de sa décision, en associant sa conversion au sort malheureux dont ce père aimant est victime. Nous retrouvons cette même ambiguïté chez les personnages morisques de la Seconde partie : le fond de leur pensée n’est jamais clairement explicité, et le narrateur ne se prive pas de le faire remarquer, directement, à travers les paroles de Sancho (« Bien conozco a Ricote y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija, que en esotras zarandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto. », II, 63, p. 1043), ou de manière plus implicite dans le dialogue au discours indirect libre entre le vice-roi de Barcelone et don Antonio : De allí a dos días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndoles no ser de inconveniente alguno 200 « el cual en su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros » (I, 37, p. 388) ; « él mostraba en su apostura que si estuviera bien vestido le juzgaran por persona de calidad y bien nacida » (I, 37, p. 389) ; je souligne. 76 que quedasen en ella hija tan cristiana y padre, al parecer, tan bien intencionado. (II, 65, p. 1052) La convocation à deux reprises du verbe « parecer » souligne, comme dans le cas de Zoraida, qu’il est impossible d’avoir accès à l’intériorité de ces personnages ; le soupçon quant à leur intégrité est toujours permis. Dans le Guzmán de Alfarache, le problème se formule en d’autres termes, puisque si le narrateur nous donne accès aux pensées des deux amants, c’est pour mieux mettre en relief leur duplicité. Ces deux personnages en effet, au mépris de leurs nobles origines, sous l’influence des terribles événements qu’ils sont en train de vivre, passent leur temps à mentir, à dissimuler, et à inventer des histoires. Or, loin de porter un jugement moral négatif sur cette attitude, le narrateur n’est pas loin de se pâmer d’admiration devant leur ingéniosité –un parti-pris qui détonne compte tenu du reste du roman, comme nous aurons l’occasion de l’étudier de manière détaillée plus loin : Curiosamente estuvo atenta Daraja en lo que don Luis le decía, para poderle responder; aunque su buen entendimiento ya se había prevenido de razones para el descargo, si algo se hubiera descubierto. Mas en aquel breve término, dejando las pensadas, le fue necesario valerse de otras más a propósito a lo que fue preguntada, con que fácilmente, dejándolo satisfecho, descuidase, cautelando lo venidero, para gozarse con su esposo según solía. […] Don Luis quedó admirado y enternecido, tanto de la estrañeza como del caso lastimoso, según el modo de proceder que en contarlo tuvo, sin pausa, turbación o accidente de donde pudiera presumirse que lo iba componiendo. Demás que lo acreditó vertiendo de sus ojos algunas eficaces lágrimas, que pudieran ablandar las duras piedras y labrar finos diamantes. (I, p. 226- 228) Capacité d’anticipation, faculté d’adaptation, don de manipulation, talent d’actrice consommée : telles sont les qualités que révèle Daraja, et qui font l’objet d’un enthousiasme coupable de la part du narrateur comme, sans doute, du lecteur. Celui-ci se retrouve alors dans une position inconfortable, puisqu’il est amené à se délecter d’un récit qui met en place des comportements suspects, sinon condamnables ; c’est toute l’ambiguïté de la réception qui se dessine ici, aggravée encore dans le cas des thèmes orientaux, pris dans une troublante dialectique entre fascination et répulsion. Nous la voyons à l’œuvre particulièrement clairement dans les nombreux textes qui mettent en scène les cruautés du monde turc ; entre dénonciation de la barbarie et plaisir de la représentation, la position du lecteur n’est pas aisée à tenir, comme le rappelle Véronique Lochert : Dans les ouvrages historiques et les récits de captivité comme dans les pièces de théâtre, les actions du Maure cruel suscitent surtout horreur et pitié, mais aussi une 77 forme de plaisir, qui fait apparaître le statut problématique du spectateur. […] dans une perspective morale, le plaisir équivaut à une approbation.201 Les longues pages que certains auteurs consacrent aux tourments endurés par les captifs de l’autre côté de la Méditerranée révèlent ainsi une fascination à la limite du morbide202 . Plus que d’autres formes narratives, le récit morisque doit donc établir des stratégies de légitimation qui le rendent acceptable malgré toutes ses ambiguïtés ; l’utilisation des discours du réel qui circulaient autour de la communauté morisque et le renvoi à une autorité littéraire incontestée en font partie, mais ne sont pas les seuls moyens dont disposent les auteurs. Jean-Michel Laspéras, dans l’étude déjà citée, analyse la façon dont se met en place l’exemplarité de la nouvelle du Siècle d’or espagnol. Contrairement à l’exemplum médiéval, dont la vocation morale était immédiatement affichée et reconnaissable, la nouvelle doit se parer d’un arsenal rhétorique propre à mettre en œuvre une formule moderne de l’exemplarité, qui trouve sa source non plus dans des principes universels et intemporels, mais dans un code social issu notamment du concile de Trente : A l’instar de l’exemplum, le discours de la nouvelle devient l’expansion d’un énoncé interprétatif qui le fonde. Seulement, au lieu que ce dernier soit représenté par une sentence ou un proverbe, c’est le texte canonique ou conciliaire qui lui confère l’intentionnalité désirée. 203 Les mécanismes de l’exemplarité se renouvellent donc au contact des réalités contemporaines et des exigences de cette forme de fiction moderne. Dans le cas des narrations intercalées, qui connaissent un grand succès au Siècle d’or, ce sont le prologue du roman204 et / ou le récit-cadre qui fonctionnent comme des énoncés programmatiques ; or, El Abencerraje, Ozmín y Daraja, et les deux épisodes cervantins s’insèrent dans des dispositifs intercalants. Ce procédé, hérité d’une longue tradition littéraire, est repris et revisité par nos auteurs, de manière à en faire le creuset de réflexions poétiques originales ; nous y reviendrons plus longuement dans la suite de ce travail
La construction d’un archétype de l’Autre
L’image du Musulman ou du morisque qui se construit dans les textes du Siècle d’or est double : la plupart du temps, comme nous avons pu commencer à le voir en parcourant le corpus lié à l’expulsion, il apparaît comme un Autre radical, qui s’oppose irrémédiablement à la communauté espagnole vieille-chrétienne. Pourtant, dans les récits morisques, il est au contraire très proche des Chrétiens, et doté des traits nécessaires à l’établissement d’une relation apaisée ou amicale avec les autres personnages. Le paradoxe n’est qu’apparent : dans un cas comme dans l’autre, l’altérité est oblitérée, elle disparaît au profit d’une caricature agressive, ou bien d’une bienveillance qui fond les différences jugées inacceptables212. Que le morisque soit l’Autre ou le (presque) Même, les textes se refusent à prendre en compte une singularité qui apparaît comme menaçante au reste de la société vieille-chrétienne. A) L’Autre radical La construction de deux blocs antagonistes L’Espagne des XVIe et XVIIe siècles tend à envisager le monde musulman comme un tout monolithique, dépourvu de fissures internes : Turcs, Maures et morisques sont associés pêle-mêle dans un même rejet de l’Islam. Cette image homogène est en partie due au peu d’informations dont disposent les Espagnols : les Turcs, notamment, sont mal connus, et sont identifiés avec facilité aux Maures. Si l’intérêt pour le nouvel ennemi ottoman, devenu toujours plus puissant de l’autre côté de la Méditerranée, s’éveille à partir de la seconde campagne d’Autriche en 1532, les renseignements qui circulent à son sujet restent rares et peu fiables. La littérature documentaire, à l’image de l’Histoire des Turcs de Vicente Roca (1555) ou la Palinodia de Vasco Díaz Tanco del Frejenal (1547), ne propose en général que des informations de seconde main, copiées d’ouvrages qui n’ont pas beaucoup plus de prises sur la réalité turque. Albert Mas 212 Tzvetan TODOROV formule la même remarque au sujet des Essais de Montaigne en ces termes : « Devant l’Autre, Montaigne est incontestablement mû par un élan généreux : plutôt que de le mépriser, il l’admire ; et il ne se lasse pas de critiquer sa propre société. Mais l’autre trouve-t-il son compte dans ce manège ? On peut en douter. Le jugement de valeur positif est fondé sur le malentendu, la projection sur l’autre d’une image de soi –ou, plus exactement, d’un idéal du moi, incarné pour Montaigne par la civilisation classique. L’autre n’est en fait jamais perçu ni connu. Ce dont Montaigne fait l’éloge, ce ne sont pas des « cannibales » mais de ses propres valeurs. Comme il le dit lui-même à une autre occasion : « Je ne dis les autres sinon pour d’autant plus me dire ». Or, pour que l’éloge vaille quelque chose, il faudrait que l’être à qui il s’adresse soit d’abord reconnu en lui-même. » (Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Lonrai, Seuil, 89, p. 70-71). 83 montre que même le Viaje de Turquía, qui se présente comme la relation authentique d’un captif évadé et produit une illusion poussée de vraisemblance, compile et synthétise des données issues d’autres auteurs, y compris des erreurs ou inexactitudes213. Ces traités pseudo-documentaires transmettent donc du monde turc une image vague, stéréotypée voire faussée, qui ne véhicule aucune véritable connaissance. La littérature de fiction n’offre pas davantage de solutions : quand les Turcs commencent à y faire leurs premières apparitions, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, c’est avant tout à travers les thèmes morisques, plus proches des Espagnols : Les auteurs passent aisément des thèmes morisques aux thèmes turcs et souvent même leurs personnages turcs ne sont que des héros morisques transplantés à Constantinople. Et cela paraît bien naturel puisqu’il s’agit dans tous les cas de Musulmans. Loin de compléter les notions très partielles du public au sujet du monde ottoman, ces ouvrages le présentent à travers un filtre plus familier, celui de l’Islam grenadin. Ce ne sont pas les différences entre les uns et les autres qui comptent, mais bien le fait qu’ils soient tous des Musulmans ; c’est la raison pour laquelle les morisques, à leur tour, sont associés sans beaucoup d’hésitations aux Turcs et aux Maures, dont ils ne sont qu’un prolongement. Comme nous l’avons dit, c’est précisément cette idée qui sous-tend l’argumentaire de l’expulsion : les morisques étant restés fidèles à l’Islam, ils ne sont pas différents de leurs frères en religion, avec lesquels ils conspirent dans le but d’envahir de nouveau l’Espagne. Il s’agit là d’une faute générale, partagée : les morisques sont en effet également envisagés comme un tout univoque, sans différences internes215 . Cette image monolithique a largement traversé les siècles : elle est l’un des piliers des courants historiographiques nés autour de la « question morisque », a fait les beaux jours de l’orientalisme et a longtemps résisté aux travaux critiques. Cependant, les raisons de cette identification abusive entre des sociétés si distinctes ne sont pas seulement à chercher du côté de la méconnaissance qui enveloppe le monde musulman au Siècle d’or : Miguel Ángel de Bunes Ibarra détaille dans son ouvrage déjà cité La imagen de los musulmanes y del norte de África en la España de los siglos XVI y XVII les multiples groupes humains qui étaient connus, décrits, et trouvaient leur place dans les textes de l’époque, attestant une vaste prise en compte de la réalité africaine. D’ailleurs, les Turcs font souvent l’objet d’une considération particulière. Bien qu’ils soient vilipendés, comme les autres, pour leurs croyances erronées, ils bénéficient d’un respect qui ne s’étend guère aux Maures et aux morisques, sans parler des Arabes ou encore des Egyptiens, du fait de leur puissance politique et militaire : ils sont à craindre, tandis que les autres sont à mépriser. En fait, si « todos son uno », pour reprendre le titre de l’étude déjà citée de José María Perceval, c’est avant tout parce que Turcs, Maures et morisques sont réunis dans une sorte de grande internationale de l’hérésie, qui menace de s’abattre sur l’Espagne. Ce danger protéiforme devient, dans un texte comme celui de Jaime Bleda, une entité compacte que l’on peut définir, et donc combattre, aisément, qu’il désigne par le terme générique « los enemigos », répété à satiété, qui recouvre des réalités très disparates. Dès la dédicace au duc de Lerma, il confond ainsi Turcs, Maures, morisques, et même « Políticos » espagnols dans une même haine : Con razon pues me prometo yo, que efta obra eftara amparada, y defendida, publicandofe en nombre de vueftra Excelencia, y que los deffeos que en ella declaro de la deftruycion del Imperio Mahometano, y de la peftilencial fecta de los Politicos, feran por vueftra Excelencia alentados. […] no ceffara de aconfejar a fu Majeftad, y animar a grandes emprefas contra Moros […] Efto fe perfuaden los mifmos Moros, viendo quan arruynados quedan de los encuentros, y deftroços, que han padecido efte verano por las armadas de naues de fu Majeftad en los dos mares de Efpaña. Crece fu opinion aora, viendo el aparato de galeras, que vueftra Excelencia fuftenta en fu puerto de la Ciudad de Denia, como el fanto Pontifice Calixto las fuftento, luego que fe vio hecho Papa, para perfeguir a los Turcos. […] Efte zelo feruorofo pudo caufar en vueftra Excelencia ver en fi verificada, y cumplida, en la expulfion de los Morifcos, la profecia tan clara, que en efta historia fe refiere del nueuo Apoftol del Euangelio S. Vicente Ferrer.216 Il s’agit, en somme, de détruire dans son entier la « secta de Mahoma »217, d’autant plus dangereuse qu’elle trouve des alliés imprévus en terre espagnole, comme les fameux « Políticos », les conversos ou encore, à l’occasion, les Protestants. La conjuration est en effet la grande obsession de l’Espagne du Siècle d’or, qui, semble-t-il, se justifie ou se renouvelle périodiquement au gré des conspirations découvertes. Nous retrouvons dans notre corpus des traces de cette considération monolithique du monde islamique, en particulier chez Pérez de Hita. Le changement d’optique entre sa Première et sa Seconde partie est flagrant : l’auteur abandonne les trajectoires individuelles, souvent exceptionnelles, de chevaliers comme Muza ou le Grand Maître de Calatrava, et les premières pages de 16 s’ouvrent sur une masse compacte, parée de tous les vices : Mas muy poco aprovechaban estos ejemplares castigos, porque todavía los moros no dejaban de hacer gran daño á los cristianos de secreto, matando al que cogian, de tal forma que estos no osaban andar por la ciudad de noche, ni salir á las huertas siendo menos de cuatro ó seis de camarada, pues si iban de otra suerte, los moros los mataban. Duró esto todo el tiempo que los moros estuvieron en el reino, y no eran Corónica de los moros de España, op.cit., dédicace au duc de Lerma (pas de pagination). Je souligne. L’expression revient fréquemment dans les textes de la polémique anti-morisque. Nous la trouvons sous la plume de Jaime BLEDA à de nombreuses reprises, par exemple dans le titre de son cinquième chapitre : « Recibieron la fecta de Mahoma los Iudios, y la gente popular, y liuiana, y de fus milagros falfos » (Ibid., p. 15). 85 parte los crueles castigos que en ellos hacia la justicia para que no usasen sus maldades y odios contra los cristianos. (II, 1, p. 4-5) Ces personnages, lorsqu’ils se convertissent et deviennent des Nouveaux-Chrétiens, sont à leur tour vus comme un ensemble indifférencié, et les termes « morisco », « moro » ou « turco » alternent dans le texte, tendant à une superposition des uns et des autres, comme chez Bleda ; cependant, Hita semble en faire un usage réfléchi. Au début de la Seconde partie, il commence par parler de « moriscos » en évoquant le décret décisif promulgué en 1567218 ; les conséquences ne se font pas attendre, et la conspiration qui mènera à la guerre des Alpujarras est immédiatement décidée, nous dit le texte, par les « moros granadinos » (II, 1, p. 6). A partir de ce moment-là, Hita mobilisera principalement le substantif « moro » pour se référer aux morisques soulevés contre les Chrétiens. Nous trouvons ainsi, au chapitre 5, le récit d’une sanglante bataille entre les uns et les autres : Pero los moros de todos aquellos contornos, escarmentados del mal notable que los cristianos les habian hecho, bajo el título de paces, no curaron sino de ponerse en defensa, y dieron con mucha braveza en los cristianos, haciendo mucho estrago. Viendo estos la resistencia de los moros, que era la cosa que ellos mas deseaban, sin aguardar órden del marqués, dieron en ellos valerosamente. (II, 5, p. 227) Sous le regard de l’écrivain chrétien, les morisques sont devenus, en l’espace de quelques lignes, des « moros ». Nous voyons ici à l’œuvre le processus d’« extranjerización » de la communauté morisque, défini par Alexandra Merle, qui se développe notamment durant la révolte des Alpujarras : les morisques sont alors opposés non seulement aux Chrétiens, mais également aux Espagnols, incarnant un antagonisme radical qui s’exprime à travers le terme « moro »2. On remarque la même indifférence à la pluralité du camp musulman au sujet des deux rois qui se succèdent durant le conflit : lorsqu’Abenumeya est assassiné, son cousin, Avenabó Audalla, prend sa place. Or, tous deux sont appelés dans le texte « reyecillo », sans que le passage de l’un à l’autre ne semble être pris en compte : pour le camp chrétien, l’identité du « roi » des morisques importe peu. Il est désigné uniquement par ce diminutif méprisant et pathétique, qui trace un lien entre la révolte des Alpujarras et les luttes contre le royaume grenadin du XVe siècle –donnant raison à ceux qui affirment que la Reconquista n’est pas terminée et qu’il reste des Musulmans en Espagne–, en même temps qu’il accuse la distance qui existe entre les nobles Maures de Boabdil et ces morisques, dernier échelon d’une société qui les rejette.
Introduction |