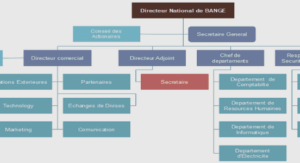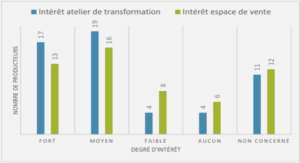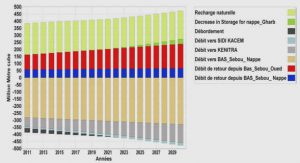Cours l’intersectionnalité, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
La théorie de l’intersectionnalité
Alors que les théories néoclassiques font porter l’analyse sur les ressources du capital humain (tel le niveau d’éducation, les qualifications, l’expérience professionnelle et les compétences linguistiques, notamment) et tendent à expliquer les difficultés des immigrants en termes davantage individuels, l’utilisation du paradigme de l’intersectionnalité permet de sortir de cette logique afin d’examiner le rôle de la société d’accueil. Pour bien comprendre comment se réalise l’insertion des immigrants dans leur nouvelle société, je m’inspire des récentes théories qui mettent en lumière comment différentes formes d’oppression et d’inégalités sociales sont interreliées et doivent être étudiées de manière simultanée (McClintock, 1995 ; Ng, 1993 et Collins, 1990).
Le paradigme de l’intersectionnalité révèle que les systèmes d’oppression que sont le racisme, le sexisme et les différentes formes d’inégalités liées aux classes sociales et aux pratiques linguistiques, notamment, ne peuvent être étudiés isolément. Dans cette thèse, j’adopte cette approche analytique qui ne priorise pas une forme d’oppression plutôt qu’une autre. Chaque forme d’oppression a des effets multiples et interdépendants. Comme l’explique Stéphanie Rousseau (2009 : 135), le paradigme de l’intersectionnalité propose de se pencher sur les manières dont les « catégories analytiquement identifiables (sexe/genre, classe, race/ethnicité, sexualité, etc.) interagissent de façon particulière dans chaque contexte étudié » :
Ainsi, les catégories sociales comportent une diversité interne qui ne peut se comprendre que par l’étude conjointe et simultanée de l’effet d’autres catégories sociales elles-mêmes complexes. Par exemple, si le genre institue et reproduit une différenciation sociale et des rapports de domination sur la base de la catégorie de sexe, les femmes (et les hommes) sont positionnées différemment en fonction de l’effet intersectionnel d’autres catégories qui conditionnent l’expérience sociale ainsi que l’accès à différentes ressources matérielles et symboliques à travers l’État et d’autres institutions (2009 : 136).
En ce sens, les différents marqueurs d’inégalité, tels que la race, le genre, la classe sociale et la langue, constituent des marqueurs identitaires qui sont également interdépendants et qui agissent en interrelation les uns par rapport aux autres. Danielle Juteau (2015) propose une définition similaire de l’intersectionnalité, un concept qu’elle juge plus simple et plus approprié que celui d’articulation des rapports sociaux. S’inspirant du collectif de la collection « IntersectionS » (Éditions Pétra), Juteau note que l’intersectionnalité est conceptualisée comme « l’articulation, à partir de cadres théoriques pluriels, des divers modes de classements sociaux et des phénomènes de hiérarchisation et de minorisation, construits selon le genre, l’ethnicité/la race, la classe… » (2015 : 211).
Pour une immigrante péruvienne qui vit au Québec, par exemple, le fait de faire partie d’une minorité ethnique, le fait d’être une femme et le fait d’être hispanophone (ou « allophone ») forment toutes des caractéristiques sociales qui influencent simultanément la construction identitaire de soi, l’accès aux ressources de la société et la place occupée dans cette dernière. Dans ce contexte québécois, il y a donc un cumul des marqueurs d’inégalité aux plans de l’ethnicité, du genre et de la langue. Dans un autre contexte, Jacquet et al. (2008) examinent l’intégration des jeunes immigrants francophones dans les écoles francophones en Colombie-Britannique. Ici, les auteurs font référence à un « processus de triple minorisation » où les immigrants francophones africains sont minorisés en raison de leur langue, de leur statut d’immigrant et de leur appartenance ethnique : ils sont à la fois immigrants, immigrants francophones et immigrants francophones africains. L’analyse intersectionnelle permet de prendre en compte simultanément ces différenciateurs identitaires porteurs d’inégalité.
Mentionnons aussi que selon une perspective poststructuraliste, je considère les concepts de race, genre, classe sociale et langage comme étant des construits sociaux (Rasmussen et al. 2001 ; Frankenberg, 1993 ; Hall, 1996 ; Miles, 2001 et Stoler, 2002). J’utilise ces catégories d’analyse en étant consciente que ces marqueurs sont fluides, ambigus et construits socialement ; leur signification et leur contenu évoluent dans le temps et dans l’espace, tout en étant intimement ancrés dans la société au sein de laquelle ils sont imaginés, développés et reproduits. Par exemple, la catégorie « immigrant » peut, pour certains, comprendre tous les gens qui sont nés à l’extérieur du Canada, alors que pour d’autres, seulement les gens faisant partie des « minorités visibles » sont inclus dans ce concept. Dans le contexte canadien, Gillian Creese soutient que la couleur de la peau constitue souvent une caractéristique importante pour déterminer le statut d’immigrant (2011 : 8). À cet égard, elle remarque que les personnes d’origine européenne (ou provenant des anciennes colonies blanches britanniques) sont souvent moins perçues comme des immigrants comparativement aux personnes de couleur :
the term immigrant, is a socially constructed concept rather than simply a legal or factual description of someone who was not born in Canada but arrived sometimes later in life. […] in the Canadian context the term immigrant is selectively employed to suggest that people of colour are by definition newer arrivals with less right to define what Canada is or should be (Creese, 2011 : 16).
La catégorie « immigrant » n’est donc pas rigide ni statique. Dans un même ordre d’idées, le concept de « race », bien qu’il n’ait aucune validité sur le plan biologique – les scientifiques s’entendent pour dire que les races n’existent pas –, a tout de même une portée sociale (Guillaumin, 1999 : 361), puisque qu’on ne peut dénier l’impact du racisme, bien réel et matériel, sur les groupes racisés et minorisés, ainsi que sur les positions de dominance qui sont associées au fait d’appartenir au groupe culturel et ethnique dominant.
Dans un même ordre d’idée, concevoir les groupes dit « ethniques » comme étant le produit de l’organisation sociale (et non comme des identités naturelles ou immuables) permet de les envisager comme étant des catégories construites, maintenues et (re)produites par les acteurs sociaux. Dans ses travaux influents sur les groupes ethniques, Frederick Barth (1995) explique que ce sont les traits perçus comme étant socialement pertinents et considérés comme significatifs par les acteurs eux-mêmes qui servent à marquer les frontières ethniques. Ici, ce n’est pas tant le « matériau culturel » du groupe en tant que tel qui importe (celui-ci pouvant évoluer dans le temps), mais c’est plutôt la frontière qui définit le groupe ethnique. C’est donc dans l’interaction avec d’autres que l’appartenance est maintenue. Nous verrons dans la section suivante que les constructions de groupes racisés (minoritaires et minorisés) par rapport au groupe « normal » (majoritaire/dominant) opèrent en interaction dans un rapport majoritaire/minoritaire qui peut se manifester sous forme de racisme.
Processus de racisation, racisme et groupes racisés
Pour bien comprendre le racisme qui peut être présent dans la société d’accueil et qui peut donc toucher négativement les groupes minorisés et racisés, et de ce fait, affecter leur intégration dans la nouvelle société, je me réfère aux concepts de « processus de racisation » et de « groupe racisé ». Utiliser ces concepts permet de mieux saisir à quel point l’immigration, bien qu’elle soit vécue individuellement (chaque personne vit son expérience migratoire différemment), est influencée par un contexte social plus large. En effet, selon une telle posture théorique, il importe d’explorer comment les catégories raciales sont construites socialement.
Mora et Undurraga définissent le processus de racisation comme « un processus de construction de catégories au sein duquel à la fois les acteurs individuels et collectifs participent, et dont la présence se manifeste dans la différentiation et l’inégalité qui affectent les groupes racisés » (Mora et Undurraga, 2013 : 294-295)11. Pour Micheline Labelle, l’expression groupe racisé « renvoie aux groupes porteurs d’une identité citoyenne et nationale précise, mais cible de racisme » (2006 : 14). En d’autres termes, les groupes racisés « ont été l’objet d’une assignation identitaire relevant de l’idéologie raciste » (Labelle, 2016). Geneviève Pagé, quant à elle, explique que le terme « racisé » est utilisé en Occident pour qualifier ceux et celles qui se retrouvent du côté ‘défavorisé’ du rapport social de race » (2015 : 135). Dans cette thèse, j’utilise le terme de « groupes racisés » en référence aux groupes qui sont victimes de racisme, par opposition, par exemple, à la « construction sociale de la blanchité » qui construit la « race blanche » comme étant la norme. Ici, le racisme est donc l’effet tangible du processus de racisation qui affecte négativement les groupes racisés. Mais qu’est-ce que le racisme ?
Michel Wieviorka (1991) définit le racisme comme une idéologie « impliquant des rapports de pouvoir entre les groupes sociaux » et qui sert à inférioriser et différencier des groupes sur la base de leurs attributs – physique, génétique ou biologique. Il écrit que le racisme est :
…[u]ne idéologie qui se traduit par des préjugés, des pratiques de discrimination, de ségrégation et de violence, impliquant des rapports de pouvoir entre des groupes sociaux, qui a une fonction de stigmatisation, de légitimation et de domination, et dont les logiques d’infériorisation et de différenciation peuvent varier dans le temps et l’espace. […] Pour qu’on puisse parler de racisme, il faut qu’il y ait d’une façon ou d’une autre, la présence de l’idée d’un lien entre les attributs ou le patrimoine – physique, génétique ou biologique – d’un individu (ou d’un groupe), et ses caractères intellectuels ou moraux (Wieviorka, 1991 : 15).
Comme l’explique Wieviorka, l’idéologie raciste varie dans l’espace et dans le temps. Certains groupes victimes de racisme dans le passé (par exemple, les Irlandais aux États-Unis) peuvent ne plus être l’objet de discrimination raciale aujourd’hui. Dans un même ordre d’idées, les répondants de notre étude qui étaient considérés comme « blancs » au Pérou (par rapport aux autochtones, notamment), peuvent, une fois au Québec, être l’objet de discriminations en tant que Latino-Américains.
Par ailleurs, le racisme, tel que défini par Wieviorka (1991), fait allusion aux attributs physiques, génétiques ou biologiques (la « supposée race ») des groupes minorisés. Aujourd’hui, il semble que ce type de racisme dit « biologique », basé sur une classification des groupes humains en différentes « races » a fait place à un nouveau type de racisme plus invisible et dit « culturel » (Navarre, 2017), « symbolique » (Henry et Sears, 2002) ou « colour-blind » (Simon, 2017) où ce ne sont plus les « races » qui sont déclarées comme inégales, mais plutôt les cultures. Les cultures considérées comme « inférieures » ou « non civilisées » semblent par ailleurs être attribuées à des groupes considérés comme « non blancs », et donc identifiables au plan phénotypique. À titre d’exemple, Paul Eid mentionne que les Afro-Américains et les Hispanics qui vivent aux États-Unis peuvent se faire dire qu’ils n’ont pas suffisamment intégré « l’éthique de travail capitaliste (« ils sont paresseux »), véhiculée dans la culture majoritaire (2012 : 5).
En bref, le processus de racisation, dont le résultat est le racisme, fait référence aux différentes manières dont les groupes racisés sont construits, reconstruits et imaginés socialement à travers les discours et les pratiques du groupe majoritaire12 dans une société donnée à un temps donné. Eid définit la notion de racisation ainsi :
La notion de racisation vise non seulement à souligner le caractère socialement construit de la « race », mais, par -dessus tout, le fait que celle-ci résulte d’un processus de catégorisation externe opérée par le groupe majoritaire. Cette catégorisation exerce une violence symbolique sur les catégorisés en leur assignant, non pas une culture historiquement construite et en mouvement (privilège des groupes majoritaires), mais plutôt une essence immuable de laquelle sont dérivés mécaniquement tous les traits sociaux, culturels et individuels. Cette essentialisation inhérente à la racisation aboutit à l’assignation des racisés à une nature qui s’épuise dans une marque physique, ou plutôt un stigmate, érigée en principe explicatif à la base de tout leur être collectif (Guillaumin, 1972 ; Ducharme et Eid, 2005) (Eid, 2012 : 416).