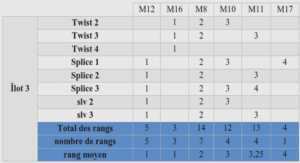Rappels sur les antibiotiques
Bactéries
Définition
Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires microscopiques ayant une structure différente de celle d’une cellule eucaryote. Ce sont des cellules procaryotes dépourvue de noyau proprement dit mais 1 (parfois 2) chromosome rudimentaire libre dans le cytoplasme car non limité par une membrane nucléaire.
Génétique bactérienne
Les bactéries procèdent à une adaptation à l’environnement grâce à sa capacité de transfert d’ADN entre eux. On distingue la conjugaison, la transformation et la transduction .
– Conjugaison : échange dirigé de matériel génétique
Il y a transmission de matériel génétique entre deux bactéries par un plasmide conjugatif (élément d’ADN indépendant du chromosome). Chez Escherichia coli, la cellule donneuse (ciliée) produit un pont cytoplasmique qui relie les deux cellules. Par ce canal, du matériel génétique va passer de la cellule donneuse à la receveuse.
– Transformation : acquisition d’ADN libre dans l’environnement
On parle de transformation quand une bactérie intègre de l’ADN étrangé libéré par une autre bactérie exogénote et peut s’en servir. Cet ADN vient généralement de cellules lysées et est libre dans l’environnement des bactéries. Pendant la croissance de la colonie, les bactéries réceptrices passent par une phase où elles laissent entrer des petites molécules d’ADN (phase de compétence).
– La transduction
Il s’agit d’un transfert d’ADN bactérien partiel par l’intermédiaire d’un vecteur (bactériophage) dont le rôle est passif.
Les infections bactériennes impliquées
Les infections bactériennes peuvent être classées selon sa localisation dans les différents compartiments de l’organisme.
– Infections respiratoires,
– Infections génito-urinaires,
– Infections gastro-intestinales,
– Infections de la peau et des tissus mous,
– Infections neurologiques,
– Infections ophtalmologiques.
Antibiotiques
Le terme d’ « antibiote » a été proposé par Vuillemin (1889) : principe actif d’un organisme vivant qui détruit la vie des autres pour protéger sa propre vie. On appelle antibiotique toute substance chimique élaborée par des microorganismes ou produite par synthèse, à basse concentration, capable d’inhiber le développement ou de détruire les bactéries et d’autres micro-organismes. (Waksman, 1943).
Pharmacodynamie des antibiotiques
La pharmacodynamie des antibiotiques est la branche de la pharmacologie qui étudie l’action et les effets de l’antibiotique sur les bactéries. Les antibiotiques peuvent avoir une action bactéricide (mort immédiate des germes) ou bactériostatiques (empêcher le développement des germes). Il existe une classification des antibiotiques en fonction de leur profil bactéricidie.
Pharmacocinétique des antibiotiques
La pharmacocinétique des antibiotiques explique le sort des antibiotiques dans l’organisme. L’antibiotique traverse quatre étapes : l’absorption, la distribution, la biotransformation et l’élimination. Ces différents paramètres sont spécifiques pour chaque famille d’antibiotique et le non respect de l’un de ces paramètres représente un facteur d’échec du traitement. Les différentes phases pharmacocinétiques des antibiotiques administrés par voie intraveineuse (distribution, métabolisme et élimination) peuvent être modifiées par de nombreuses conditions physiopathologiques, à l’origine d’une diminution des concentrations plasmatiques Cmax et Cmin, et de l’Aire sous la courbe. Les variations de volume extracellulaire, l’altération des fonctions hépatique ou rénale peuvent être considérées comme les mécanismes physiopathologiques prépondérants parmi ceux qui rendent imprévisible la pharmacocinétique des antibiotiques.
Mesure de l’activité d’un antibiotique sur une souche bactérienne
L’évaluation de cette activité passe par la mesure de la Concentration Minimale Inhibitrice ou CMI. La CMI est représentée par la plus petite concentration de substance antibiotique inhibant la concentration visible. Cette mesure peut être effectuée par différentes méthodes, la méthode de dilution en milieu gélosé servant de référence, dilution en milieu liquide, E-test.
La Concentration Minimale Bactéricide ou CMB: c’est la plus faible concentration d’antibiotique qui tue à 99,99% les germes. La bactéricidie est quantifiable par la CMB.
Antibiogramme et catégories cliniques
L’antibiogramme est un examen bactériologique qui sert à mesurer la CMI d’un antibiotique à l’égard d’une souche généralement sensible. Il permet d’améliorer la qualité de prescription en guidant le choix de l’antibiotique à administrer et de détecter les nouveaux cas de résistances [9]. Il existe plusieurs méthodes de détermination de la sensibilité aux antibiotiques :
– détermination directe de la CMI en milieu liquide ou solide
– méthode de disques ou diffusion
– E-test
Lors de l’antibiogramme on peut distinguer :
– Souches sensibles
• probabilité de succès thérapeutique est bonne lors d’un traitement par voie systémique avec la posologie recommandée.
• CMI ≤ Cmin
– Souches résistantes
• forte probabilité d’échec thérapeutique quel que soit le type de traitement,
• CMI > Cmax
– Souches « intermédiaires »
• succès thérapeutique imprévisible,
• c < CMI ≤ C
• ensemble hétérogène,
• souches « modérément sensibles »,
• mécanisme de résistance acquis présent à bas niveau,
• comportement inconnu ou risques de résistances in vivo.
INTRODUCTION |