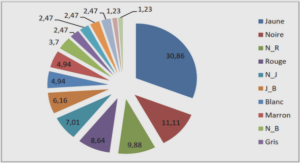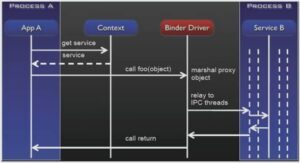”Mais surtout, lisez!” Les pratiques de lecture des femmes dans la France du premier XIXe siècle
Que lire, et comment ? Consignes, usages normatifs et pratiques quotidiennes
« Une crédibilité du discours est d’abord ce qui fait marcher les croyants. Elle produit des pratiquants. Faire croire, c’est faire faire . » « Même s’il y a des contraintes, même s’il y a des limites, il y a toujours une création dans l’usage, il y a une marge de manœuvre206 . » La diversité des lectures mise au jour grâce à la bibliothèque virtuelle permet de mesurer l’écart entre les représentations de la lecture des femmes et les pratiques avouées des lectrices. Pourtant, les lectrices doivent composer avec l’idée d’une mauvaise lecture des femmes, dans son contenu, ses modalités et ses effets, représentation qui génère, dans le quotidien, des normes genrées de lecture. Délivrées à l’intérieur de différents espaces sociaux – la famille, la petite école ou le pensionnat, l’Église – ces normes modèlent le rapport des individu·e·s au livre, tout comme elles en déterminent largement les conditions d’accès et d’appropriation. Dans le quotidien se pose alors pour les femmes au début du XIXe siècle la question des possibilités concrètes de la lecture : comment se procurer un livre ? quand, où lire ? Au début du XIXe siècle, toutes celles qui savent lire n’ont pas un accès égal au livre, qui est avant tout un problème financier pour les lectrices des classes populaires ou de la petite bourgeoisie. Cela avant que, au milieu des années 1830, les innovations technologiques et commerciales ne diminuent fortement le coût de l’imprimé. Mais même pour les lectrices des classes supérieures, des obstacles ayant trait à la répartition sexuée des espaces du savoir, abstraits et matériels, limitent le choix du livre, et c’est essentiellement sur leurs écrits que nous nous appuierons dans ce chapitre. Ces questions obligent à aller au plus près des pratiques de lecture pour repérer comment les normes dessinées par les savants, les moralistes ou les pédagogues, se transmettent tout ou partie, dans le quotidien des individu·e·s. Tout d’abord, les normes de lecture se communiquent aux individu·e·s par différentes institutions sociales207. Nous en examinerons deux qui nous semblent particulièrement importantes dans la vie des femmes au début du XIXe siècle : la famille et l’Église. La première conserve un droit de regard sur les activités de la jeune fille tant que celle-ci vit sous le toit parental. Surtout, les mères, désormais plus attentives à l’éducation de leurs filles, occupent la fonction de premières prescriptrices des consignes de lecture. L’Église quant à elle s’appuie largement sur les femmes pour moraliser la société française, nous l’avons dit. La féminisation de certaines pratiques religieuses comme la première communion ou la confession208 octroie dès lors une place importante au confesseur ou au directeur de conscience dans la vie des plus croyantes. Figure d’autorité, il délivre un message sur la lecture et ses usages auquel de nombreuses lectrices tentent de se conformer. Face à la crainte d’un choix sans discernement d’une lectrice peu experte dévorant toutes les productions du jour, ces prescriptions doivent donc continuer à guider, au-delà des premiers apprentissages, la lectrice sur le chemin de la bonne lecture. Mais il s’agit aussi de lire de la bonne manière. L’usage de la lecture en commun, inscrit au cœur des sociabilités culturelles du premier XIXe siècle, permet de surveiller le contenu et les postures de lecture d’une lectrice placée ainsi en position de passivité. Car progressivement, alors que la lecture s’individualise, l’image de la lectrice solitaire suscite de nouveaux fantasmes et de nouvelles angoisses. La lectrice érotisée devient une thématique forte de l’iconographie de la lecture, ainsi que l’a montré Fritz Nies210. Suspectée de se livrer à la rêverie ou pire, à l’onanisme, elle serait coupable de faire un mauvais usage du temps imparti à la lecture. La question du temps, on peut en faire l’hypothèse, est ici centrale. Dans la redéfinition des rôles sexués après la Révolution Rappelons que, dans les premières décennies du siècle, l’augmentation réelle – bien que parfois fortement exagérée – du lectorat dans l’ensemble des classes sociales suscite des mises en garde qui ne touchent pas que les lectrices. Chaque lecteur potentiel est ainsi associé, en fonction de son sexe, de son âge, de ses compétences de lecture supposées, etc., à une catégorie de lectures censée lui correspondre : dans cet ordre d’idées, les bibliothèques catholiques offrent le meilleur exemple de ce découpage presque taxinomique du lectorat et des lectures. Voir supra, chapitre 3. 210 Fritz Nies, « La femme-femme et la lecture : un tour d’horizon iconographique », art. cit. Depuis le XVIIIe siècle, la lecture des élites mise en représentation est essentiellement une lecture intime. Mais lecteurs et lectrices sont traité·e·s différemment : alors que Fragonard peint la lectrice sous des traits séduisants, laissant suggérer une lecture qui excite les sens, le livre, s’il devient également un « compagnon de solitude » pour le lecteur masculin, demeure au contraire un attribut traditionnel du savoir et du pouvoir. 327 française, l’idéologie des sphères séparées est porteuse d’une contradiction forte : dégagées des contraintes temporelles liées au travail, les femmes des classes supérieures doivent pourtant faire un bon usage de leur temps dans un équilibre subtil entre obligations domestiques et loisirs. La lecture privée se situe sur une ligne de tension : elle n’apparaît pas, dans les représentations des lectrices, comme la marque de distinction d’une culture savante ; en tant que loisir donc, elle risque de conduire à un mauvais usage du temps, qu’il s’agisse soit de s’évader d’un quotidien ennuyeux, à l’instar d’Emma Bovary, soit de le gaspiller, en empiétant sur les autres activités comme c’est le cas des lectrices bourgeoises oublieuses de leurs devoirs conjugaux et domestiques croquées par Daumier au tournant des années 1840 dans ses séries sur les « Bas-Bleus » ou les « Mœurs conjugales ». La lecture doit alors pouvoir s’insérer dans l’économie d’une journée tout en n’empiétant pas sur les autres activités. Les écrits personnels permettent de saisir les différentes techniques utilisées pour canaliser les choix, les goûts et les appropriations de la lecture213, tout comme ils permettent d’interroger la question des temps et des espaces de la lecture du point de vue du genre. Mais ils mettent également en lumière les conflits individuels qui se font jour face à des injonctions parfois contradictoires. Tenter de se conformer à l’idéal de la bonne lecture provoque des doutes, des remises en question chez certaines lectrices, qui usent de multiples ruses pour contourner l’ensemble de ces normes. C’est donc le couple autonomie-hétéronomie que nous souhaiterions interroger. Sa pertinence dans l’analyse des actions des femmes a été montrée par Michèle Riot-Sarcey, pour qui les femmes du XIXe siècle agissent d’abord en fonction des attentes sociales qui pèsent sur elles214. Par rapport à notre sujet, il s’agit d’évaluer la part d’autonomie mise en œuvre dans la lecture, au vu des discours encadrant les pratiques de lecture des femmes, pour comprendre « ce qui se noue dans la lecture : un donné et un acquis, les contraintes sans nombre du social, sous 211 Marie Baudry a montré que le corollaire de cette évolution très progressive dans les pratiques de lecture revenait, dans les théories de la lecture, à une nouvelle répartition genrée des pratiques et des usages de la lecture. L’objet privilégié des lectrices, le roman, interdirait une lecture sérieuse et raisonnée, et sa fonction distrayante voire ludique l’éloigne de la lecture érudite. Jacqueline Pearson repère un phénomène analogue dans l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, alors que « le genre de la mauvaise lecture tend à devenir féminin » (nous traduisons), Jacqueline Pearson, Women’s Reading in Britain, op. cit., p. 5 212 Flaubert lie étroitement les lectures d’Emma Bovary à son ennui grandissant durant sa vie conjugale : elle apporte ses livres à table pour éviter la conversation avec son mari, se désespère de n’avoir plus rien à lire alors qu’elle ne veut pas coudre et finit par regarder le feu de cheminée et la pluie qui tombe. Sur ce sujet, Michel de Certeau développe : « La lecture est en quelque sorte oblitérée par un rapport de forces (entre maîtres et élèves, entre producteurs et consommateurs) dont elle devient l’instrument. L’utilisation du livre par les privilégiés l’établit en secret dont ils sont les « véritables » interprètes. Elle pose entre le texte et ses lecteurs une frontière pour laquelle ses interprètes officiels délivrent seuls des passeports, en transformant leur lecture […] en une « littéralité » qui réduit les autres lectures […] à n’être qu’hérétiques ou insignifiantes. », Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, op. cit., t. 1, p. 248. 214 Michèle Riot-Sarcey, « Un autre regard sur l’histoire. Le genre, de l’Antiquité à nos jours », art. cit., 328 l’illusion du choix et de l’indépendance, mais aussi quelques fragments d’une liberté singulière ».
Parents et directeurs de conscience : les prescripteurs de la lecture des femmes
À demeure : la surveillance des lectrices dans le cadre familial
Nous reprenons les trajectoires des lectrices là où nous les avons laissées à la fin de la deuxième partie, à un âge où, aux alentours de quinze ou seize ans, l’éducation des filles est censée être achevée – pour celles qui en ont eu l’opportunité. L’objectif est ici de mettre l’accent sur cette période floue, dont la délimitation peut sembler arbitraire mais qui ressort pourtant à la lecture des écrits personnels comme un moment décisif dans les trajectoires individuelles. De fait, nous avons souligné la nécessité de croiser l’âge avec la grille d’analyse du genre, puisque les étapes marquantes des vies, étapes socialement instituées telles que l’âge de raison, la première communion ou le mariage, sont associées à autant de modifications des pratiques de lecture. Ces « âges de la lecture » sont alors des moments vécus dans la biographie personnelle comme marquant des seuils dans l’élargissement ou le rétrécissement de l’horizon de lecture. Par exemple, apprendre à lire sur un quotidien ou un périodique ne fait pas partie des usages pédagogiques au début du siècle, alors que la presse pour la jeunesse n’en est qu’à ses balbutiements. Il y a une césure nette entre le monde des adultes lecteurs de journaux et le monde des enfants, au point que la première lecture ou, souvent, la première écoute du journal revêt une dimension initiatique. « Nous commencions à écouter la lecture des journaux, et l’incendie de Moscou me frappa», écrit ainsi George Sand (George Sand, Histoire de ma vie, op. cit., p. 749), entremêlant le souvenir d’une pratique et d’un événement pour marquer son entrée dans le régime d’information ordonné par la presse, alors qu’elle n’a que huit ans. L’éducation achevée, des lectrices autonomes ? Bien qu’une part des pratiques de lecture des enfants échappe aux injonctions des parents ou des pédagogues, celles-ci ont généralement été étudiées sous l’angle de l’hétéronomie. Dans les écrits personnels, les scriptrices établissent un seuil notable de leurs trajectoires de lectrices au moment de l’entrée dans la vie conjugale après un temps de vie de « jeune fille ». Cette période brève quoique chargée, par les contemporains, de lourdes attentes sociales et morales, s’étend entre quinze et vingt ans pour les adolescentes de la bourgeoisie et de l’aristocratie mais se repère également chez des lectrices plus populaires217. Issues de milieux très différents, la comtesse d’Armaillé et Antoinette Dupin, fille d’un petit marchand lyonnais, restituent pourtant des souvenirs assez proches. La première écrit : J’aimais extrêmement le travail, la lecture, les exercices de piété. Mes parents trouvèrent qu’il était temps de me préparer à une existence moins recueillie et décidèrent que durant l’hiver de 1847, on commencerait à me mener dans le monde. Cette perspective ne me fit aucun plaisir ; on le vit et on n’en fut que plus pressé de me sortir de ma vie préférée218 . Elle a alors dix-sept ans, et son éducation, « quoique incomplète », est considérée comme achevée. À cet âge, la jeune fille de bonne famille doit faire son entrée dans le monde. C’est une étape essentielle dans la trajectoire des femmes, synonyme à la fois de rencontres et de sociabilités nouvelles qui doivent aboutir à un mariage. Les activités et les rythmes quotidiens changent. Elle sort du domicile familial et son temps s’organise désormais différemment, alors que jusqu’à seize ans, écrit Élisabeth de Bonnefonds, « [leur] vie s’écoule calme et heureuse sous l’œil vigilant de [leurs] mères et de [leurs] maîtresses219 . » Pour Antoinette Dupin, la rupture est encore plus nette : La dernière année de mon séjour chez mon père fut pénible. Ma mère, lasse de mes refus de mariage, prit de l’humeur contre moi, elle me défendit d’apporter aucun livre. Une révolte cachée fut ma réponse. Ne voulant pas renoncer à mes chères habitudes, je m’entourai de précautions qui pourtant répugnaient à ma nature fière et loyale. Un mensonge m’aurait dégradée, je ne le disais pas ; mais je continuai à louer, tous bons d’ailleurs, et à en acheter. Par une matinée de printemps, j’acquis l’Histoire universelle de Ségur, 25 vol. in-18. Je les entrai à deux reprises dans mon chapeau, dans mon parapluie fermé, et sous mes bras que je tenais serrés contre mon corps. Ma frayeur était grande ; j’aimais beaucoup ma mère, mais je la craignais terriblement. Elle ne s’aperçut de rien. Avant le coucher du soleil, mes chers petits volumes s’étalaient dans le tiroir d’une vaste commode. Un jour je me trouvai mariée220 . Dans les souvenirs, ce temps est investi d’une certaine forme de liberté qu’il apparaît difficile de retrouver ultérieurement. Bien qu’idéalisé à travers de nombreux récits de transgressions des consignes parentales, il est intéressant de constater qu’il est inséré en opposition à un destin social qui semble tracé d’avance, le mariage. Chez Antoinette Dupin, ce n’est pas tant le travail qui contraint ses lectures – elle réalise de petits travaux de couture et utilise son salaire pour acheter ses livres – mais bien le mariage. Dans la société française du Code civil, tant qu’une femme n’est pas mariée, elle reste légalement une mineure et demeure sous l’autorité morale de ses parents. Les marges de manœuvre dans le choix des lectures sont minces, surtout lorsque la lectrice, jeune ou moins jeune, continue à vivre auprès de ses parents. Ceux-ci conservent un rôle de prescripteurs des bonnes lectures, tentant de canaliser les goûts de leur fille, de modeler leur personnalité à l’aune des choix qu’ils édictent. À partir de ce moment-là, les consignes de lecture peuvent prendre des orientations parfois contradictoires en fonction des attentes pesant sur la jeune fille. Ces attentes diffèrent selon des milieux sociaux, mais l’établissement de la jeune fille dans le régime de la conjugalité demeure un horizon stable pour l’ensemble du siècle. Il lui assure une position dans le monde, alors que le célibat est regardé avec suspicion comme l’expression d’une singularité qui échappe à l’institution sociale de la famille221. Lorsque la jeune fille doit se préparer au mariage, certaines mères choisissent donc d’adapter les lectures en conséquence, pour donner à lire des exemples de mariages réussis. Il s’agit ainsi de lutter contre le risque dérèglement social que représentent les célibataires, les femmes auteurs, ou pire, les filles- 220 Antoinette Dupin, « Antoinette Dupin par elle-même », op. cit., p. .. Dans les familles Dubois et d’Armaillé, ce sont les lectures trop religieuses qui inquiètent les mères au sortir de l’adolescence : J’allais avoir dix-neuf ans. […] Ma mère finissait par croire que je n’avais pas la vocation du mariage, et que j’avais la vocation religieuse. Elle se désespérait. Elle me grondait. Elle me lisait la vie des saintes dames romaines qui avaient été épouses et mères, après quoi, elle faisait de nouveaux efforts pour trouver le précieux personnage qui devait m’arracher au célibat223 . On repère ici un changement fort de paradigme quant à l’horizon des femmes dans la société du XIXe siècle : malgré le succès des congrégations féminines, la prise du voile n’a plus la haute valeur symbolique qu’elle pouvait avoir aux siècles précédents aux yeux de l’aristocratie ou de la bourgeoisie. En même temps, il en ressort une contradiction ayant trait aux effets de la plus grande demande en faveur de l’éducation des filles : élevées pour l’essentiel « sur les genoux de l’Église », elles doivent pouvoir appliquer dans le cadre domestique les préceptes reçus dans une institution religieuse224. Les modèles offerts par les vies de saintes doivent donc trouver leur pendant séculier, où le rôle d’épouse et de mère n’apparaît pas comme incompatible avec la l’expression de la foi, d’autant plus que l’instruction religieuse des enfants revient aux mères de famille. C’est un terrain qu’investit pleinement la librairie catholique, nous l’avons dit, en proposant des figures de femmes pieuses mais mariées et vivant dans le monde
« Lire en moi, lire en commun »
Le livre, objet de l’intime, outil de socialisation « À quoi passez-vous votre tems à la campagne ? quand à moi je me brode un chale en reprise, je lis en moi particulier l’histoire universelle et nous avons lu en commun quelques romans de Walter Schott qui sont charmans mais que maman ne veut pas que je lise seule264 », écrit Eugénie à Émilienne de Francheville, son amie de pension, en novembre 1824. La plupart des scriptrices, à l’instar d’Eugénie, distingue clairement deux modalités de lecture, l’une privée et l’autre collective qui, loin de s’exclure, continuent d’être largement complémentaires. Malgré la généralisation, dans les classes dominantes, de la lecture dans le for privé et sa consécration en tant que modalité principale de lecture du romantisme265, les historiens insistent sur la permanence, dans toutes les classes sociales, de la lecture à voix haute et en commun. Elle se déploie aussi bien dans l’« intimité familiale, [la] sociabilité mondaine, [la] connivence lettrée266 ». Les deux pratiques – individuelle et collective – ne sont pas incompatibles car elles se déroulent dans des temps de la journée différents et impliquent des usages divers. Les nombreuses traces de la lecture collective en révèlent des usages multiples : une lecture surveillée, certes, mais dont on ne peut présumer qu’elle guidait entièrement l’appropriation de la lectrice, et surtout un usage qui permet aux lectrices d’endosser des rôles culturels à l’intérieur des espaces de sociabilité. Dans le cas d’Eugénie, lecture privée et lecture collective se répartissent en fonction de l’évaluation de la dangerosité ou non du livre lu. L’Histoire universelle – peut-être celle du comte de Ségur, dont la publication commence en 1822 – est une lecture sérieuse qui lui permet d’occuper utilement son temps, tandis que celle des romans Walter Scott est soumise à une surveillance de la part de sa mère. Doit-elle lire à voix haute, comme si, de cette façon, l’auditoire pouvait maîtriser l’effet de la lecture ? Comme si le fait d’écouter le texte amoindrissait les effets sur l’imagination individuelle ? Ou simplement en présence d’un adulte, pour éviter que sa lecture ne l’entraîne vers des pratiques interdites ? Elle ne le dit pas, mais cette brève description de la journée d’une femme d’une vingtaine d’années nous conduit à nous interroger sur la pluralité des usages de la lecture individuelle et de la lecture collective au début du siècle, usages qui portent la trace d’une répartition genrée des temps, des lieux et des rôles267 de lecture. 7.2.1. Usages de la lecture en commun Lectures du journal en famille : une forte hétéronomie De fait, on l’a vu à travers le journal de Laure d’Yvrande, la lecture du journal demeure a priori une lecture masculine, et, dans les souvenirs, les titres politiques sont fréquemment associés à une figure masculine : le père de Suzanne Voilquin, lecteur du Bulletin de la Grande Armée ; l’oncle de Coraly de Gaïx, attaché indéfectiblement à la Gazette de France, et qui lui en restitue, après sa lecture, le contenu ; celui de Léontine de Villeneuve, qui s’isole de sa femme et de ses filles, à l’heure du repas, pour lire le journal… Le choix du journal, qu’il soit lu ou entendu, en totalité ou en partie seulement, ne revient pas aux lectrices qui demeurent sous l’autorité paternelle ou d’un tuteur masculin. Le père d’Émilienne de Francheville, presque toujours absent du château familial breton en raison de ses différentes affectations de garnison, n’en contrôle pas moins à distance le choix du journal qui sera lu, sans doute, par Émilienne et sa mère : Si vous avez un journal à faire venir attachez vous à la gazette de France, journal vraiment indépendant et royaliste, qui depuis qu’il fait une loyale opposition est parfaitement rédigé. La pauvre quotidienne ne sait plus sur quelle pied danser et radote, le Journal des débats, qui a pris les couleurs de la révolution, est depuis longtemps le plus mauvais de tous les journaux et ne mérite que le mépris des honnetes gens. Tenez vous en donc à la gazette de France, et si vous ne l’avez pas [réunissez ?] vous plusieurs pour la faire venir268 . Le régime de la presse au début du XIXe siècle repose sur l’existence d’une presse d’opinion affirmée. Les familles s’y rattachent en fonction de leurs opinions politiques et/ou religieuses : le Bulletin de la Grande armée chez les nostalgiques de Napoléon Ier, que l’on retrouve dans les familles plus populaires, comme les Voilquin et les Perrotin ; le journal de Lamennais, l’Avenir, à ses débuts, dans la famille des Guérin ; la Gazette de France dans les familles royalistes, comme chez les Francheville en Bretagne ou les Gaïx près de Castres ; chez les d’Agoult, on trouve la panoplie des journaux les plus attachés à la monarchie des Bourbons dans les premiers instants du règne de Louis XVIII : la Quotidienne, le Conservateur, le Drapeau Blanc269. Aux filles, à qui il ne revient pas de choisir le journal lu en famille, il reste l’imprégnation, sur le long terme, de cette culture politique familiale. L’attachement familial – généralement, à l’origine, paternel – à un journal en particulier marque les années passées au domicile familial, rend l’objet et les idées qu’il diffuse familiers. Combien de récits de souvenirs de lectures du journal, et d’écoute « oblique270 », de la part des enfants présents, des débats qui s’en suivent entre les adultes.ainsi considérablement le public du texte. Sa médiatisation produite par la voix rend possible sa mémorisation voire son appropriation par l’ensemble des personnes présentes, alphabétisées ou non. Nous avons vu précédemment qu’il est difficile ici de faire la part entre le souvenir d’une lecture oralisée d’un article de journal et des conversations plus générales. Mais lorsque Marie d’Agoult encadre sa description de la table du salon familial, encombrée de journaux royalistes, par le souvenir des discussions enflammées sur les guerres de Vendée et l’impression qu’elles avaient sur elle, enfant, elle relie bien les deux en décrivant un espace de discussion ouvert ne serait-ce que par la simple présence de journaux271 . Pourtant, il n’appartenait pas aux jeunes filles de prendre part à ces discussions. Élisabeth de Bonnefonds se remémore, quant à elle, l’exclusion des conversations politiques dont elle souffrait en tant que jeune fille : La réunion du dimanche soir était ordinairement nombreuse et brillante ; […] parfois cependant elle devenait sérieuse : on traitait les plus hautes questions de philosophie, d’histoire et de politique. […] et j’écoutais en silence la conversation. Chaque fois que je voulais y prendre une part plus active, un regard sévère de ma mère faisait expirer les paroles sur mes lèvres. « Une femme, me disait-elle, et surtout une jeune fille, ne doit pas avoir d’autres opinions que celles des personnes chargées de la diriger » . L’éducation au débat d’idées et à la réflexion critique ne fait pas partie de l’éducation traditionnelle des jeunes filles. Les propos de la mère d’Élisabeth assignent de fait les femmes à un rôle passif dans les sociabilités formelles ou informelles au sein desquelles émergent les discussions politiques. Ils dénient toute autonomie de réflexion aux jeunes filles, sous l’autorité de leur père, puis aux femmes mariées, qui passent sous celle de leur mari. La lecture de la presse politique, en tant qu’outil de politisation et de formation d’une opinion critique, apparaitrait alors incongrue, et en fort décalage par rapport aux finalités de l’éducation des filles. Est-ce à dire qu’on apprenait aux jeunes filles à se « désintéresser » de la politique, et donc à se détourner de l’un de ses vecteurs de diffusion, le journal ? À se préoccuper au premier chef du quotidien, de l’intime et de tout ce qui y a trait ?
Des discours sur la lectrice aux pratiques des lectrices |