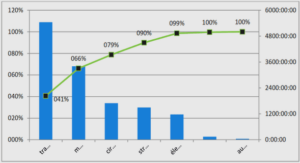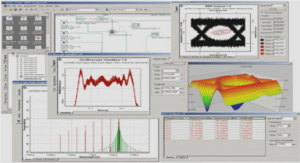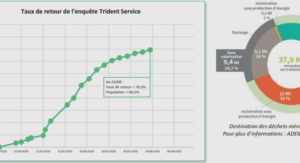L’aviculture traditionnelle
L’aviculture traditionnelle représente un effectif estimé en 2000 à plus de 10 millions de têtes (Resesav, 2000). Il existe cependant une forte variabilité dans la production de poules locales. L’aviculture traditionnelle occupe une place très importante dans l’économie Sénégalaise car elle nécessite très peu d’investissements financiers et elle est pratiquée par les couches les plus pauvres de la population. La volaille est élevée en effectifs réduits (10 à 40 tête par éleveur), laissée en liberté et se nourrit de sous- produits agricoles, de déchets de cuisines et d’insectes. Elle sert de capital d’épargne qui est mobilisé pour faire face aux dépenses urgentes de la famille (Gueye, 1997).
L’aviculture sémi-industrielle
Au Sénégal, pour répondre à une démographique urbaine sans cesse croissante et à une demande en protéines animales en constante augmentation, une aviculture sémi-industrielle de proximité dans l’espèce urbaine et périurbaine s’est développée. La région de Dakar regroupe l’essentielle de cette activité dans un rayon de 100 km autour de la capitale et qui représente des effectifs d’environ 5 millions de poulets de chair et 1 million de poulettes et de pondeuses (Resesav, 2000).
CONTRAINTES DE L’AVICULTURE AU SENEGAL
Les produits avicoles représentent une part essentielle de l’alimentation et constituent, dans les pays côtiers, la seconde source protéique, après le poisson. Cependant, un certain nombre de facteurs limitent leur développement. Ces contraintes sont d’ordre nutritionnelles, pathologiques et socioculturelles.
Les contraintes nutritionnelles
Dans le secteur de l’aviculture, le facteur nutritionnel est le plus limitant aussi bien en élevage moderne que traditionnel.
Dans les élevages sémi-industriels, l’alimentation des poulets est considérée comme la principale contrainte. Elle représente à elle seule plus de 70% des coûts de production. Les aliments sont en général constitués de mil, de son de mil ou de riz, de tourteaux ou de farine de poisson et de complexes minéraux-vitaminiques. Bichet et al, (2000), ont rapporté que l’alimentation est insuffisante dans 80% des élevages dans la zone périurbaine de Dakar.
Dans les élevages traditionnels, les insuffisances de l’alimentation sont quantitative et qualitative (carence en minéraux et en vitamines) et entraînent le plus souvent des résultats zootechniques très médiocres.
Les contraintes pathologiques
En élevage traditionnel (qui est quasiment sans couverture sanitaire) les principales causes de mortalités sont aussi bien les maladies infectieuses que parasitaires. Ces maladies sont considérées comme un obstacle majeur à une bonne productivité de la volaille locale. Ainsi, la maladie Gumboro, la maladie de Newcastle, la Bronchite infectieuse, les Salmonelles, la Coccidiose et les Helminthes (Mahamat, 2002) sont fréquemment décrits par les éleveurs. Cependant, en aviculture moderne, du fait des programmes de prophylaxie (vaccination) contre les principales maladies infectieuses, la coccidiose demeure la pathologie la plus préoccupante et la première maladie émergente. Il nous a donc semblé important d’aborder de façon plus approfondie l’étude de cette pathologie.
Les contraintes Socioculturelles
Au Sénégal, des études ont montré que les femmes et les enfants sont les propriétaires des volailles dans la plupart des cas dans le système traditionnel (Arbelot et al, 1995). La conduite de l’aviculture familiale est en effet assurée en majorité par les femmes et les enfants qui fournissent la main-d’œuvre et les moyens nécessaires. Ces moyens étant presque inexistants, la volaille est laissée à elle-même et n’est sollicité que pour résoudre les problèmes socio-économiques, d’ou de très faibles performances zootechniques.
LA COCCIDIOSE CHEZ LE POULET
Les coccidioses du poulet sont des infections parasitaires causées par des protozoaires du genre Eimeria, se développant dans l’intestin grêle ou dans les caeca et le rectum. En élevage avicole, les Eimeria causent des entéropathies parfois sévères qui altèrent les performances des animaux, notamment en terme de croissance.
Ce chapitre décrit le développement endogène du parasite, les divers aspects de la coccidiose et les moyens prophylactiques utilisés pour la combattre.
L’agent causal
Taxonomie des Eimeria
Les Eimeria sont des protozoaires parasites (Sporozoaires), intracellulaires obligatoires, appartenant au phylum des Apicomplexa. Actuellement, sept espèces d’Eimeria du poulet ont été identifiées et isolées (Yvore, 1992). Plusieurs critères de diagnostic sont utilisés pour la caractérisation des espèces : la morphologie de l’oocyste, la période pré patente qui correspond au temps de développement endogène du parasite (de l’ingestion des oocyste à l’excrétion des premiers oocystes) et dont la durée dépend de l’espèce, le temps de sporulation à une température donnée, le taux de multiplication, les lésions induites selon leur nature et leur localisation.
Cycle parasitaire des Eimeria du poulet (figure 1)
Les Eimeria sont des parasites monoxènes et ont une spécificité très poussée vis-à-vis de leur hôte. Le cycle biologique comprend une phase de multiplication chez l’animal et une phase de maturation et de dissémination du parasite dans le milieu extérieur. Le poulet se contamine en ingérant des oocystes sporulés présents dans le milieu extérieur. La paroi des oocystes est lysée dans l’estomac, les sporocystes sont ainsi libérés. L’excystation (lyse de la paroi des oocystes avec libération des sporocystes) se produit dans le duodénum sous l’action des différentes enzymes pancréatiques (principalement la chymotrypsine, la trypsine…) et des sels biliaires ; les sporozoïtes libérés constituent les éléments infectant et pénètrent activement dans les cellules épithéliales de ce segment. Quelques heures plus tard, ils sont observés dans les cellules épithéliales de leur site de multiplication. Le sporozoïtes se transforme alors en trophozoïte et subit plusieurs phases de multiplication asexuée, appelées mérogonies, aboutissant à la formation de générations successives de mérontes. A maturité, les mérozoïtes sont libérés de la cellule hôte et vont infecter les cellules voisines. La gamogonie constitue la phase sexuée du cycle. Les mérozoïtes de la dernière génération envahissent de nouvelles cellules intestinales et se différencient en microgamontes ou macrogamontes respectivement à l’origine des microgamètes et macrogamètes. Les microgamètes mâles mobiles et flagellés vont féconder les microgamètes intracellulaires et immobiles. Le zygote obtenu s’entoure d’une coque et forme un oocyste immature libéré de sa cellule hôte et excrété avec les fèces dans le milieu extérieur. Les oocystes ainsi dispersés vont subir une phase de maturation, la sporogonie : une série de transformation du sporonte aboutit à la formation d’oocystes sporulés infectants (Crevieu-Gabriel et Naciri, 2001).
Les sept espèces décrites chez le poulet présentent aussi une importante spécificité de site (Tableau I). Cependant, cette spécificité est plus ou moins stricte en fonction de l’espèce parasitaire et des conditions d’inoculation (Horton et Long, 1966 ; Long et Millard, 1976).