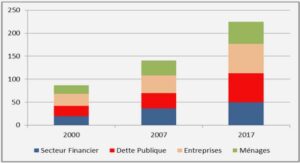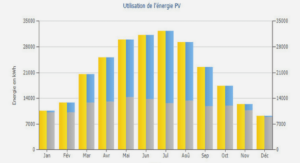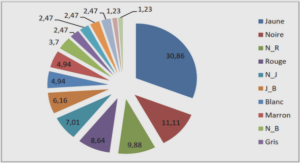La catégorie du projet
Le classement des projets est effectué selon les critères à savoir la taille, les spécificités et les secteurs.
La taille : les grands projets et les petits projets Les spécificités : les projets de développement, les différents projets élaborés et réalisés pour l’intérêt d’une communauté (irrigation, construction d’une route, etc.…), les projets commerciaux, les projets élaborés et réalisés pour l’intérêt particulier du promoteur. Les secteurs : le secteur social, le secteur industriel, le secteur commercial, le secteur tourisme, le secteur agricole.
Selon ce classement, notre projet est l’un des grands projets œuvrant dans le secteur social et commercial.
Le choix du projet
La forme et le régime juridique de la société prévue par la loi sont multiples mais dépend du domaine d’activité.
La forme juridique : Nous envisageons de constituer une grande société qui aura pour forme juridique : Société A Responsabilité Limitée (SARL). Nous avons mis l’accent sur la forme de cette société car la responsabilité est limitée aux apports de chacun que ce soit en nature ou en numéraire.
Régime juridique : A l’exception des entreprises de Zone Franche qui sont soumis à des conditions d’agrément et d’autorisation d’investissements, toutes les sociétés implantées à Madagascar sont régies par le régime de droit commun. Exerçant une activité à but lucratif, elles paieront les impôts professionnels liés à son existence.
L’organisme financier du projet
Comme il est impossible pour le présent projet de s’autofinancer dans la totalité des immobilisations, nous sommes obligés de recourir à un organisme financier ou bancaire afin de compléter le fonds nécessaire.
Par contre, grâce aux bénéfices annuels obtenus pour chaque année d’exploitation, nous pourrons dégager une forte marge d’autofinancement. Dans ces moments là, il est possible d’assurer les financements internes nécessaires.
Notre choix s’est porté vers la banque BOA (Bank Of Africa) pour emprunt auprès d’organisme bancaire. Elle accorde deux conditions d’octroi de crédit :
Le critère subjectif : La banque exige la moralité, le savoir-faire et l’expérience du promoteur en technique et en gestion. En plus, le prêt ne se fera que si l’établissement participe lui-même au financement du projet. Et bien évidement, il faut que l’emprunteur soit un client de la banque.
Le critère objectif : La banque n’octroiera son crédit que si elle est totalement assurée de la bonne marche du projet, outre sa rentabilité économique et financière.
La gestion du personnel
Puisque la gestion des ressources humaines compte beaucoup sur la vie d’une entreprise, nous envisageons une bonne politique de gestion du personnel. Elle constitue à mettre en valeur l’aspect humain du personnel. Nous essaierons d’inciter au personnel le désir d’utiliser ses compétences pour l’intérêt de l’entreprise. La réalisation de ces politiques sera basée sur les points suivants: la bonne rémunération ; la formation continue des institutrices.
La rémunération : pour motiver nos employés, nous proposons un salaire attractif. De plus, ces employés pourront jouir librement de tous leurs droits surtout pour la rémunération des heures supplémentaires pour les agents du département commercial.
La formation continue des institutrices constitue à priori le principal facteur de valorisation des ressources humaines. Pour renforcer le professionnalisme, des formations spécialisées sont développées en formation initiale et continue. « La formation professionnelle constitue l’un des leviers stratégiques de la GRH. Alors, on définira la formation professionnelle comme l’ensemble des disponibilités (pédagogiques) proposés aux salariés afin de leur permettre de s’adapter au changement structurel et à la modification de l’organisation de travail impliqués par des évolutions technologiques et économiques et favoriser leur évolution professionnelle ».
Pour l’éducation fondamentale, la formation des enseignants s’effectue après chaque bimestre de l’année scolaire. Cette formation est appelée « journées pédagogiques ».
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE: PRESENTATION GENERALE DU DISTRICT ET ETUDE DU PROJET
CHAPITRE I : LA PRESENTATION DU LIEU D’IMPLANTATION
SECTION I : LA DESCRIPTION DU DISTRICT
I- L’HISTORIQUE
II- LA DIVISION ADMINISTRATIVE
III- LA STRUCTURE GEOGRAPHIQUE
IV- LA STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE
SECTION II : LA DESCRIPTION DU SITE D’IMPLANTATION
I- LA DELIMITATION GEOGRAPHIQUE
II- LA CARTE DE LA ZONE D’ADMINISTRATION PEDAGOGIQUE
CHAPITRE II : LA PRESENTATION ET CONDUITE DU PROJET
SECTION I : LA DESCRIPTION DU PROJET
I- L’IDENTIFICATION DU PROJET
II- L’ASPECT JURIDIQUE
III – L’ORGANISME FINANCIER DU PROJET
SECTION II : ETUDE ORGANISATIONNELLE DU PROJET
I – LA STRUCTURE D’ORGANIGRAMME
II – LES ATTRIBUTIONS DES FONCTIONS DU PERSONNEL
III- LA GESTION DU PERSONNEL
IV-LES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS
IV- 1- Le respect du règlement intérieur
IV- 2- La communication d’informations
IV- 3- La relation humaine
V- L’ORGANISATION DU LOCAL
V- 1- La distribution des bâtiments
V- 2- Les habitats du projet
VI- LE PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX ET DES ACTIVITES
CHAPITRE III : L’ETUDE DE MARCHE
SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE
I- LA DEFINITION DU MARCHE
II- L’ANALYSE DE L’OFFRE
II- 1- Le marche existant
II- 2- La situation de la concurrence
III- L’ANALYSE DE LA DEMANDE
III- 1-La population ciblée
III- 2- La situation de la demande
SECTION II : STRATEGIES ENVISAGEES
I-LA PARTICULARITES DU PROJET
I- 1- Les points forts de notre établissement
I- 2- Les niveaux existants dans notre établissement.
II-LA TECHNIQUE D’APPROVISIONNEMENT
II-1-Les caractéristiques de l’approvisionnement du projet
II-2-Le mode d’approvisionnement à adopter
II-3-Le processus d’approvisionnement du projet
II-4-Le critères d’évaluation de stocks
III-LA TECHNIQUE DE COMMERCIALISATION
II- LES STRATEGIES MARKETING
II- 1- Comment attirer les clients ?
II- 2- La vente des fournitures scolaires
II- 3-Le transport des élèves
III- LE MARKETING-MIX
III-1-La politique de produits
III-2-La politique de prix
III-3-La politique de distribution
III-4-La politique de communication
PARTIE II : ETUDE FINANCIERE ET FAISABILITE DU PROJET
CHAPITRE I : L’ETUDE DE L’INVESTISSEMENT
SECTION I : L’EVALUATION D’INVESTISSEMENT
I- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
I- 1- L’investissement
I- 2- Les immobilisations
II- L’AMORTISSEMENT
II-1-La définition
II-2-Modalité de calcul
III- LES COUTS DE FONCTIONNEMENT
SECTION II : COMPTES DE GESTION
I- COMPTE DES CHARGES
II- COMPTE DES PRODUITS
SECTION III : L’ETAT FINANCIER DU PROJET
I-LE FINANCEMENT DU PROJET
I- 1- Le choix du mode de financement
I- 2- Le montant de financement demandé
II- REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT
III-LE COMPTE DES RESULTATS PREVISIONNELS
IV-LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
V-LE PLAN DE FINANCEMENT
VI- LES BILAN PREVISIONNELS
VI-1- Bilan d’ouverture
VII-2- Bilans prévisionnels
CHAPITRE II : L’EVALUATION DU PROJET
SECTION I : L’EVALUATION ECONOMIQUE
SECTION II : L’EVALUATION FINANCIERE
I- LA VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN)
II- LE DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL INVESTI
III- LE TAUX DE RENTABILITE INTERNE (TRI)
IV- L’INDICE DE PROFITABILITE (Ip)
SECTION III : L’EVALUATION SOCIALE
I- LA CREATION D’EMPLOIS
II- LA LUTTE CONTRE L’ANALPHABETISME
CHAPITRE III : L’ANALYSE DE RENTABILITE ET DE FAISABILITE DU PROJET
SECTION I : L’ANALYSE DE RENTABILITE
I- LE SEUIL DE RENTABILITE
I- 1-La définition
I- 2-L’utilité du seuil de rentabilité
I- 3-Le calcul du seuil de rentabilité
II- L’ANALYSE DE L’ACTIVITE A PARTIR DES RESULTATS PREVISIONNELS
SECTION II : L’ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET
I- LA FAISABILITE
II- LES MATERIELS UTILISE
II- 1- Le toboggan
II- 2- La balançoire
II- 3- Les jouets
II- 4- Le parc infantile
III- LE SYSTEME EDUCATIF ET DE VENTES APPLIQUES
III- 1- Le système éducatif national
III- 2- La vente en gros et détail
SECTION III : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
I- LE MARKETING SOCIAL
I- 1- La bouche à oreille
I- 2- La publicité
II- L’EVALUATION D’IMPACT
CONCLUSION
ANNEXES