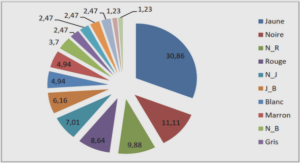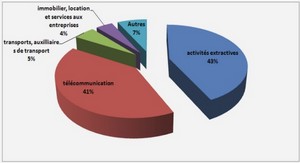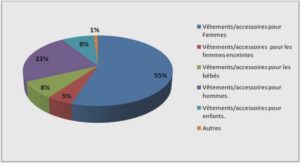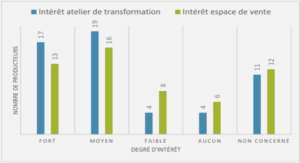Définition de l’Electrification
Il n’y a pas, à proprement parler, de définition exacte du rural dans le domaine de l’électrification. En effet, la notion de communes rurales et urbaines est encore récente et n’entre pas encore en considération dans la priorisation des électrifications des villes ou des agglomérations. Sur le plan technique, une électrification est considérée comme rurale si les puissances installées des groupes électrogènes ou des groupes hydroélectriques des centres d’exploitation ne dépassent pas 2 x 100 KVA (y compris un groupe de secours) et si la longueur du réseau MT est au plus de 1,5 km.
Pour la JIRAMA, la notion de centres ruraux coïncide, globalement, avec les exploitations qui sont classées dans la zone de tarification III.
La JIRAMA s’est occupée des extensions des réseaux existants des zones interconnectées de Tamatave, d’Antananarivo et de Fianarantsoa vers les zones périphériques et de ceux des chefs lieux de Faritany Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave, Tuléar entre autres.
Elle prend en charge l’exploitation des nouveaux centres isolés que le Ministère chargé de l’Energie ou l’Etat lui confie.
D’une manière générale, exception faite de 2 ou 3 centres isolés, la JIRAMA n’initie des travaux d’électrification de nouveaux centres que sur financement provenant de sources extérieures à la Société.
La Stratégie gouvernementale en matière d’Electrification
Dans le secteur de l’électrification, la stratégie actuelle de Gouvernement est de promouvoir les investissements privés, l’Etat ne devant plus jouer qu’un rôle d’arbitre et de régulateur. C’est le sens de la loi N°98-032 du 20/01/1999 portant Réforme du Secteur de l’Electricité. Les grands principes de cette loi sont les suivants :
Abolition du monopole public ; Création d’un fonds national de l’électricité pouvant être utiliser pour subventionner les équipements en zone rurale ; Création d’un organisme régulateur, établissement public chargé du contrôle du secteur électricité et en particulier de ces tarifs ;
Abrogation de la domanialité publique sur les installations réalisées sous concessions ou autorisation ; Facilitation pour la mise en place de capacités d’auto production.
Il est à noter que les Décrets de Développement de cette loi n’ont pas encore paru. Ils devraient fixer, entre autres :
La mise en place de l’organisme régulateur et ses règles de fonctionnement ; La création d’une Agence de Développement de l’Electrification Rurale qui aura comme tâche, entre autres, de définir les procédures d’appel d’offres, les modalités fixant les candidatures spontanées, les procédures et normes applicables, ainsi que les conditions pour les inspections et les contrôles techniques des installations électriques ;
La mise en place d’un Fonds d’électrification rurale (appelé fonds national de l’électricité dans la loi précitée) et ses règles de fonctionnement ;
L’entrée en vigueur des concessions ; Les hypothèques liées aux installations et droits de superficie ; La déclaration des installations d’auto productions.
Gestion des installations – pérennité de l’électrification
Comme dans un système réseau, dans le cas du décentralisé, la pérennité des équipements est primordiale : après avoir « Faire goûter » des utilisateurs à l’énergie électrique, on ne peut revenir en arrière. La pérennité est donc une exigence qui doit être absolument intégrée dans tout alternative : cela signifie dont la mise en œuvre de système qui prévoient dès l’origine les moyens de financement de l’exploitation et de la maintenance des installations, mais aussi, par exemple, une garantie de renouvellement des systèmes individuels ou collectifs à la fin de leur durée de vie De la même manière que pour la solution « réseau » où l’on inclut dans la tarification l’amortissement des investissements, on doit pouvoir inclure dans le mode financement des systèmes décentralisés, non seulement le prix d’achat mais aussi le coût de l’exploitation et de la maintenance et le provisoirement de fonds pour le renouvellement.
Description de l’offre
Comme d’habitude, l’offre passe avant la demande qui est pareil à ce projet. L’Electricité met son énergie au service des hommes non seulement dans leur vie quotidienne pour l’éclairage, le fonctionnement de l’industrie, mais également par ses avantages multiples.
En effet, l’électricité est irremplaçable dans l’industrie parce que le rendement est très supérieur à celui de machine à vapeur et à celui du moteur à explosion.
L’électricité ne peut être stockée, comme le charbon ou le pétrole, dès qu’elle est produite, elle est aussitôt consommée. Or, les demandes, de courant électrique sont variables et parfois imprévisibles. On produit l’électricité dans des usines appelées des : « Centrales Electriques ».
Réseaux électriques
L’énergie sera capter à la sortie d’un tableau de départ installé dans la centrale. L’utilisation d’un réseau de Basse Tension et la plus avantageuse du point de vue coût et maintenance qui est justifié économiquement pour les villages environnant et de même dans le cadre du contexte de l’électrification rurale.
Le dimensionnement des câbles de distribution s’appuiera sur :
La consommation de la zone à desservir et la distance des villages par rapport à la centrale. La puissance demandée.
Et vise à fixer les sections optimales et la nature des câbles pour tous les tronçons du réseau. Les caractéristiques électriques de chaque type de réseaux sont calculées en tenant compte de la chute de tension admissible en bout de lignes ne dépassant pas 12%.
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : VUE GENERALE SUR LE PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE A MADAGASCAR
CHAPITRE I : PRESENTATION DE L’ELECTRIFICATION A MADAGASCAR
Section 1 : Historique
1.1- Le programme d’Electrification Rurale
1.1.1- Définition du domaine rural
1.1.2- Définition de l’Electrification
1.1.3- Rôles respectifs du MEM et de la JIRAMA en matière d’Electrification Rurale
Section 2 : La Stratégie gouvernementale en matière d’Electrification
Section 3 : Caractéristiques
3.1- Objectifs
3.2- Intérêts
Section 4 : Contexte
CHAPITRE II : ETUDE DE MARCHE
Section 1 : Domaine d’étude
1.1- Présentation de la commune Sahanivotry
1.2- Clientèle cible
Section 2 : Description de la demande
2.1- Demande en énergie électrique des villages
2.2- Demande en énergie électrique de l’ONG Atrika
Section 3 : Description de l’offre
PARTIE II : LA CONDUITE DU PROJET
CHAPITRE I : TECHNIQUE DE PRODUCTION
Section 1 : Localisation physique
Section 2 : Les ouvrages
2.1- Le bâtiment de la centrale
2.2- Les conditions de site
Section 3 : Les infrastructures techniques
3.1- Equipements électromécaniques
3.1.1- Le barrage de dérivation
3.1.2- Les voies d’accès
3.1.3- Le système d’adduction d’eau
3.1.4- Le canal de restitution
3.2- Réseaux électriques
Section 4 : Schéma d’exploitation
Section 5 : Liste des matériels et équipements du réseau et de branchement
5.1 Réseau électrique
5.2- Branchement
5.3- Matériels et équipements de la centrale
Section 6 : Gestion et exploitation de la centrale
6.1- Mode de tarification
6.1.1- Compteur classique
6.1.2- Compteur pré-paiement
6.1.3- Tarification collective
6.1.4-Tarification forfaitaire
6.1.5- Comparaison des différents systèmes de tarification
6.1.6- Suggestion
6.2- Organisation et systèmes de gestion communautaire existants
6.3- Gestion
CHAPITRE II : LA CAPACITE DE PRODUCTION ENVISAGEE
Section 1 : Besoin en énergie
1.1-Détermination de la puissance de pointe
1.2- Puissance de pointe toutes consommations confondues
1.3- Courbes des charges
1.4- Charges journalières à la centrale
1.4.1- Année 1
1.4.2- Année 5
1.4.3- Année 10
1.4.4- Année 15
1.5- Analyses
CHAPITRE III : ETUDE ORGANISATIONNELLE
Section 1 : Structure de gestion et d’exploitation
Section 2 : Composition, Evolution de l’effectif et charge du personnel
2.1- Attributions du personnel
2.2- Besoin en personnel
Section 3 : Plan de formation
PARTIE III : ETUDE FINANCIERE ET EVALUATION DU PROJET
CHAPITRE I : MONTANT DE L’INVESTISSEMENT ET LES COMPTES DE GESTION
Section 1 : Le fonds de roulement initial
1.1- Les ressources à long terme
1.2- Les emplois à long terme
Section 2 : Plan de financement
Section 3 : Les Amortissements
Section 4 : Les comptes de Gestion
CHAPITRE II : ETUDE DE FAISABILITE ET ANALYSE DE LA RENTABILITE DU PROJET
Section 1 : Compte de résultat prévisionnel ( pour 5 années)
Section 2 : Tableau des Grandeurs Caractéristiques de Gestion ( pour 5 années)
Section 3 : Bilan prévisionnel (pour 5 années)
Section 4 : Situation prévisionnelle de trésorerie (pour 5 années)
CHAPITRE III : EVALUATION DU PROJET
Section 1 : Evaluation financière
1.1- Marge Brute d’Autofinancement (MBA) et VAN
1.2- Critère de rentabilité
1.3- Taux de Rentabilité Interne (TRI)
1-4- Indice de Profitabilité (IP)
1.5- Délai de Récupération des Capitaux Investis (DRCI)
1.6- Analyse des ratios
1.7- Valeur Ajoutée
Section 2 : Evaluation économique et sociale
2.1- Impact microéconomique
2.2- Impact macroéconomique
2-3- Impact social
CONCLUSION GENERALE