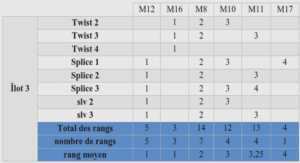Dans le contexte économique actuel où les entreprises sont contraintes de faire face aux enjeux de la libéralisation et de la mondialisation, un système d’information riche, fiable et accessible constitue un des meilleurs vecteurs de promotion qui puisse leur être proposé.
Le projet de développement du TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) à Madagascar est l’un des projets du Ministère des Télécommunication, des Postes et de la Communication qui les exploite à fond pour résoudre le phénomène d’enclavement des zones rurales. La réalisation de ce projet permet :
– d’offrir au plus grand nombre, des meilleures qualités de service à moindre coût, l’accès aux TICs afin de soutenir la croissance économique des régions ainsi que contribuer à améliorer la situation sociale économique de la population.
– de faciliter l’instauration de la transparence de la gestion, la bonne gouvernance, la démocratie grâce aux circulations de l’information.
– de s’évoluer, améliorer, multiplier, pour les jeunes, sur le point de vue compétence et de la connaissance.
– de créer des nouveaux emplois afin de diminuer l’effectif des jeunes touchés par le chômage dans le Pays.
Il a fallu donc faire des travaux de recherche pour l’étude de faisabilité qui consiste à déterminer les stratégies à adopter pour choisir les actions et l’allocation des ressources afin d’atteindre les buts et les objectifs du projet, ainsi, des information et données ont été collectées à partir d’une étude documentaire à travers des enquêtes auprès de la clientèle, des entretiens avec les responsables d’entreprises œuvrant déjà dans le domaine du TIC et de consultation des documents auprès des divers établissements.
Le problème de l’accès universel se pose avec plus d’intensité aux pays en voie de développement depuis qu’ils sont touchés par le vent des réformes du secteur, en effet, avec le tarissement des sources traditionnelles de financement du secteur, conjointement avec l’obligation de concurrence avec de nouveaux opérateurs privés ayant fait leur entrée sur le marché grâce au processus de privatisation et de libéralisation, les opérateurs historiques ont vu leur capacité d’investissement largement entamée.
On remarque la difficulté de subventionner les tarifs des communications nationales grâce aux bénéfices réalisés par les communications internationales. Par ailleurs, le financement de l’accès universel et de développement des zones rurales prévu dans le cadre des nouvelles lois régissant le secteur des télécommunications peine à se réaliser, soit par manque de politiques et de stratégies adaptées, soit à cause de la jeunesse de processus qui n’a pas encore eu le temps de produire les effets escomptés ou parfois à cause des deux causes.
La grave conséquence de cette situation est encore la pénalisation des couches les plus pauvres, en particulier celles des zones rurales qui représentent plus de 70% de la population. Pourtant, les technologies de l’information et de la communication se sont relevées un formidable et puissant outil de développement économique et social, d’intégration régionale et de l’aménagement du territoire. Leur potentiel s’est encore mieux affirmé avec l’avènement d’Internet et des autres nouvelles technologies, tout en engendrant de nouveaux risques de fragilisation et de marginalisation des pays.
HISTORIQUE DU PROJET
Contexte international
Conscients des dangers de marginalisation mais aussi du potentiel de ces outils, les pays scandinaves (Suède, Danemark et Finlande) ont été les premiers, dès les années 80, à développer et à mettre en œuvre le concept des Entreprises de Microédition et Internet dans le but d’intégrer leurs populations rurales dans le processus national de développement économique et social. Le modèle a été ensuite reproduit, dans les années 90, en Amérique du Nord (Terre neuve et Labrador au Canada), en Europe (Manchester en Grande Bretagne) ; lors de la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications tenue à la Valette (Malte), en mars 1998, il a été recommandé aux pays les moins avancés (PMA) de recourir aussi à cette stratégie pour accélérer la démocratisation de l’accès aux services de télécommunication et un appel a été lancé aux partenaires en développement pour qu’ils assistent les PMA à développer et à mettre en œuvre des stratégies de création de Télécentre.
De nombreux partenaires en développement (Canada, Danemark, Pays-Bas, USA pour les Pays UNDP, UNESCO, la Banque Mondiale, pour les organismes et le secteur privé international) ont également répondu favorablement à cet appel, et dans certains cas en partenariat avec l’UIT/BDT. C’est ainsi que dès 1999, le phénomène des Télécentres a pris une ampleur sans précédent, tant au niveau des projets d’implantation que dans la réflexion de la communauté internationale.
En Afrique, des expériences de Télécentres ont été réalisées : en Afrique du sud (65 Télécentres) au Benin, Burkina Faso, Mali, Tanzanie, Mozambique, en Ouganda. Ces expériences ont été supportées par les principaux partenaires comme : l’UIT /BDT, CRDI du Canada, Francophonie, LearnLink de l’USAID. Ces initiatives ont donc grandement contribué au développement de l’accès universel au profit de la population et leur impact socio-économique est très important.
Contexte National
Pour des raisons Financières, Madagascar est en retard et devrait être à la hauteur de l’évolution du monde technologie. Actuellement, l’Etat Malgache constate son importance parce que c’est une des voies vers le développement rapide et durable. La technologie de l’information et de la communication participe ainsi à la réduction de la pauvreté. Le développement devrait fonder sur l’amélioration de l’environnement des zones rurales qui sont privées de l’infrastructure, l’accès aux informations et aux ressources nécessaires à l’expansion de la connaissance. C’est la raison pour laquelle, l’Etat a solliciter le concours de l’UIT/BDT qui, en collaboration avec l’opérateur national TELMA saisit l’opportunité de créer les tout premiers Télécentres communautaire, pour permettre à la société rurale d’entrer dans le troisième Millénaire d’une manière formelle. Partant de la politique de 3P, il y aura donc la participation des opérateurs privés. C’est pourquoi ce travail a été fait, il a pour but la mise en place et l’exploitation d’un Télécentre dans la commune de Tanambe district d’Amparafaravola.
DESCRIPTION DU PROJET
Structure du Cyber Centre
Un Cyber Centre est un centre Technologique communautaire multiservices ouvert au public et offre l’accès aux services de la téléphonie, fax, Internet, multimédia, bureautique, reprographie, associés de la formation en informatique et d’autres activités sociales comme la création d’un petit complexe sportif pour les jeunes, l’animation d’un club de lecteur, l’organisation de conférence à thème et de cession de formation. Il sera donc un lieu convivial d’échanges, de rencontre et de formation.
Les typologies de Cyber Centre
La classification typologique des Cyber Centres est très controversée dans la littérature des chercheurs. Si tout le monde s’accorde pour définir le Cyber Centre comme un lieu privatif où le public peut accéder à des services de télécommunication, la dénomination des divers modèles qui se sont développés ces dix dernières années ne fait pas toujours l’unanimité. Toutefois, tout le monde s’accorde sur le fait que l’essentiel reste la viabilité des Cyber Centre pour garantir la fourniture des services au plus grand nombre et pendant une longue période. Dans le cadre du présent projet, on recommande les modèles fondés sur l’approche commerciale tout en y associant la stratégie permettant d’atteindre les objectifs de développement économique et social.
Peut- être il faut ici citer les trois modèles les plus courants à savoir :
❖ Les entreprises de Microédition et Internet privées
Elles sont réalisées par des investisseurs privés, conçus et exploités selon les lois du marché. De ce fait, leur taille, l’éventail des services et les tarifs pratiqués sont dictés par le marché, même si dans certains cas, un encadrement peut s’avérer nécessaire pour des questions dépendantes de l’environnement réglementaires du secteur des télécommunications et également des questions d’éthique.
❖ Les entreprises de Microédition et Internet corporatifs
Elles sont réalisées par une association, une coopérative ou une ONG visant à servir en premier ses membres. Dans ce cas, même si le profit n’est pas recherché comme une priorité de gestion, l’équilibre financier et l’autonomie financière de gestion assurant la pérennité de l’outil en dictent la conception et le mode opératoire. Ce sont généralement des entreprises dédiés à la fourniture d’une série d’informations répondant aux besoins de la coopération. (Ex : Association de femmes entrepreneurs, coopératives agricoles, etc.) .
❖ L’entreprise Microédition et Internet associée à une structure
Elles sont généralement installées dans des structures accueillant du public. Ils peuvent faire partie intégrante de la structure ou être associés à la structure selon des modalités arrêtées avec les autorités compétentes de cette structure : franchise, contrat de gérance, location- bail, etc. C’est par exemple le cas des entreprises ou les centres d’accès aux services des télécommunications sont installés dans les bibliothèques, les hôpitaux, les universités, voire dans certains centres hôtels, où les centres d’accès dans les bureaux de poste.
INTRODUCTION |