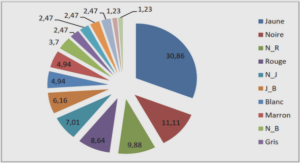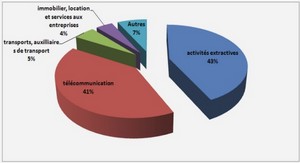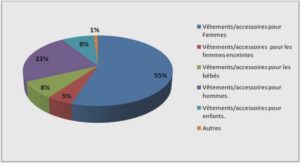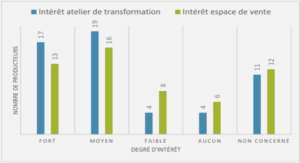Présentation générale des produits
Le miel est la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant des parties vivantes des plantes, qu’elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. La cire, quant à elle, est une substance grasse sécrétée par les glandes cirières des jeunes ouvrières. Compositions des produits : Notons que 100g de miel apporte 312 kcal et 1kg de miel équivaut à 12kg de viandes rouges ou de 50 œufs.
Le miel est composé de : sucres réducteurs exprimés en sucres invertis : plus de 60% ,eau : moins de 10% ,matières insolubles dans l’eau : moins de 0,1%, matières minérales : moins de 1%, acides libres: moins de 40 milliéquivalent par kilogramme. La cire ne représente que 1 à 2% du miel.
Usages des produits : Le miel peut servir de médicament permettant de lutter contre l’asthénie, certains troubles digestifs, ulcères gastriques, des déficiences cardiaques, respiratoires, neuropsychiques etc. En dehors de la table, ce produit s’emploie : pour fabriquer des bonbons, du sirop au miel, des pastilles, pour diluer et conserver la gelée royale, pour fabriquer de l’hydromel et des aliments de nourrisson.
Intérêts du projet
Vu le décret relatif à la collecte et au traitement du miel et en attendant la sortie de l’arrêté d’application, aucun miel ne pourra plus être commercialisé s’il n’est pas issu d’une miellerie agréée par l’Etat. Ce projet vise à soutenir le développement apicole dans la commune rurale d’Ambohimiadana Andramasina et à implanter une miellerie pour le traitement des produits apicoles. Autrement dit, sa réalisation est un vecteur permettant de favoriser et de contrôler, dès maintenant, la qualité des produits. De ce fait, les apiculteurs seront obligés de normaliser le système de production.
Sur le plan national, l’investissement que nous effectuons contribue à l’amélioration du Produit Intérieur Brut (PIB) de notre pays qui est constitué par la somme des valeurs ajoutées réalisées par chaque agent économique. Les impôts et taxes versés par la miellerie concourent également à l’alimentation de la caisse de l’Etat.
Par ailleurs, l’organisation de la filière apicole et le regroupement des paysans dans l’organisation paysanne faitière MAMISOA, sise à Ambohimiadana et fondée en 2007, constituent un atout majeur car ils facilitent la mise en œuvre du projet. Elle est actuellement constituée par huit unions qui sont réparties dans le district d’Andramasina. Les apiculteurs, membres de cette fédération, sont encadrés par le programme SAHA et sont dotés de matériels apicoles modernes. Ils sont aussi formés par l’organisation d’appui pour le développement intégré (ODADI) et par d’autres techniciens en apiculture. Par conséquent, les apiculteurs promoteurs (AP) de chaque union de l’OPF, compétents en apiculture, jouent le rôle de pilote dans la mesure où ils pratiquent la technique d’élevage moderne. Dans ce contexte, en coopération avec ces paysans, nous cherchons à lancer davantage ce type d’apiculture et à convaincre les apiculteurs traditionnels dans le but de produire de miel de qualité.
Inconvénients du projet
Malgré ces atouts, notre projet présente des inconvénients. au niveau de la production : la faible capacité d’investissement des paysans a une influence sur la qualité de la production car les matériels sont généralement archaïques ou ne sont pas parfaitement adaptés au traitement des produits alimentaires.
En outre, sur le volume de la production, les apiculteurs ne peuvent pas augmenter rapidement le nombre de ruches.
On a également l’insuffisance de connaissances techniques et pratiques, les vols de ruche, le non respect de la période favorable à la récolte, etc.
au niveau de la commercialisation, le marché européen n’est pas encore ouvert au miel malgache car il exige la mise en place d’un Plan de Surveillance des résidus qui n’est pas aujourd’hui opérationnel « le codex alimentarius ». Les circuits de commercialisation sont aussi mal organisés. La filière apicole est une filière dans laquelle les circuits informels prédominent aujourd’hui. Le non respect des conditions d’hygiènes relatives au travail de miel, le problème de falsification, , l’insuffisance de contrôles aux frontières pour les importations de miel ou de matériels d’occasions risquent de véhiculer des maladies transmissibles aux abeilles malgaches.
au niveau des ressources naturelles et de l’environnement, on constate la diminution des ressources mellifères due à la fabrication de charbon, aux feux de brousse et à l’exploitation des bois précieux et des bois d’œuvres. La figure ci-dessous nous présente la destruction de l’environnement du site d’implantation de ce projet.
Comportement des consommateurs
D’une manière générale, ils sont attirés et motivés par les nouveaux produits lancés sur le marché. Notons que l’étendue d’un marché est généralement composée : du marché de l’entreprise ; du marché de la concurrence ; des non consommateurs relatifs c’est-à-dire ceux qui ignorent l’existence du produit ou de son usage lorsque la politique de distribution et de communication sont insuffisants de la part de l’entreprise. Ils devraient constituer un véritable champ de bataille pour l’entreprise en concurrence. des non consommateurs absolus qui, pour des raisons matérielles, physiques ou psychiques, sont dans l’impossibilité absolue de consommer le produit.
Concernant le commerce intérieur, la vente de miel est courante près des régions apicoles et son importance est difficilement évaluable.
Stratégie marketing
Il convient de définir les moyens à privilégier par l’entreprise pour vendre ses produits. Dans notre cas, nous avons adopté deux stratégies possibles à savoir la stratégie Pull et la stratégie Push.
Stratégie Pull ou « tirer » : Elle consiste à attirer les consommateurs vers notre produit et à créer la notoriété au début de la vente. Pour ce faire, nous envisageons de participer aux relations publiques comme le salon, la vente exposition, la braderie, etc. pour lancer davantage le produit sur le marché. A cet effet, les stratégies-prix suivants peuvent être adoptées : le prix de pénétration : au moment de lancement du produit sur le marché, nous allons appliquer cette stratégie. Elle consiste à vendre à un prix relativement bas par rapport aux concurrents de façon à acquérir rapidement une part de marché importante ; le prix d’écrémage : lorsque notre produit arrivera à la phase de développement, nous allons adopter cette stratégie. Il s’agit donc d’un prix relativement haut, à adopter lorsque le produit atteint la phase florissante en vue de toucher une clientèle restreinte et à réaliser un profit important. Stratégie Push ou « pousser » : Il s’agit de pousser le produit vers les consommateurs. Généralement, cette stratégie est utilisée au cas où l’entreprise cherche à réduire les frais commerciaux et les dépenses relatives à la production. D’où la mise en vente promotionnelle des produits et l’incitation des distributeurs à vendre davantage notre marque.
Pour notre projet, le choix de la stratégie à mettre en œuvre dépend en grande partie de la situation où se trouve le produit de l’entreprise. Néanmoins, nous avons opté la stratégie Push afin de couvrir rapidement le marché et de rendre le produit à la portée des consommateurs.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : IDENTIFICATION DU PROJET
Chapitre 1 : PRESENTATION DU PROJET
Section 1 : Importance de la filière apicole à Madagascar
Section 2 : Choix du site d’implantation
2.1- Situation géographique
2.2- Situation démographique
2.3- Situation climatologique
Section 3 : Caractéristiques du projet
3.1- Présentation générale des produits
3.1.1- Compositions des produits
3.1.2- Usages des produits
3.2- Intérêts et inconvénients du projet
3.2.1- Intérêts du projet
3.2.2- Inconvénients du projet
3.3- Régime juridique
3.4- Cadre logique
Chapitre 2 : ETUDE DE MARCHE
Section 1 : Analyse de l’offre
Section 2 : Analyse de la demande
2.1- Demande globale
2.2- Comportement des consommateurs
2.3- Part de marché
Section 3 : Analyse de la concurrence
3.1- Concurrence directe
3.2- Concurrence indirecte
Section 4 : Stratégie et politique marketing
4.1- Stratégie marketing
4.1.1- Stratégie Pull ou « tirer »
4.1.2- Stratégie Push ou « pousser »
4.2- Politique marketing
4.2.1- Politique du produit
4.2.2- Politique du prix
4.2.3- Politique de distribution
4.2.4- Politique de communication
Chapitre 3 : THEORIE GENERALE SUR LES OUTILS ET CRITERES
D’EVALUATION DU PROJET
Section 1 : Outils d’évaluation
1.1- Valeur Actuelle Nette
1.2- Indice de Profitabilité
1.3- Taux de Rentabilité Interne
1.4- Délai de Récupération des Capitaux Investis
Section 2 : Critères d’évaluation
2.1- Pertinence
2.2- Efficacité
2.3- Efficience
2.4- Durabilité ou viabilité
DEUXIEME PARTIE : CONDUITE DU PROJET
Chapitre 1 : ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE
Section 1 : Environnement du site d’implantation
1.1- Calendrier des activités apicoles
1.2- Aménagement du site
Section 2 : Technique de production
2.1- Identification des matériels
2.1.1- Matériels d’élevage
2.1.2- Matériels de récolte
2.1.3- Matériels d’extraction
2.1.4- Matériels de stockage et de conditionnement
2.2- Exploitation des ruches
2.2.1- Peuplement des ruches
2.2.2- Installation des ruchers et mise en place des ruches
2.2.3- Suivi de l’élevage et récolte
Chapitre 2 : PROCESSUS ET CAPACITE DE PRODUCTION
Section 1 : Processus de production
1.1- Identification des ruches
1.2- Aspect qualitatif des produits
1.2.1- Qualité du miel
1.2.2- Qualité de la cire
Section 2 : Capacité de production
2.1- Evolution de la production
2.2- Facteurs de production
2.2.1- Apiculteurs
2.2.2-Technique apicole
2.2.3-Qualité de la reine
2.2.4 -Environnement
Section 3 : Miellerie
3.1- Caractéristiques de la miellerie
3.2- Traitement de miel
3.3- Traitement de la cire
Chapitre 3 : ETUDE ORGANISATIONNELLE
Section 1 : Organigramme
Section 2: Attribution des tâches
Section 3 : Chronogramme du projet
TROISIEME PARTIE : ETUDE FINANCIERE
Chapitre 1 : INVESTISSEMENTS
Section 1 : Immobilisations
1.1- Immobilisations corporelles et incorporelles
1.2- Coût total des immobilisations
1.3- Fonds de Roulement Initial (FRI)
Section 2 : Plan de financement
2.1- Récapitulation des investissements
2.2- Ressources stables
Section 3 : Remboursement de l’emprunt
Chapitre 2 : ETUDE DE FAISABILITE
Section 1 : Comptes de gestion
1.1-Charges
1.2 – Produits
Section 2 : Plan de trésorerie
Section 3 : Compte de résultat
3.1- Compte de résultat prévisionnel
3.2- Compte de résultat prévisionnel par nature
Section 4 : Bilan prévisionnel
Chapitre 3 : EVALUATION DU PROJET
Section 1 : Evaluation financière
1.1- Outils d’évaluation
1.1.1- Valeur Actuelle Nette
1.1.2- Indice de Profitabilité
1.1.3- Taux de Rentabilité Interne
1.1.4-Délai de Récupération des Capitaux Investis
1.2-Seuil de rentabilité et point mort
Section 2 : Evaluation économique
2.1- Ratios
2.2- Impacts économiques
2.3- Impacts socio-environnementaux
CONCLUSION GENERALE