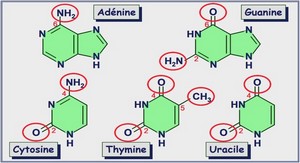Préservation de la crête marginale cavités slots et tunnels
Champ opératoire et matriçage
La mise en place d’un champ opératoire constitué par une feuille de digue maintenue par crampon doit être systématique avant toute technique de micro-dentisterie restauratrice. Bien que la littérature ne démontre pas une différence significative de longévité entre les restaurations placées ou non sous digue dans la mesure où des rouleaux de cotons et une aspiration efficace sont utilisés (42,43), les avantages sont multiples :
• préventifs :
◦ éliminer le risque d’inhalation ou d’ingestion d’instrument, matériel ou matériau dentaires.
◦ réduire le risque d’accidents mécaniques ou chimiques sur les surfaces dentaires adjacentes et sur les tissus mous environnant par déflexion des joues et de la langue notamment et isolement des dents traitées du reste de la cavité buccale (dents, gencive marginale, papilles interdentaires…).
• ergonomiques :
◦ limiter la fatigue visuelle en réduisant le nombre de surfaces dentaires exposées et en augmentant le contraste des dents avec le milieu environnant.
◦ permettre un protocole continu sans interruption (absence de nécessité d’aspiration de la salive, libération des deux mains de l’opérateur par exemple).
• thérapeutiques :
◦ réduire au maximum le risque de contamination salivaire au niveau de la dentine instrumentée et assurer ainsi une étanchéité optimale au moment de la restauration.
◦ autoriser un protocole d’adhésion optimal des surfaces dentaires instrumentées car nécessité d’utilisation de produits hydrophobes.
◦ autoriser un coiffage pulpaire direct dans les meilleures conditions d’asepsie en cas d’effraction pulpaire lors du débridement carieux.
Le matriçage : que l’on soit dans le cas de cavités de classe II ou de cavités slots ou tunnels, les matrices métalliques pré-galbées de faible épaisseur associées à un coin écarteur en plastique doivent être privilégiées. Dans le cas où le point de contact proximal doit être restauré, cette matrice doit être brunie à l’aide d’un fouloir métallique au niveau du futur contact proximal avec la dent adjacente. La digue liquide de type Opaldam (Bisico) ou Notre Dam (Elsodent) est une résine photopolymérisable permettant, si nécessaire, de parfaire l’adaptation de la matrice aux faces proximales (uniquement dans l’embrasure opposée à celle ayant permis l’accès à la lésion dans le cas de cavités « en entonnoir ») afin de prévenir les débordements et excès de matériau. (38)
Instruments de modelage
Dans le cas où la restauration est effectuée à l’aide de résine composite, des instruments de modelage spécifique n’adhérant pas au matériau non polymérisé seront utilisés pour le fouler (fouloirs) et le modeler (spatules) avant polymérisation. Ces instruments peuvent posséder un revêtement spécifique (nitrure de Titane par exemple) ou simplement être soigneusement polis (1).
Matériel de polissage
La finition et le polissage des restaurations une fois celles-ci réalisées sont deux phases indispensables. Plusieurs étapes sont retrouvées, quels que soient le système et la marque utilisés:
• polymérisation finale sous une couche de gel glycériné.
• retrait des excès et réalisation de la macro-géographie.
• réalisation de la micro-géographie, notamment sur les dents antérieures.
• polissage en interproximal et en occlusal : polissoirs siliconés puis brossettes et pâte diamantée (ou brossettes pré-imprégnées).
• lustrage avec disques en feutre et pâte de lustrage.
Certains coffrets comme Enamel Plus Shiny® (Bisico) regroupent la majorité du matériel nécessaire. Les instruments peuvent aussi être trouvés séparément :
• lames de bistouri 11 ou 15 pour enlever le plus gros des excès de matériau.
• fraises diamantées de fine granulométrie (bague rouge), fraises Arkansas, fraises en carbure de tungstène et fraises en carbure de silicium (Shiny 21, Bisico) pour enlever les trop-pleins et recréer la macro- et la micro-géographie.
• polissoirs de différentes granulométrie, avec ou sans grains de diamants.
• pointes silicone diamantées (Optrapol®, Ivoclar Vivadent ; Shiny 14, Bisico).
• disques abrasifs.
• strips inter-proximaux métalliques ou en matrice translucide avec différentes tailles de particules abrasives.
• pâtes de polissage et de lustrage (Dia Polisher Paste®, GC ; Prisma Gloss®, Dentsply). 3.3. Les matériaux (1,44)
Les matériaux d’obturation actuellement à notre disposition en micro-dentisterie restauratrice sont représentés par la résine composite ou le ciment verre-ionomère modifié par adjonction de résine (CVIMAR) selon le cas clinique. L’amalgame étant un matériau non-adhésif, il ne peut être utilisé en micro-dentisterie dont les formes de cavité ne répondent pas aux principes de Black (résistance, rétention, finition des bords…). De plus, il ne renforce pas la structure de la dent et n’est ni esthétique ni bioactif.
• Résine composite : il s’agit d’un matériau de restauration composé d’une matrice organique principalement résineuse enrobant des charges de forme et de taille variables par l’intermédiaire d’un agent de couplage organo-minéral représenté par le silane. La résine composite, du fait de sa composition, est très esthétique et permet l’obturation de cavités de très petite taille. En revanche, elle ne possède aucun potentiel adhésif propre et doit donc être utilisée avec un système adhésif au préalable, en respectant un protocole de collage précis, plus ou moins sensible et opérateur-dépendant. Cette procédure de collage permet la création d’une couche hybride à la surface de la dent préparée, sur laquelle la résine composite sera ensuite stratifiée par apports de petits incréments successifs (méthode du « composite up ») afin de limiter les contraintes de rétraction à l’interface dent-restauration lors de la réaction de polymérisation. Un autre inconvénient de ce matériau est la mauvaise tolérance pulpaire lorsqu’il est placé trop près de la pulpe.
• CVIMAR : les CVIMAR sont des ciments verre-ionomères modifiés par incorporation de petites quantités de résine dans une matrice de polyacrylates enrobant des particules de verre. Ce matériau possède un potentiel adhésif propre à la dentine, à l’émail et à la résine composite ainsi qu’un potentiel de reminéralisation et antibactérien grâce à la présence d’ions fluor. Sa sensibilité à l’humidité est moindre par rapport à la résine composite, de même que sa résistance à l’usure, son esthétique et sa polissabilité, ce qui l’indique le plus souvent dans des zones non sollicitées par les contacts occlusaux ou en association avec une résine composite lorsque la face occlusale doit être partiellement reconstituée (technique
« sandwich » ouvert ou fermé). En revanche, sa biocompatibilité étant supérieure, il peut être placé dans les cavités profondes sans mauvaise tolérance pulpaire.
Les différents types de traitements
Quel que soit le type de traitement envisagé, le nettoyage prophylactique professionnel est un préalable indispensable qui aura déjà du être effectué à la phase de diagnostic.
Cavités de classe II classiques (38,45)
La crête marginale représente une structure de résistance de la dent. Cependant, certaines situations contre-indiquent sa conservation :
– épaisseur inférieure à 1mm ; dans ce cas, la crête marginale apparaît bleue en fluorescence, en raison de l’absence de signal vert fourni par la dentine saine sous-jacente normalement présente.
– présence de fêlures ; elles peuvent être présentes avant ou après préparation cavitaire.
– lésion carieuse à un stade trop avancé (stade 2-3).
– patient à haut risque carieux.
Elle est alors éliminée lors de la préparation cavitaire et du débridement carieux qui se feront donc par voie occlusale.
Le protocole opératoire est le suivant :
1 – Anesthésie.
2 – Protection de la face proximale adjacente par une matrice métallique épaisse.
3 – Réalisation d’une cavité occlusale d’accès a minima grâce à une instrumentation rotative appropriée.
4 – Ouverture a minima de la crête marginale.
5 – Finition de la cavité d’accès, majoritairement à l’aide d’instruments soniques ou ultrasoniques.
6 – Débridement de la dentine infectée.
7 – Mise en place du champ opératoire représenté par la feuille de digue.
8 – Mise en place d’une matrice métallique fine, préférentiellement sectorielle et précourbée, que l’on brunira au niveau du futur point de contact avec la dent adjacente après mise en place d’un coin écarteur. De la digue liquide peut éventuellement venir compléter le matriçage de la cavité.
9 – Procédure de collage et obturation à l’aide de résine composite par incréments successifs, ou une association CVIMAR-résine composite en cas de cavité proche pulpaire (technique sandwich).
10 – Finitions, polissage et réglage de l’occlusion.
Préservation de la crête marginale : cavités slots et tunnels cavités tunnels (38,46) :
Ce type de cavité est réservé aux lésions de stade 1 dans le cadre d’un risque carieux contrôlé, si l’épaisseur de la crête marginale est suffisante (fluorescence verte) et en l’absence de fêlure. Elle consiste à créer un accès occlusal au niveau de la fosse, orienté en proximal afin de créer un accès à la lésion tout en préservant la crête marginale. Le tunnel peut être ouvert (ouverture en proximal et élimination de l’émail déminéralisé ou perforé) ou fermé si de l’émail déminéralisé mais non perforé est laissé en place ; le tunnel fermé reste cependant anecdotique.
Protocole opératoire :
1 – Anesthésie.
2 – Protection de la face proximale adjacente à l’aide d’une matrice métallique épaisse.
3 – Réalisation d’une cavité occlusale d’accès a minima au niveau de la fosse de la crête marginale grâce à une fraise boule diamantée orientée à 45° en direction de la face proximale.
4 – Continuer la préparation d’accès à la lésion carieuse grâce à des inserts soniques et ultrasoniques boules diamantés angulés qui permettent un dégagement visuel.
5 – Élimination de la dentine infectée à l’aide d’une fraise boule à lames utilisée à vitesse lente avec irrigation.
6 – Finition de la préparation à l’aide d’inserts angulés.
Il faut à ce stade vérifier l’absence de fêlure au niveau de la crête marginale. Le cas échéant, cela indiquerait la nécessité de passer à une préparation de classe II classique.
7 – Mise en place du champ opératoire représenté par la feuille de digue.
8 – Mise en place d’une matrice métallique avec coin écarteur.
9 – Deux matériaux peuvent être utilisés à ce stade en fond de cavité : du CVIMAR ou de la résine composite. La restauration par résine composite étant dépendante de plus de facteurs (humidité, couche hybride, stress de polymérisation, accès difficile pour une stratification par incréments), le CVIMAR doit lui être préféré (potentiel adhésif, relargage de fluor, peu de variations dimensionnelles lors de la polymérisation).
Le conditionnement des surfaces sera réalisé selon le matériau de restauration choisi.
10 – La cavité occlusale est alors restaurée par stratification à l’aide d’une résine composite classique dont les propriétés mécaniques et esthétiques sont beaucoup plus satisfaisantes que celles du CVIMAR.
11 – Finitions, polissage et réglage de l’occlusion.
Les échecs cliniques de cette technique sont principalement dus à la fracture de la crête marginale et à une carie secondaire. De plus, il s’agit d’une technique très opérateur-dépendante, d’où la nécessité d’un choix soigneux des cas.
Cavités slots (38,47) :
L’accès à la lésion se fait dans ce cas par voie latérale et non plus occlusale. Ces cavités portent également le nom de cavités « en entonnoir ». Les indications ou contre-indications sont identiques
à celles des cavités tunnels. Ici encore, la crête marginale est conservée mais aucune altération n’est portée à la surface occlusale de la dent.
Protocole opératoire :
1 – Anesthésie.
2 – La préparation débute sur la face proximale, en vestibulaire ou lingual selon l’accessibilité, à l’aide d’une fraise boule diamantée de petit diamètre afin de « créer un passage » après protection de la face proximale adjacente à l’aide d’une matrice métallique épaisse.
3 – Utiliser des inserts demi-boules hémi-travaillants sous irrigation en se dirigeant sous le point de contact afin de continuer la préparation mais d’éviter toute lésion sur la surface proximale adjacente.
4 – Mise en place du champ opératoire représenté par la feuille de digue.
5 – Élimination de la dentine infectée à l’aide d’une fraise boule à lames utilisée à vitesse lente avec irrigation ou d’un insert boule selon l’accessibilité aux instruments ou encore par un curetage manuel à l’aide du système Carisolv®.
6 – Matriçage par matrice métallique avec coin écarteur en plastique, pouvant être complété par digue liquide dans l’embrasure opposée à celle ayant permis l’accès à la lésion.
7 – Le CVIMAR présenté sous forme injectable est le matériau recommandé dans ce type de restauration. Les surfaces sont conditionnées puis le matériau est injecté sous pression dans la cavité, le matriçage est replié et la photo-polymérisation est réalisée par voie occlusale et proximale du côté de la voie d’accès.
8 – Une fois la matrice retirée, les excès sont enlevés à la lame de bistouri et la restauration est polie à l’aide de strips abrasifs, de disques pop-on et de polissoirs.
9 – Mise en place d’un vernis de protection fluoré sur la restauration.