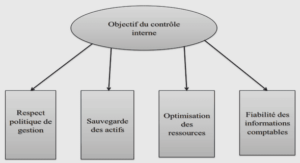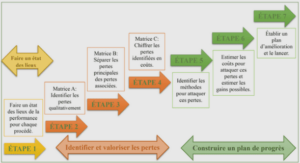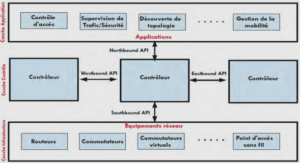« Je voudrais demander au lecteur d’envisager favorablement une doctrine qui peut, je le crains, paraître extrêmement paradoxale et subversive. La doctrine en question est la suivante : il n’est pas désirable de croire en une proposition lorsqu’il n’y a aucune raison de penser qu’elle est vraie ». Bertrand Russell
La démarche qui nous a animée a été fortement motivée par la découverte très contre-intuitive que la transmission des connaissances en sciences ne suffit pas à forger un esprit critique suffisant. Depuis les années 70, un certain panel d’études sociologiques a montré que niveau d’études et niveau d’adhésions à des thèses pseudoscientifiques ne sont pas, comme l’aurait laissé croire le bon sens, inversement corrélés. La transmission de connaissances scientifiques ne se fait pas sans heurts.
Nous avons d’abord suggeré que la part de transmission liée aux médias semblait fortement parasitée par toute une panoplie de contraintes faisant indirectement le lit de croyances pseudoscientifiques, lesquelles sont à l’exact opposé de l’objectif éducatif annoncé. Décrire ces contraintes aux étudiants permettrait alors peut être d’atténuer une part des nuisances occasionnées.
Puis l’idée nous est venu de prendre le problème à l’envers : partir d’abord des médias euxmêmes et remonter vers l’épistémologie des sciences. Cela permettrait alors d’être dès le début dans le vif du sujet, dans la mode, et d’accrocher l’apprenant. Cela permettrait aussi d’illustrer facilement et in vivo les contraintes en question, en particulier avec la méthode zététique, aussi efficace qu’émoustillante. Avec le soutien de H. Broch et de plusieurs collègues grenoblois, nous entreprîmes alors la création de cours spécifiques de didactique de l’esprit critique, avec l’objectif de tester des moyens d’instiller ce regard critique vis-à-vis des mass-media lorsque ceux-ci offrent du contenu scientifique.
Le rêve que nous avons nourri ensuite fut de mettre progressivement à disposition une sorte de creuset méthodologique dans lequel un enseignant universitaire souhaitant stimuler les compétences critiques chez ses étudiants puisse puiser sans trop de difficulté. Il s’avère avec le recul qu’il s’agissait d’une entreprise bien complexe à plusieurs points de vue.
Complexe tout d’abord en raison de l’objet cognitif en lui-même : l’esprit critique. Qu’en dire ? Quelles compétences, quelles habilités, quels savoir-faire développer, quels savoir-être mettre en jeu ? Peut-on, à l’instar d’un outillage mathématique ou physique, prétendre que quelqu’un a « acquis » de l’esprit critique ? O. Chenevez en fait le constat en introduction à son Cahier Pédagogique : « On n’enseigne pas l’esprit critique, il n’existe aucune méthode d’« esprit critique en cinquante leçons », à délivrer selon une posologie savante. Aucune mesure, aucune évaluation précise ne permet de délivrer un brevet « d’esprit critique ». L’esprit critique s’acquiert, petit à petit, par l’expérience, l’habitude de faire appel transversalement aux savoirs et de les questionner » (Chenevez 2000).
Les questionner. C’est le point qui a mobilisé notre attention. Quelles techniques pouvons-nous mettre en place pour questionner ces savoirs, les tâter, les soupeser, se les approprier et éventuellement les rejeter ? Il n’existe qu’une littérature très éparse sur la question. À cela plusieurs raisons peuvent être invoquées.
D’abord, les contenus d’enseignement du supérieur en sciences ne sont pas décrits. Ensuite, leur transmission y est extrêmement formelle. Il est dispensé majoritairement de la connaissance brute, noble, « efficace ». Tout ce qui en déborde est perçu comme une perte de temps ou d’argent d’investissement, comme les dernières décisions politiques concernant les universités finissent de nous en convaincre. C’est ainsi que la méthodologie scientifique, l’épistémologie, la psychologie sociale, la philosophie, l’histoire et la sociologie des sciences, épargnant une grande majorité des étudiants, risquent la mise sur la sellette. Enfin, cette connaissance brute répond moins volontiers à la création d’esprits larges qu’à la demande mercatique. De fait, enseigner l’esprit critique est non nécessaire pour une adaptabilité au marché de l’emploi. On nous l’a répété plusieurs fois. Corrélation ou causalité, il existe très peu de séquences d’enseignement spécifiques dévolues à l’esprit critique dans les cursus scientifiques. Lorsqu’elles existent, elles sont extrêmement sensibles aux bourrasques politiques intra-université, et aux suppressions de crédits déjà fort discrets. C’est le suivi des séquences, pourtant plusieurs fois menacées, de Henri Broch, qui nous fit comprendre qu’une bonne partie du travail avait, fort heureusement pour nous, déjà été entrepris.
Il est pratiquement impossible de tracer une histoire, même brève, du critical thinking, justement par sa transversalité disciplinaire. En forçant le trait, on peut dire que dès que le premier individu de l’histoire a douté de ce qu’un proche lui rapportait sur la simple base qu’un témoignage n’est pas toujours fiable, il participa du critical thinking. Si nous acceptons de nous cantonner aux écrits accessibles et proposant un semblant de démarche formalisée, nous pouvons situer les deux premières pratiques éducatives de type critique l’une dans les écrits de Platon sur Socrate, l’autre chez les sceptiques pyrrhoniens. Chez Platon, la maïeutique socratique consiste à pousser par questionnement les raisonnements jusqu’à une éventuelle contradiction interne, et le personnage de Socrate, qu’il ait existé ou non, s’est révélé très efficace à démontrer que, derrière des discours parfois pompeux, la trame argumentative est parfois fort maigre. Les pyrrhoniens, quant à eux, bâtirent autour de Pyrrhon d’Elis une école doctrinale à part entière, dite « sceptique », (du grec skeptikos, qui examine), selon laquelle la pensée humaine ne peut vraisemblablement parvenir à aucune certitude, ni sur la vérité d’une assertion, ni sur sa probabilité. Brochard en donne la définition suivante : « Le scepticisme consiste à comparer et à opposer entre elles, de toutes les manières possibles, les choses que les sens perçoivent, et celles que l’intelligence conçoit. Trouvant que les raisons ainsi opposées ont un poids égal, le sceptique est conduit à la suspension du jugement et à l’ataraxie » (Brochard 2002, IV, 2). Si la suspension du jugement proposé par les sceptiques pyrrhoniens — l’épochè — est pratiquement stérile en terme de production de connaissance, la comparaison des hypothèses et le frein au jugement hâtif en toute circonstance sont les deux mamelles de ce que nous désignerons par la suite scepticisme moderne, par rapport au scepticisme ancien de Pyrrhon. À titre informatif, les rares écrits sceptiques contemporains de Pyrrhon auxquels on doit le terme zététique sont le fait de Timon de Phlionte. Il faudra attendre plus de quatre siècles pour qu’Agrippa et surtout Sextus Empiricus reprennent en une version à peine plus élaborée la doctrine sceptique.
Du propre aveu de Sextus Empiricus : « Le scepticisme est la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, capacité par laquelle, du fait de la force égale qu’il y a dans les objets et les raisonnements opposés, nous arriverons d’abord à la suspension de l’assentiment, et après cela à la tranquillité » (Sextus Empiricus 1997, I,8).
Comme on peut le constater, le scepticisme ancien avait des visées un peu lénitives, qui tranche avec le scepticisme moderne, volontairement actif, voir activiste : l’objectif était non la connaissance la plus juste, mais la tranquillité. Au Moyen-Âge, les premiers contreforts formels de la pensée critique sont entre autres de Thomas d’Aquin, dans sa Somme Théologique. D’Aquin insista notamment sur l’importance de la critique des thèses, même des siennes, et encouragea à cultiver le raisonnement. La forme des articles de sa Somme est un exemple d’application du principe de charité — les objections présentées par d’autres étant montrées sous un jour favorable et mesuré avant d’être démolies. Durant la Renaissance, des noms comme Érasme ou Thomas More contribuent à l’élaboration d’un scepticisme un peu rénové et raisonnable (Chomarat 1991), et c’est surtout Francis Bacon, par son opposition argumentée à la scolastique, qui posera les bases d’un empirisme de facture moderne et d’un véritable scepticisme méthodologique : dans la présentation des causes d’erreurs, il construit la théorie des idoles ou fantômes qui obsèdent et troublent l’esprit, qu’il divise en quatre espèces curieusement proches des catégories que nous développerons dans cette thèse. Poursuivant son entreprise, il stigmatise la fausse philosophie, dans laquelle il range la sophistique, la superstition et la pensée basée sur des préjugés (Drèze 2000). Descartes viendra poser la seconde brique formelle à l’édifice, avec l’inachevé Règles pour la direction de l’esprit, et Machiavel, Hobbes puis Locke donnèrent la dimension morale et politique à cette pensée critique. Vinrent ensuite les critiques précises et purement scientifiques, avec Boyle surtout et Newton dans une certaine mesure, avant l’érection de la raison comme outil majeur de discipline de la pensée avec parmi bien d’autres Montesquieu, de Voltaire et Diderot. L’outil « raison » débordera ensuite avec Comte et Spencer dans la vie sociale selon un certain moralisme, avec parfois de sinistres dévoiements.
D’un point de vue purement éducatif ou didactique, la revendication de l’esprit critique et du refus des actes de foi dans l’enseignement se retrouve très tôt, chez le frère morave Coménius (Prévot 1981) d’abord, chez Jean-Jacques Rousseau ensuite avec autant d’audience que d’ambiguïtés. Elles furent plus tard reprises dans les réflexions libertaires, dont les prémices de propositions éducatives critiques rationnelles remontent au philosophe William Godwin, puis à Max Stirner, fustigeant solennellement la cervelle hantée et le gendarme dans la poitrine.
Les penseurs anarchistes frayèrent ensuite avec l’idée rousseauiste qu’il faut refuser la transmission de contenus culturels acceptés et tenus comme valables sans distance critique. Tolstoï, qui se fit le relais de cette opinion, l’écrira ainsi : « Mon activisme social a d’abord concerné l’école et l’enseignement et quarante ans plus tard, je suis plus que jamais convaincu que ce n’est que par l’éducation, par l’éducation libre, que nous parviendrons à nous arracher à l’horrible ordre des choses qui prévaut actuellement et à le remplacer par un ordre rationnel » (Smith 1983, cité par Baillargeon 2005b, p. 57).
Introduction générale |