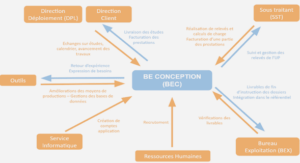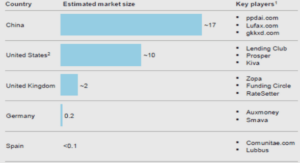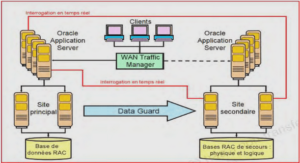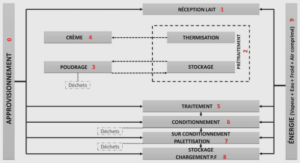Vers un corpus de photographies apprenantes
La question « quelles images montrer à l’élève » est une question d’une importance fondamentale. La réponse à cette question, pour l’image photographique, a été l’objet d’une recherche approfondie sur plusieurs années. Laurent Gervereau y avait répondu pour les images dans plusieurs ouvrages, Marie-Monique Robin avait sélectionné les 100 photos du siècle, nous nous sommes appuyée sur leur expérience. A Arles, nous avons beaucoup échangé, avec les professionnels de la photographie, de l’éducation, les médiateurs culturels, sur la nécessité de ce corpus. A Perpignan, nous avons rencontré des membres du Clemi avec qui nous avons pu discuter également. Parallèlement, nous avons recensé les choix opérés dans les manuels scolaires par les iconographes. Nous avons aiguisé nos regards à Sète et au pavillon photographique. Nous avons interrogé également les contenus des formations en photographie, en lycée professionnel où deux heures de culture photographique sont inscrites au programme, en BTS, en école de photographie. Nous avons participé à des stages de photographie, à un atelier créatif pour adultes au conservatoire de Carcassonne, animé par le Graph pour les cours de photographies et des cours d’histoire de l’art. Nous avons relu le manuel scolaire de l’image au collège édité par Belin, la petite fabrique de l’image également. Puis, nous nous sommes lancée dans la création d’un corpus de photographies apprenantes, de façon scientifique, pour une éducation à l’image photographique. Il servira de base d’échanges, de discussions pour la création d’un parcours plus ambitieux. Nous avions déjà pu nous essayer à l’exercice en repérant les premières photographies importantes de l’histoire dans le premier chapitre de notre partie 3. Il s’agissait d’aller plus loin encore. Nous avons eu besoin de définir des critères de sélections, de nous interroger sur la forme que ce corpus pouvait prendre à la lumière des travaux déjà engagés. Ce corpus devait répondre à l’iconothèque que tout élève devrait posséder à sa sortie du lycée.
Les critères de sélection
Deux critères ont été déterminants pour notre sélection d’un corpus apprenant : le nombre d’occurrence de la photographie dans les ouvrages des auteurs reconnus dans ce domaine, cette notion étant liée à la renommée de la photographie. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une photographie sélectionnée par des auteurs reconnus a davantage été vue, et est entrée dans une culture de l’image commune. La renommée acquise par les professionnels a permis sa célébrité chez les amateurs. La photographie a davantage circulée et recueille un nombre d’occurrence et de commentaires plus importants sur le web. Sa connaissance contribue à sa reconnaissance comme image à connaître. Ce critère a été combiné à sa richesse iconique et à sa capacité à transmettre une information à des collégiens et des lycéens. Nous avons pour ce faire, choisi des photographies qui étaient en adéquation avec les programmes scolaires de l’enseignement secondaire. Les photographies sélectionnées se devant d’éclairer un point du programme scolaire, nous les nommerons photographies apprenantes. Cette sélection s’est opérée par période historique, 3 ont été retenues : le XIXème siècle, le XXème, le XXIème siècle.
Pour la période du XIXème siècle, nous avons choisi les photographies, sur le critère de la « première photographie de l’histoire », dans le corpus dressé dans le chapitre 1 de la partie 3. Pour le XXème siècle, nous avons procédé directement à une sélection des photographies apprenantes, dans l’ouvrage de Marie-Monique Robin dont nous avons dans un deuxième temps vérifié la présence (l’occurrence) chez les autres professionnels. Pour le XXIème siècle, nous nous sommes fiée à la citation et l’analyse de professionnels de l’image, comme par exemple celle de Lionel Charrier, qui, interviewé par Brigitte Patient, mettait en avant une photographie à retenir pour l’année 2017. Nous avons établi ainsi, un premier relevé de 3 photographies du XIXème siècle, 17 photographies pour le XXème siècle, 2 photos pour le XXIème siècle.
Ensuite, nous avons vérifié que toutes ces photographies appartenaient aux images essentielles de la culture de l’image en consultant d’autres ouvrages sur la photographie. Trois ouvrages ont été retenus offrant un panorama de la culture photographique : Photo : box destiné à un large public, Tout sur la photo aux éditions Flammarion, abordant les mouvements et des chefs d’œuvre, destinés à des professionnels, des enseignants et Pourquoi est-ce un chef d’œuvre ?, ouvrage d’analyse de 80 photographies.
Nous avons voulu compléter notre corpus par une recherche sur internet, et un article a retenu notre attention « 13 photographies qui marqueront à jamais notre histoire » publié par le Daily geek show, édité par Wild Pixel, une entreprise dédiée aux jeux vidéos et au livre numérique. Ce sera la seule ressource numérique à laquelle nous confronterons notre première sélection d’images.
Ce premier travail de repérage et d’analyse réalisé, nous nous apercevons qu’il existe des photographies absentes du livre de Marie-Monique Robin que nous jugeons essentielles et ajoutons par exemple : l’Afghane de Steve Mc Curry, par exemple. Des photographies que nous n’avions pas sélectionnées dans l’ouvrage de Marie-Monique Robin sont récurrentes dans tous les ouvrages comme la photo du Ché, le défilé de travailleurs de Tina Modotti, la voiture déformée de Jean Henri Lartigue.
Pour le XXIème siècle, nous choisissons finalement de consulter le livre des 10 premières années du XXIème siècle, réalisé par Marie-Monique Robin qui nous permet de garder notre première méthode de sélection : à partir de sa sélection, nous établissons une liste puis nous recherchons les images dans d’autres ressources sélectionnées pour confirmer ou infirmer la première sélection réduite à 3 clichés.