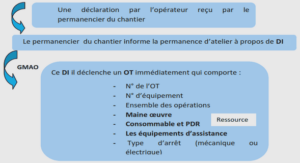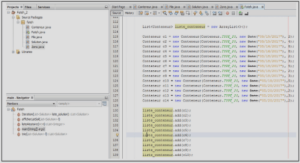PORTEE ECONOMIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Revue de la littérature relative à l’enseignement supérieur Introduction
L’histoire de l’enseignement supérieur remonte à des siècles particulièrement en Europe. Mais il s’est matinalement consacrées à la satisfaction des questions pratiques comme la médecine, les ponts et chaussées sans lien fondamental avec la recherche (VELUT, 2012). C’est le cas en France où, sous le modèle napoléonien d’enseignement pratique, instauré après la révolution de 1789, l’enseignement supérieur s’est développé en dehors de l’université. Ce terme avait d’ailleurs disparu du vocabulaire administratif pour ne réapparaitre qu’avec la loi du 10 Juillet 1896 sous la IIIe République (AGHION & COHEN, Éducation et croissance, 2004). La France souffre aujourd’hui encore de cette tradition d’écoles spécialisées conformément à l’hypothèse smithienne dans la Richesse des nations (1776). Toutefois, les prémisses de l’utilité du savoir et son impact sur la croissance et le bien-être des individus se faisaient sentir. Cependant, il faut attendre le débat sur la stabilité de la croissance néoclassique suscité par les néokeynésiens dans les années 1940 pour débattre de ses causes et finir par donner naissance à la théorie du capital humain (section I) et des analyses empiriques (section II).
La théorie du capital humain et de la croissance endogène
Les économistes ont discuté du rôle de l’éducation dans le cadre de la production et de l’amélioration de la productivité du travailleur. Le rôle du savoir dans la production est appréhendé depuis les mercantilistes comme le montre l’expression très célèbres de BODIN, « il y n’y a de richesse ni de force que d’hommes » en toute logique avec PETTY (1682) « la promotion des arts et des plaisirs suppose l’émulation. On trouve plus facilement un esprit génial et curieux parmi 4 millions de personnes que parmi 400. » 2 . Les libéraux classiques avec l’apologie de la division du travail d’Adam SMITH (1776) abondent dans le même sens (DIENG S. A., 2008). Mais c’est seulement avec les travaux pionniers de G. BECKER vers le milieu des années 1960 qui lui ont valu le prix Nobels d’économie en 1992 (FEREY, 2017), que, sous l’appellation de la théorie du capital humain, va se constituer une véritable science autour du rôle de l’éducation dans la productivité des travailleurs formés. Il y a également les travaux de SCHULTZ (1961), le penseur de la théorie du Capital humain (TCHOUASSI, 2006). SCHULTZ est d’ailleurs comme Becker de l’Ecole de Chicago. (KASSE , Economie de l’éducation, 2002; DIEMER, 2001). Egalement viendra la contribution de MINCER avec l’analyse du rôle de la femme dans la croissance 2 William Petty, Another essay in political arithmetric, 1682, cité par Simon (1981) p. 158, sur internet PORTEE ECONOMIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU SENEGAL – 9 – et le développement à la double identité d’agent reproducteur et facteur de production (MOKIME, 2011; TEIXEIRA, 2006; et, al). Le capital humain constituera un point focal dans les travaux de LUCAS, prix Nobels d’économie en 1995, et ROMER (1986 ; 1990 ; 1992) dans le cadre de la théorie de la croissance endogène (MOKIME, 2011; DIEMER, 2001; MUET, 1993) La théorie de la croissance endogène se distingue principalement de la théorie du capital humain par le fait que la première en prolongeant la dernière a intégré la technique en tant que variable endogène de la croissance et par la réhabilitation du rôle de l’Etat dans la fourniture de main d’œuvre qualifiée. Mais est-il besoin de rappeler le contexte de naissance de la théorie du capital humain et de celle de la croissance endogène qui se sont penchées sur la contribution de la connaissance des travailleurs dans la production et leurs développements ? En effet, tout commence par les travaux de HARROD (1947) et DOMAR (1946), économistes néokeynésiens qui s’intéressent à la possibilité d’une croissance équilibrée de plein-emploi s’inscrivant dans une dynamique de longue période (MOKIME, 2011; NIANG, 2008; AMABLE, 2000; BARRO & SALA-i-MARTIN, 1996; et, al). Ces auteurs arrivèrent à la conclusion que le « système capitaliste était intrinsèquement instable » (BARRO & SALA-i-MARTIN, 1996). Les conclusions de DOMAR et HARROD ayant fortement affecté le courant classique, les tenants de ce dernier, par les travaux de SOLOW (1956) et SWAN (1956) étaient en droit de réagir dans l’optique de faire une synthèse des approches classiques et keynésiennes et montrer l’existence d’une croissance équilibrée et dynamique (MOKIME, 2011; NIANG, 2008; HOWITT, 2004; et, al). Leur riposte faite à l’aide du modèle de Solow-Swan et de la fonction de production Cobb-Douglas, se fonde sur la décroissance des rendements factoriels (capital et travail) et la constance des rendements d’échelle mais également sur l’élasticité de substitution unitaire et continue ajoutée des conditions d’Inada (MOKIME, 2011; NIANG, 2008; TCHOUASSI, 2006; HOWITT, 2004; AMABLE, 2000; BARRO & SALA-i-MARTIN, 1996; et, al). Ils établissent une fonction de croissance par tête dite ‘dynamique fondamentale du stock de capital’, également appelé modèle de Solow-Swan dépendant d’une variable unique, le capital par tête (DIEMER, 2001; AMABLE, 2000; BARRO & SALA-iMARTIN, 1996; et, al). Considérer le capital par tête est justifié par le fait qu’il module mieux que le PIB, le rythme de la croissance absolue par la prise en compte des variations de la population. Ainsi, même s’il reste sourd sur la répartition réelle du revenu national (WODON & YITZAKI, 2002), il demeure une mesure plus fine de l’enrichissement ou de l’appauvrissement global d’un pays (MARTIN D. , 2009). Et cette grandeur, à l’état régulier du modèle de SOLOW-SWAN (1956) est constante et du coup, le revenu, le capital et la consommation (de type keynésien car on est à l’âge d’or du keynésianisme) s’accroissent au même taux que le travail, qui est le taux de croissance de la population (AMABLE, 2000; BARRO & SALA-i-MARTIN, 1996). Et par conséquent, il n’y a pas de croissance : c’est l’état stationnaire conformément au pessimisme de David RICARDO et de MALTHUS. Alors que cette période, d’après-guerre et de lendemain de la grande dépression des années 1930, était plutôt marquée par de fort taux de croissance (5% par an) dans les pays de l’OCDE (MOKIME, 2011; TCHOUASSI, 2006; et, al), cette thèse ne tenait pas. Ainsi, le modèle « ne fournit aucune explication des déterminants du taux de croissance par tête à long terme » (BARRO & SALA-i-MARTIN, 1996). Pour lever cette indétermination du déterminant de la croissance, les néoclassiques qui considéraient la contribution du facteur travail dans un prisme « exclusivement quantitatif », introduisirent un troisième facteur, « le résidu » déterminé par le progrès technologique sensé reposé sur les connaissances scientifiques, la créativité des hommes etc. (NIANG, 2008; TCHOUASSI, 2006; DIEMER, 2001; et, al). Ces éléments de base du progrès technologique convoqué étaient exogènes au modèle de SOLOW-SWAN (1956) mais permettaient d’appréhender le travail dans une approche qualitative. D’ailleurs, vu le poids important de la contribution du résidu, les économistes de l’époque réfutèrent son caractère exogène qui, de plus, est incompatible au postulat de concurrence pure et parfaite, chère aux libéraux (MOKIME, 2011; TCHOUASSI, 2006; HOWITT, 2004; DIEMER, 2001; BARRO & SALA-i-MARTIN, 1996; et, al). C’est ainsi que sont nées les premières tentatives d’endogénéisation du progrès technologique, les connaissances et la formation des travailleurs par la théorie du capital humain qui sera enrichie par la théorie de la croissance endogène. La théorie du capital humain est née avec les travaux précurseurs de MINCER (1958), père de la dite théorie et ceux de SCHULTZ en 1961, son penseur et Nobels d’économie pour la même raison. Le concept de capital humain insiste fortement sur l’importance du facteur humain dans les économies fondées sur les connaissances et les compétences (KASSE , Economie de l’éducation, 2002). Selon toujours, KASSE (2002), le capital humain peut se définir comme étant « les connaissances, qualifications, compétences et autres qualités personnelles possédées par un individu intéressant l’activité économique ». Le capital humain se manifeste généralement à travers le progrès technique qui recouvre trois acceptations dites de neutralité du progrès technique. La conception harrodienne de la neutralité du progrès technique est en exergue lorsque celui-ci agit en augmentant l’efficacité du facteur travail. Lorsque le progrès technique améliore l’efficacité du facteur capital, on parle de neutralité du progrès technique au sens de SOLOW. Et enfin, le progrès technique est dit neutre au sens de HICKS s’il augmente à la fois et également l’efficacité du facteur travail et celle du capital (NIANG, 2008). Si les travaux de SEN (1990 et 2000) sur l’indice du développement humain et sur la théorie des capacités (TILAK J. B., 2012; TCHOUASSI, 2006) constituent un prolongement de la PORTEE ECONOMIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU SENEGAL – 11 – théorie du capital humain, l’apparition du phénomène de classement des universités a non seulement permis de raviver la compétition entre les universités du monde entier mais il a aussi suscité l’arbitrage entre recherche fondamentale et recherche appliquée (CACHO, 19/09/2014; PERRY, 2010; FRIAS & CHAPORRO, 2010). Ainsi, ce thème peut également constituer un nouveau chapitre de la théorie du capital humain. En effet, l’évaluation des établissements et leur rang dans les hiérarchies nationales et internationales dépendent avant tout de l’activité de recherche et de ses succès ou, pour être plus précis, des publications auxquelles elle donne lieu dans un certain nombre de revues de référence (ASCHIERY, 2012). C’est à juste titre que HAZELKORN (2014), de la Graduate Resaerch de l’Institut de Technologie de Dublin en Irlande craint que le phénomène de classement des universités ne perturbe l’activité de celles-ci en les orientant vers des activités à score élevé dans les calculs de classement au « détriment de l’enseignement et de l’assistance sociale pas moins important » dans l’évaluation de l’influence d’une institution mais « beaucoup plus difficiles à apprécier » (HAZELKORN, 2014; BOURDIN, 2008).. D’ailleurs, la recherche constitue une préoccupation particulière pour les pays développés. Dans son offensive pour la recherche et l’innovation, de BOISSIEU déclarait que les pays les plus avancés, proches de la « frontière technologique », déterminée par les États-Unis, miser sur l’innovation, la créativité et la R&D, est la « seule stratégie » pour garder leur avance (AGHION, CETTE, COHEN, & PISANI-FERRY, 2007; AGHION & COHEN, Éducation et croissance, 2004). Et de là, il relègue au rôle d’imitation et de copiage les pays en développement et rend inutile l’enseignement supérieur dans lesdits pays, qui doivent quant à eux « préférer l’imitation et le rattrapage, concentrant alors les efforts et les moyens financiers sur l’enseignement primaire et secondaire » (AGHION & COHEN, Éducation et croissance, 2004). Notons au passage que la recherche fondamentale est bien souvent cumulée avec la recherche appliquée ou l’ingénierie destinée à des fins particulières. Au demeurant, les deux domaines bien que distincts, reposent toutes deux, sur une base scientifique. L’ingénierie mise sur l’efficacité dans la résolution des problèmes de la société tandis que la recherche fondamentale s’appuie sur des constructions théoriques solides (FRIAS & CHAPORRO, 2010). D’ailleurs, ayant constaté une ruée massive d’ingénieurs vers les cycles doctoraux, ces deux chercheurs, lors d’un colloque sur l’enseignement supérieur organisé à Paris, portent la question sur l’utilité sociale des ‘ingénieurschercheurs’. Ils s’inquiètent sur l’éventualité de produit ambigu d’ingénieurs inefficaces et de chercheurs improductifs. Ils attirent tout de même l’attention sur le fait que former un ingénieur requière un « travail lourd » tout en approuvant l’idée d’initier celui-ci, à la recherche pour qu’il comprenne sa finalité afin de pouvoir travailler avec les chercheurs. Ceci pourrait faciliter l’innovation, « moteur du progrès social et économique » bien qu’elle ne s’apprenne (FRIAS & CHAPORRO, 2010). Dans une recherche dont le but est de cartographier et d’analyser la politique d’innovation dans un système d’enseignement supérieur en Israël, défini comme « Start-Up Nation », PERRY (2010), trouve l’innovation essentielle pour l’efficacité des systèmes éducatifs à l’heure où se répandent les concepts et pratiques des « open innovations » (PERRY, 2010). A ce stade, il convient de distinguer les innovations radicales des innovations incrémentales. Les innovations radicales ont des effets macroéconomiques tandis que l’effet des innovations incrémentales se limite au niveau microéconomique (AMABLE, 2000). L’innovation est fortement liée à la créativité des acteurs d’une économie pour surmonter les crises conjoncturelles et plus ou moins durables qui peuvent l’affecter. Le Maroc, cherchant des stratégies de développement de long terme sous le titre, « Prospective Maroc 2030 » retient que le terme «innovation» exprime « l’aptitude à créer des activités plus productives et à produire des produits non traditionnels à forte rentabilité à l’échelon local » pas sans se désoler du manque d’innovation des agents économiques du Royaume (Maroc : Haut-Commissariat du Plan, Juin 2007). Cependant, les pouvoirs publics, pris dans l’étau de la qualité et de l’efficacité externe des institutions d’enseignement supérieurs, mettent plus souvent l’accent sur la recherche orientée vers les objectifs socioéconomiques en lien avec les entreprises. Ainsi, certains chercheurs craignent l’éviction de la recherche fondamentale par la Recherche & Développement. A l’université nationale du Vietnam à Hanoi, appel est lancé « qu’il ne faudrait pas que les priorités économiques et commerciales empêchent de pousser très loin » (NGUYEN, 19/09/2014). Abondant dans le même sens, CACHO (2014), un scientifique de l’université de De La Salle au Philippines pense qu’il est dangereux de privilégier les activités parrainées par les ONG sur celles entreprises au gré de la curiosité des chercheurs. Les tentatives de confiner les pays en développement dans le prisme du primaire et du secondaire (AGHION, CETTE, COHEN, & PISANI-FERRY, 2007) se heurtent à d’autres travaux comme ceux de SEN (1990 et 2000) qui ont montré l’importance de l’éducation dans le bien-être des individus (IDH) et de l’enseignement supérieur dans le maintien des acquis au primaire et au secondaire. Mais l’observation des caractéristiques selon les niveaux de développement montrent des différences pluriformes. 2. Revue empirique des travaux sur l’enseignement supérieur En effet, les établissements d’enseignement supérieur ont la mission de contribuer au développement des connaissances, à leur diffusion ainsi qu’au travail de création dans toutes les sphères de l’activité humaine (MESRST/Québec/Canada, 1994). Ainsi, ils doivent fournir le capital humain nécessaire et qualifié pour les économies qui les absorbent. Cependant, les différences de développement entrainent nécessairement des différences de besoins en niveaux de main d’œuvre qualifiées malgré la mondialisation et la concurrence sur le marché des biens et services (AGHION & COHEN, Éducation et croissance, 2004). Ainsi, on constate des différences fondamentales entre l’enseignement supérieur dans les pays développés et celui dans les pays en développement. Ces différences sont principalement axées sur les taux de scolarisation, l’adéquation formation emploi, les taux de chômage, les taux de scolarisation des femmes etc. Dans la sous-section 1, nous allons voir l’état de l’enseignement supérieur dans les pays développés assimilés aux membres de l’OCDE, la sous-section 2 traite des pays émergents et la sous-section 3 est consacrée à l’Afrique subsaharienne.
L’enseignement supérieur dans les pays développés
Dans les pays développés, les premiers constats montrent des taux de scolarisation à l’enseignement supérieur qui dépassent 40% pour les jeunes d’âge compris entre 20 et 24 ans d’une part et d’autre l’articulation entre le sous-secteur et le secteur de la production reste très active. En effet, dans les pays développés, les taux d’accès à l’enseignement supérieur ont dépassé la barre des 20% depuis 1985 pour aller au-delà des 100% dix ans plus tard pour certains. Dans l’ordre, nous avons le Royaume Uni qui avait le plus faible TBS/ES (21,7%) était suivi par le Japon (27,8%). Les TBS/ES les plus importants étaient observés au Canada (69,6%), les Etats-Unis (60,2%). En 1995, soit dix ans plus tard, le Canada plafonne son TBS/ES à 102,9% suivi des Etats-Unis (81%) et de la Belgique (54,4%). Le Royaume Uni (49,5%) et le Japon (40,3%) occupent le bas de l’échelle (DIENG B. D., 2000). Ainsi, sur le plan de l’accès, la population européenne et de l’OCDE connait les plus forts taux d’accès à l’ES. En 2000, la part de la population de l’Union européenne âgée de 25 ans et plus ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur était en moyenne de 11,4% alors que quelques rares pays comme la Finlande (7,1%), la France (8,8%), la Suède (9,8%) et le Royaume Uni (9,8%) avaient des TBS/ES inférieurs à 10%. Ceux-là allaient même jusqu’à 16,8% en Irlande suivie des Pays-Bas avec 14,9%. En 2010, ces grandeurs se sont fortement améliorées et les TBS/ES se retrouvent dans l’intervalle [10,6% ; 20,3%] respectivement pour le Danemark et l’Irlande. La Corée du Sud qui avait en 2000 un TBS/ES de 14,8% le fait monté à 17,3% donnant ainsi une moyenne de l’OCDE de 14,5% légèrement au-dessus de celle de l’UE.
Chapitre I : Revue de la littérature relative à l’enseignement supérieur |