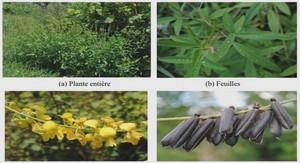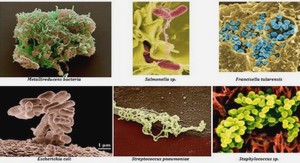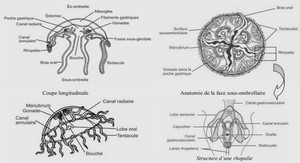Pollution atmosphérique et consommation
médicamenteuse
LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Selon la directive n° 84-360-CCE du 28 juin 1984 du Conseil des Communautés Européennes relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, la pollution de l’air se définit comme étant : l’introduction dans l’atmosphère par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou énergies ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l’homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels et porter atteinte ou nuire aux valeurs d’agrément et autres utilisations légitimes de l’environnement(Conseil des Communautés Européennes, 1984). La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) adoptée le 30 décembre 1996 par le Parlement français (loi n°96-1236, article 2) en donne cette définition : « Constitue une pollution atmosphérique ,l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives » (Loi n096-1236, article 2 du Parlement français). Selon le dictionnaire Petit Robert : du latin polluere (1440) signifiant « souiller en rendant malsain, la pollution est définie comme la dégradation d’un milieu donné par l’introduction d’un agent physique, chimique ou biologique (polluant). Par extension, la pollution est définie comme la dégradation des conditions de vie » (Petit Robert, 1989). D’après Elsom, la pollution atmosphérique résulte d’un apport de gaz et de particules émis par l’activité humaine mais également par des constituants 7 naturels (poussières volcaniques, pollen des arbres et des plantes, feux des forets, etc.) (Elsom, 1989). L’OMS définit la pollution atmosphérique comme étant : « La présence de substances contaminants ou polluantes dans l’air à une concentration qui affecte la santé humaine ou son bienêtre, ou qui produit d’autres désagréments » (OMS, 2000). On note que dans ces définitions, la pollution atmosphérique recouvre non seulement les modifications (dégradations) de la qualité de l’air mais aussi les conséquences des changements de la composition de l’air sur le fonctionnement des écosystèmes.
Pollution de l’air extérieur
Le développement économique, l’industrialisation et l’importance des moyens de transport définissent le nouveau visage des grandes villes du monde. Les activités humaines, comme les phénomènes naturels, influent de manière conséquente sur les mécanismes et processus mis en œuvre dans le système atmosphérique avec par exemple une très large diversification (chimie et tailles) de l’aérosol. Les émissions d’origine automobiles constituent l’un des principaux facteurs contribuant à la dégradation de la qualité de l’air dans les grandes métropoles et centres urbains. Elles contribuent à hauteur de 25 à 75 % à la pollution atmosphérique urbaine ; ce pourcentage reste fonction des polluants considérés et du lieu (PCFV, 2007). Les polluants les plus souvent rencontrés sont le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (dont le benzo(a)pyrène, composé hautement cancérigène), les composés organiques volatils (notamment le benzène), les oxydes d’azote (NOx), les matières particulaires (PM) etc. Les niveaux les plus élevés de pollution de l’air ambiant sont enregistrés dans les régions de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est, avec des niveaux annuels moyens dépassant souvent plus de 5 fois les limites fixées par l’OMS (10 8 μg/m3 pour les PM2, 5 et 20 μg/m3 pour les PM10). Ce sont ensuite les villes à revenu faible ou intermédiaire d’Afrique et du Pacifique occidental qui sont les plus touchées (OMS, 2018). I.2. Pollution de l’air intérieur Au cours des dernières décennies, plus de 100.000 nouveaux composés chimiques ont été introduits dans l’environnement intérieur et extérieur. Un nombre croissant d’études suggèrent qu’ils affectent la santé de l’homme, et en particulier la santé respiratoire (WHO, 2010). L’environnement intérieur retient particulièrement l’attention des scientifiques motivée par le fait que les personnes passent jusqu’à 90 % de leur temps à l’intérieur des locaux et plus particulièrement dans leur logement. De nombreux polluants, provenant d’une multitude de sources, ont été retrouvés dans les logements et à des concentrations parfois supérieures à celles de l’air extérieur (Bardana et al, 2001). Les niveaux de pollutions à l’intérieur des habitations peuvent être 10 fois plus élevées qu’à l’extérieur (OQAI, 2011). Dans le même temps, des technologies et des matériaux de construction se développent, permettant des constructions rapides, apportant des avantages techniques et économiques évidents, mais participant également à l’émission de nombreux polluants nouveaux dans l’air intérieur (OQAI, 2011). Dans les pays en voie de développement, une source de pollution intérieure majeure provient des combustibles ménagers solides utilisés pour les activités de cuisine ou chauffer les habitations. Les polluants les plus souvent rencontrés sont le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote (NOx), etc. II. Polluants atmosphériques Il existe des polluants dits primaires qui sont émis directement il s’agit des oxydes d’azote, du dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, des particules) primaires, 9 des métaux lourds et des composés organiques volatiles. S’ajoutent à ceux-ci des polluants dits secondaires et qui sont issus des transformations physico-chimiques des polluants gazeux primaires, pour donner de l’ozone, du peroxyacetylnitrate (PAN). L’évolution de la concentration atmosphérique de ces deux groupes de polluants a évolué différemment selon les pays avec une nette décroissance pour le premier groupe et une augmentation pour le second groupe et ceci dans les pays développés. II.1. Monoxyde de carbone (CO) Le CO est un gaz toxique incolore, inodore, insipide, qui provient d’une combustion incomplète, par défaut d’oxygène, des matières organiques (carburant pour les moteurs automobiles). Le CO se fixe sur l’hémoglobine pour former une molécule stable, la carboxyhémoglobine (COHb) empêchant ainsi, le transport de l’oxygène vers les tissus. En milieu urbain, les concentrations maximales de CO sont observées aux heures de pointe de circulation automobile, à proximité des autoroutes et des grandes artères urbaines (Dieme et al, 2012. Le Seuil de toxicité est de 30mg /m3 en moyenne par 24h ; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année. II.2. Oxydes d’azote (NOx) Malgré la présence de quantités importantes de N2O dans l’atmosphère, on parle sur tout du monoxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2) en ce qui concerne la pollution de l’air. En effet, NO et NO2 sont des gaz toxiques contrairement au N2O. Ils participent également à des réactions photochimiques importantes dans la troposphère. Le NO et le NO2 proviennent de sources anthropiques notamment les combustions, à haute température, de combustibles fossiles. A l’échelle planétaire, les orages, les éruptions volcaniques et l’activité bactérienne produisent de très grandes quantités de NOx. Toutefois, en raison de la répartition de ces émissions sur la surface terrestre, les concentrations 10 atmosphériques d’oxydes d’azote demeurent très faibles. En revanche, en milieu urbain, ces concentrations peuvent atteindre des valeurs très élevées. Ces oxydes d’azote sont impliqués dans la formation de l’ozone troposphérique. Le secteur des transports est responsable de plus de 60 % des émissions et notamment les anciens moteurs Diesel qui en rejettent deux fois plus que les moteurs à essence catalysés (Dieme et al, 2012). Leur présence dans l’air intérieur est due à des sources externes (foyers pour l’industrie et le chauffage, trafic automobile) ou internes telles que les appareils fonctionnant au gaz (cuisinières, chaudières, chauffe-eau) et dans une moindre mesure, les poêles à bois ou à essence et la fumée de cigarette (OMS, 2011). Le seuil maximal admissible fixé par l’OMS est de 400 µg/m3 en moyenne sur 1’heure et 150 µg/m3 en moyenne horaire sur 24 heures (WHO, 2005). II.3. Dioxyde de soufre (SO2) Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore dont l’odeur est acre et piquante. Il provient principalement de procédés industriels (production d’acide sulfurique, production de pâte à papier, raffinage du pétrole, etc.) et de la combustion de carburants fossiles contenant du soufre. À la suite de réactions chimiques dans l’atmosphère, le SO2 se transforme en sulfates (sous forme liquide ou solide). Dans la nature, les volcans sont responsables de la majeure partie des émissions de produits soufrés. Ce polluant provoque une irritation des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires (toux, gêne respiratoire, troubles asthmatiques) (Dieme et al, 2012). La valeur limite d’émission est de 50 µg/m3 comme Moyenne annuelle (Moyenne arithmétique) et de 125 µg /m3 comme Moyenne journalière.
Composés organiques volatiles (COV)
Les composés organiques volatils (COV) désignent une famille de plusieurs milliers de composés (hydrocarbures aromatiques, cétones, alcools, alcanes, 11 aldéhydes, etc.) aux caractéristiques très variables. La définition la plus communément admise (norme ISO 16000- 6) est celle de substances organiques dont le point d’ébullition est compris entre 100 et 240°C. La volatilité de ces composés explique leur capacité à se propager à distance de leur lieu d’émission et à contaminer l’air extérieur et intérieur. Ils sont souvent plus nombreux et plus concentrés à l’intérieur des habitations qu’à l’extérieur compte tenu de la multiplicité des sources intérieures (OQAI, 2011). Les COV peuvent être d’origine naturelle (émission par les plantes ou certaines fermentations) ou résulter le plus souvent de l’activité humaine (origine anthropique). Il est fréquent de distinguer le méthane (CH4) qui est un polluant primaire et un COV particulier, car naturellement présent dans l’air. On parle alors de COV méthaniques ou COVM et de COV non méthaniques (COVNM) pour les autres COV. Les COV sont largement utilisés dans la fabrication de nombreux produits, matériaux d’aménagement et de décoration : peinture, vernis, colles, nettoyants, bois agglomérés, moquette, tissus neufs, hydrocarbures, solvants… Ils sont également émis par le tabagisme et par les activités d’entretien et de bricolage. Ils vont d’une simple gêne olfactive à des irritations diverses voire une diminution de la capacité respiratoire, et peuvent même aller jusqu’à des effets mutagènes et cancérigènes (exemple : benzène, certains HAP) (Fernández et al. 2013 ; Duong et al. 2011 ; Sax et al. 2006).
INTRODUCTION |