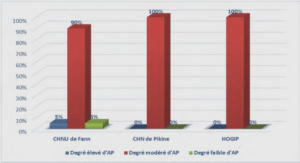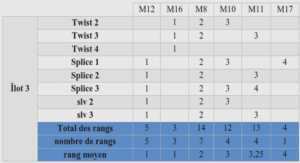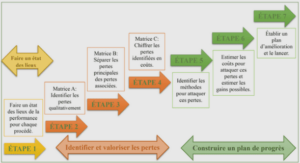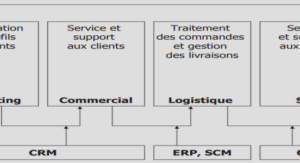La politique préindustrielle :
L’examen de la longue période allant jusqu’au seuil de révolution industrielle (les années 1750 environ) nous suggère que l’intervention de l’état dans la vie économique est un phénomène constant.
D’ailleurs ,vers 1700 avant jésus christ le code d’Hammourabi constitue ,avec ses 282 articles ,la base de la réglementation par l’état des activités agricoles et commerciales de l’empire babylonien .ainsi que ,l’empereur dioclétien met en place à partir de 288,d’importantes réformes économiques dans l’empire romain (notamment l’instauration de la capitation c’est-à-dire de l’impôt par tête ) et fait appliquer en 301, par un contrôle rigoureux des prix .Cette évolution contraste avec la régime économique de la république et des débuts de l’empire romain plutôt caractérisé par une certaine limitation du rôle de l’état en matière économique1 .
Du seizième au dix-septième siècle, les mercantilistes vont insister sur la nécessité d’une intervention de l’état dans la vie économique.
Pour ce courant de pensée, l’or et l’argent constituent la source et symbole de toute richesse ; la richesse d’une nation est donc liée à l’importance du stock de ces métaux précieux qu’elle détient .Pour les bullionistes espagnols et portugais, l’état se doit d’interdire les sorties d’or et d’argent et de contrôler les mouvements de fonds liés au commerce international par de multiples réglementations.
De telles mesures permettront de préserver le stock de métaux précieux provenant d’Amérique. Dans d’autres pays, l’action étatique se résume à trouver les moyens de faire entrer l’or grâce à une balance commerciale positive.
L’état devra donc d’une part, contribuer à une limitation des importations non indispensables (politique protectionniste) et d’autre part, favoriser le commerce d’exportation en développant une industrie nationale.
Ainsi en France2 ,sous l’impulsion de Colbert ,l’état va créer et gérer des manufactures nationales tout en apportant son soutien à des initiatives privées (sous forme de prêt, subventions ,primes…).une protection douanière vient compléter cette politique avec le tarif de 1664 qui établissait la franchise à l’entrée pour les matières brutes et l’imposition de droits élevés à l’importation des produits facturés .les premiers mercantilistes anglais ,virent dans le transport même les marchandises ,une source d’importations profits .Aussi l’état anglais accorda –t-il ,par les actes de navigation de 1651 et 1660, le monopole du transport de marchandises importées aux navires britanniques .
Les idées mercantilistes influenceront encore le comportement des états durant le dix-septième siècle .cependant, c’est cette époque sous l’influence d’un profond mouvement philosophique, que le rôle des états en matière économique va être totalement reconsidéré.
Le libéralisme économique :
Prenant appui sur les travaux philosophiques du début du dix-septième siècle ,vont se développer, à partir de 1750,différents courants de pensée qui insistent sur le libre jeu des forces naturelles du marché pour assurer à la fois l’affectation optimale des ressources et la redistribution correcte des résultats de la production. Ainsi Turgot,par l’édit de 1774sur la liberté du commerce des gains, applique ces nouveaux principes du « laissez faire, laissez passez « en supprimant les douanes intérieures.Le commerce extérieur est aussi libéralisé et l’acte le plus significatif en ce domaine reste certainement le traité de commerce de 1786 entre la France et l’Angleterre .Ces prémisses du libéralisme ont été amplement repris et amplifiés par les auteurs classiques, comme Smith ,Ricardo,Say,ou encore John Stuart Mill. Ainsi,Adam Smith, se fondant sur le principe de la « main invisible «, insiste sur la nécessaire liberté économique.
Plus tard, Ricardo reprendra ces critiques en prônant le libre-échange et en combattant notamment les obstacles apportés à l’importation du blé en Angleterre (« essai sur les prohibitions en agriculture, 1822) .Enfin, pour J.B .SAY, la liberté industrielle constitue le meilleur moyen pour prévenir les crises.
Sécurité intérieure et extérieure, justice, tels sont les attributs de « l’état Gendarme » dans cette société libérale décrite par les classiques.
Toutefois, la responsabilité de l’état, dans la production de biens collectifs non rentables pour l’initiative privée, est reconnue.
Les doctrines libérales se traduiront dans les faits durant la première moitié du dix-neuvième siècle .par exemple en matière de commerce extérieur Robert Beel3abroge progressivement, entre 1842 et 1846, les « CORN LAWS », puis entre 1846 et 1852 instaure le libre–échange.
En Angleterre (par suppression notamment des actes de navigation).
les remises en cause du libéralisme :
Alors qu’écrivent les libéraux optimistes que sont Batiat et Dunoyer, Villerme publie, en 1840, son « tableau de l’état physique et moral des ouvriers »décrivant les conditions de vie misérables des ouvriers et notamment les enfants.
L’absentéisme de l’état dans le domaine social ne pouvait qu’être remis en cause .C’est certainement Lacordairequi,en 1848,exprime le mieux le point commun à toutes les contestations des idées libérales et fait appel à une intervention de l’état dans le domaine social et économique . Ainsi, Dupont-Whiteconsidère (« L’individu et l’état « ,1857) que l’humanité est meilleure dans l’état que dans les individus ; elle s’épure, parce qu’elle s’élève dans cet être collectif «.
Enfin pour Bismarck, investigateur des « lois sociales » entre 1882 et 1890, l’état doit apparaître aux classes les plus nombreuses, les moins instruites, comme une institution non seulement nécessaire, mais bienfaisante «.
L’aboutissement de cette évolution des idées au dix-neuvième siècle et la radicalisation de la thèse interventionniste se trouvent dans l’œuvre de Marx.Celui-ci montre surtout dans le « manifeste communiste « (1848),que les mêmes lois qui ont déterminé la création et l’évolution du régime capitaliste engendreront sa destruction .L’abolition de la propriété privée et la socialisation des moyens de production ,manifestations de cette destruction ,donnent à l’état un rôle tout à fait nouveau par rapport aux théories précédentes puisqu’il aura la change complète du processus de production .
Si libéraux et partisans de l’intervention plus ou moins marquée de l’état se sont affrontés durant tout le dix-neuvième +siècle, il convient d’examiner les faits et la réalité concernant la place tenue par l’état dans la vie jusqu’à la fin des années 1920.
Les modalités d’intervention de l’état jusqu’en 1929 :
Ces modalités d’intervention vont évoluer entre le début du dix-neuvième siècle et les années 1920.quatre domaines sont plus particulièrement concernées par son intervention.
*L’état et la monnaie :
L’état dispose du « pouvoir de battre monnaie « il contrôle la frappe des monnaies métalliques ainsi que l’émission des billets de banque4 .
De plus, les principales banques centrales sont plus ou moins soumisesà l’autorité gouvernementale, même si elles ont un statut privé.
Ces banques différentes banques centrales influençaient de manière significative l’activité économique par la fixation du taux d’escompte, ce qui leur permettait de faire varier le montant des crédits accordés aux industriels et commerçant et d’influencer le comportement des banques commerciales.
*L’état et son budget :
Adam Smith reconnaissait déjà à l’état le droit de se substituer à l’initiative privée pour la réalisation de biens collectifs.
De fait, que ce soit par son activité dans le domaine des travaux publics ou pour la défense nationale, l’état sera conduit à injecter dans les économies des sommes non négligeables5.
De plus, des pays comme la France, l’Allemagne et la Grande –Bretagne consacrent une part significative de leur budget aux dépenses de défense nationale ( prés du quart pour les deux pays ).
Enfin, par le type de recettes qu’il prélève pour financer ses dépenses, l’état a aussi une action sur la vie économique.
Ainsi la Grande –Bretagne sera la première à instaurer l’impôt direct au début du dix-neuvième siècle. Elle ne sera suivie qu’en 1867 par le Japon ,1891 par l’Allemagne et ensuite par la France en 1914(contribution foncière, mobilière …..).
*L’état et le commerce international :
Le commerce international est certainement le domaine où l’état sera le plus présent durant le dix-neuvième siècle et où cette présence sera souhaitée et réclamée même par les plus libéraux.
La période de libre échange n’aura donc duré qu’une trentaine d’années et progressivement tous les pays revinrent, à la fin du dix-neuvième siècle, à un système protectionnistes .Seule la Grande –Bretagne restera fidèle au libre échange jusqu’en 1931 malgré des débats difficiles au début du vingtième siècle6 .
*Les interventions dans le domaine du travail et de l’industrie :
L’état avait été conduit à intervenir dans le domaine social pour y faire régner un peu plus de justice .Les réticences des libéraux face à ces décisions étatiques ont également été notées. Toutefois, peu à peu, l’idée d’un rôle social de l’état progresse.
Les principales mesures, en ce domaine, portent sur l’organisation du travail .Les lois sociales « de Bismarck constituent une référence et L’Allemagne apparaît, pour ces décisions prises entre 1882 et 1890, comme pionnière.
Il aura fallu attendre une cinquantaine d’années depuis que des voix s’étaient élevées comme celle de Lacordaire, pour que l’état intervienne Etats- Unisentre 1900et 1912.
Dans ce dernier pays, l’état trouvera un mode particulier d’intervention dans le secteur industriel par les lois anti-trust.
Durant le dix-neuvième siècle et jusqu’en 1914 l’intervention de l’état dans la vie économique sans être systématique et non négligeable.
La première guerre mondiale va bien évidemment renforcer cette influence puisque les gouvernements devront prendre à leur charge certaines fonctions essentielles: assurer l’approvisionnement et le transport des marchandises, intervenir même dans le secteur productif par une orientation de la main-d’œuvre disponible vers les secteurs prioritaires .Et pourtant lorsqu’il est fait allusion à la politique économique, Keynes en apparaît souvent comme l’instigateur et les années trente la première phase d’application .
Keynes et la politique économique :
Afin de comprendre la signification de l’apport keynésien en matière de politique économique, l’état est nécessaire de le situer dans son contexte historique et théorique.
La crise de 1929 :
La crise de 1929 est d’abord une crise financière qui se transforma rapidement en la plus grave crise économique et sociale connue par les pays industrialisés.la crise financière survient le 24 octobre 1929 lorsque les cours s’effondrèrent à wall-street, la bourse américaine, de prés de 12% en une séance7.
Pour comprendre l’ampleur de la récupération de cet évènement financier ,il est nécessaire de rappeler le mécanisme de l’achat sur marge qui avait permis dans les années 20 d’entretenir le mouvement de hausse des titre .pour simplifier, trois acteurs opèrent sur le marché :un acheteur ,un courtier et une banque .
Comme dans la période boursière des années 20les gains du processus spéculatif étaient élevés, les taux d’intérêts étaient de même de chacun des trois acteurs trouvait son bénéfice.
Si une baisse des cours survient, liée à un facteur conjoncturel quelconque, le courtier va accroître le dépôt de garantie demandé au client. Celui-ci, totalement engagé, ne peut souvent satisfaire cet accroissement de la marge qu’en vendant une partie de ses titres ;il accroît l’offre sur le marché et, si de nombreux opérateurs sont dans cette situation, la chute des cours s’accentue donnant ainsi naissance à un phénomène cumulatif.
La transformation de cette crise financière, en une crise économique grave est liée d’une part à l’ampleur de la baisse des cours mais surtout, d’autre part, au rôle joué par les banques.
En effet, les difficultés rencontrées par les courtiers se répercutent sur les banques qui ne sont pas remboursés.il s’ensuit trois difficultés qui s’enchaînent:
-des épargnants souhaitent retirer leurs dépôts à vue ;
-les banques sont en situation de faillite ;
-les entreprises et les ménages manquent de disponibilités financières.
Des entreprises font faillite et les ménages diminuent leur consommation. Alors les composantes de la demande chutent, générant des nouvelles faillites, du chômage et une nouvelle baisse de la demande .il convient d’examiner quelle fut laréponse des responsables politiques face à cette situation.
La réponse néo-classique :
Tout le dix-neuvième siècle a été marqué par les crises successives; par contre l’ampleur de la crise était sans précédent.
Confrontés à cette situation économique et sociale, les responsables politiques disposent d’un ensemble de théories qu’on peut qualifier de » synthèse néo-classique ».
Celle-ci repose sur deux éléments essentiels en matière de politique économique : la loi de SAY et le rôle des prix comme mécanisme d’ajustement.
-la loi de SAY formulée en 1803 combine trois idées essentielles :
-la monnaie est un « voile ».
-les produits s’échangent contre les produits ;
-toute offre crée sa propre demande.
Dans sa théorie SAY exprime cette loi comme suit : « …c’est avec des produits que nous achetons ce que d’autres on produit et …chaque produit trouvera d’autant plus d’acheteurs que tous les autres produits se multiplient davantage …l’argent ne remplie qu’un office passager dans ce double échange ».en conséquences des crises durables de surproduction sont impossibles .
-Dans l’analyse néo-classique, les prix jouent un rôle central comme mécanisme d’ajustement la loi de l’offre et de la demande stipule qu’en situation d’offre excédentaire l’équilibre est retrouvé par une baisse du prixet inversement en situation de demande excédentaire.
Ce paradigme général est appliqué à l’analyse de tous les marchés et particulièrement le marché du travail considéré comme un bien ordinaire.
L’offre de travail émanant des ménages et la demande provenant des entreprises sont des fonctions respectivement croissantes et décroissantes du taux de salaire réel.
Toute offre excédentaire correspond à un volant de chômage dit « volontaire » peut être résorbée par une baisse du prix du travail .un tel mécanisme permet, dans la vision néo-classique, la réalisation du plein emploi.
En combinant ces deux mécanismes, on comprend que la crise de 1929 ait surpris les théoriciens par son ampleur et par sa durée.les fondements du paradigme néo-classique alors dominant exclurent tout recours systématique à un agent extérieur pour remédier à cette situation même s’il est reconnu à l’état un rôle pour atténuer ponctuellement l’impact des cycles économiques.
La systématisation keynésienne :
En 1936, Keynes propose, dans la » théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie«, une systématisation de ces pratiques.
Les expériences concrètent menées dans divers pays trouvent dans l’ouvrage de Keynes un support théorique complet, cet auteur propose une vision renouvelée des mécanismes économiques débouchant sur la justification d’une intervention systématique de l’état.
De fait, il prend le contrepied de la théorie néo-classique précédemment exposée sur trois points :
-Le mécanisme d’ajustement par les prix peut s’avérer défaillant ; on peut considérer soit qu’il ya rigidité à la baisse de l’un des prix à savoir le salaire nominal, soit que l’ajustement constitue un cas très particulier de coordination des agents économiques.
-Le retour au plein emploi n’est pas automatique et l’économie peut durablement connaître une situation dite l’équilibre de sous-emploi.
-La relance par les composantes de la demande constitue, dans une économie de ce type, un moyen de réduire le chômage. Les composantes de la demande concernées peuvent être la consommation (par une réduction des impôts ou un accroissement des transferts), l’investissement (par une baisse du taux d’intérêt), les exportations (par une dévaluation) mais surtout la dépense gouvernementalequi sera ensuite privilégiée par les auteurs keynésiens.
Ainsi l’idée d’une responsabilité globale de l’état avec une politique économique à plusieurs facettes est plus récente et peut être reliée au développement des idées keynésiennes.
Eléments de méthodologie ;
Quelques grands principes méthodologiques, issue des travaux de Tinbergen (1952), seront tout d’abord développés de façon à analyser la politique économique comme un système de décision .ensuite la détermination du choix de politique économique sera étudié.
la politique économique comme système :
Pour Tinbergen, la politique économique peut être décrite comme un système de décision reflétant « les relations entre les objectifs qui déterminent la satisfaction du décideur politique mais qui ne sont pas directement contrôlés, par lui et des instruments qui constituent les variables de commande «.