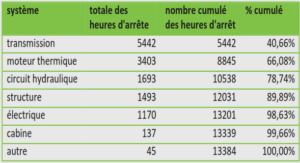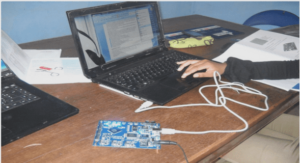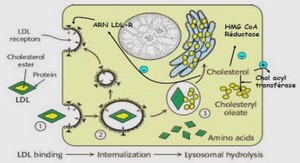PLASMAS FROIDS ET TRAITEMENT DE SURFACE
Qu’est ce qu’un plasma froid ?
Les plasmas constituent le quatrième état de la matière, faisant suite, dans l’échelle des températures, aux trois états classiques : solide, liquide et gaz. En théorie, un plasma est un gaz totalement ionisé dans lequel on a macroscopiquement la neutralité électrique. En réalité et par abus de langage, on désigne par le terme plasma tous les gaz ionisés quel que soit leur degré d’ionisation δ (Eq. 1). Celui-ci varie dans des proportions très importantes suivant la nature du plasma considéré : de 10-8 pour des plasmas de décharge à faible intensité à 1 pour les plasmas, complètements ionisés, de fusion (plasma thermonucléaire, étoiles, etc.).
Un plasma étant un milieu énergétique il peut contenir les diverses espèces suivantes : électrons, ions positifs et négatifs, photons, atomes, neutres (atomes ou molécules) excités ainsi que des fragments de molécules dissociées appelées radicaux [1]. n n N δ = + Eq. 1 avec : n : densité du plasma (n ≈ ne ≈ np) ; ne : nombre d’électrons libres par unité de volume ; np : nombre d’ions positifs par unité de volume ; N : nombre de neutres par unité de volume.
A température ambiante et à l’équilibre, les gaz ne sont pratiquement pas ionisés : il y a seulement quelques électrons libres par cm3 , ceux-ci étant généralement dus aux rayons cosmiques. Un premier moyen de créer un plasma consiste à élever la température du gaz. En effet, dans ce cas certaines molécules acquièrent une énergie d’agitation thermique suffisante pour que, sous l’effet des collisions, une partie de leurs électrons soient arrachés. Typiquement, si la température atteint environ 104 à 105 K, la plupart de la matière est ionisé [2].
En chauffant le gaz pour créer l’ionisation, on obtient un milieu à l’équilibre thermodynamique c’est-à-dire dans lequel toutes les particules (électrons, ions, neutres) ont la même température. Il est également possible de créer un plasma à des températures proches de la température ambiante en appliquant un champ électrique au milieu. On parlera alors de plasma créé par décharge électrique. Dans ce cas, le champ électrique a pour effet d’accélérer les électrons à des énergies suffisantes pour qu’ils puissent, par collision, ioniser les molécules. On a alors un phénomène d’avalanche électronique qui peut, si le champ est suffisamment élevé, conduire à la formation d’un plasma. Suivant la puissance dissipée, le plasma peut être : − proche de l’équilibre thermodynamique : ce qui se traduit par une température électronique Te proche de la température du gaz Tg.
Quels sont les traitements de surface réalisables avec un plasma froid ?
Les plasmas froids présentent un fort potentiel pour les traitements de surface. En effet, si les espèces énergétiques qui sont créées dans le plasma (photons, ions, molécules ou atomes excités) ont assez d’énergie pour casser des liaisons à la surface, elles n’en n’ont pas suffisamment pour pénétrer dans le matériau au-delà de quelques dizaines de nm. De plus, ces mêmes espèces ainsi que les radicaux peuvent réagir avec les atomes de la surface modifiant ainsi la composition chimique de la surface du matériau.
Lorsque le gaz contient du silicium ou du carbone, ces atomes peuvent se déposer et conduire à la formation d’une couche. A contrario, les réactions de surface peuvent également conduire à la formation de groupements volatiles comme COx, H2, SiFx et ainsi enlever de la matière au matériau initial. Ainsi, sous le terme générique traitement de surface, on regroupe : l’activation de surface, les dépôts de couches minces, la gravure ou le nettoyage, et la stérilisation. Nous décrirons brièvement les principes de chacun de ces traitements.
Activation de surface
On regroupe sous le terme d’activation de surface les procédés ayant pour objectif de modifier l’énergie ou la réactivité de surface d’un matériau sans pour autant rajouter de matière. Par exemple, la modification de l’énergie de surface d’un polymère entraîne une modification de sa mouillabilité. La mouillabilité de surface est l’aptitude d’une goutte d’un liquide à Chapitre I 8 occuper la plus grande aire possible sur cette surface : plus l’énergie de surface est grande, plus la mouillabilité est bonne et plus le liquide a tendance à s’étaler sur la surface.
Ainsi, l’augmentation de la mouillabilité d’un film polypropylène peut, par exemple, permettre l’adhésion d’encres aqueuses (non polluantes contrairement aux encres à solvants) [3]. La modification de la réactivité de surface d’un matériau entraîne le greffage de groupements réactifs. Ces groupements peuvent ensuite réagir chimiquement avec un autre matériau. L’augmentation de la réactivité de surface peut, par exemple, s’avérer très utile dans le cas du collage de deux polymères. Notons qu’une modification de la réactivité de surface entraîne la modification de l’énergie de surface, cependant l’inverse n’est pas toujours vérifié.
Dépôt de couches minces
Comme son nom l’indique, le dépôt de couches minces consiste à déposer une fine couche, de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres, à la surface d’un matériau (substrat) afin de lui conférer une ou plusieurs propriétés spécifiques. Parmi celles-ci, citons le durcissement pour des applications mécaniques, l’anti-réflectivité pour des applications optiques, l’isolation pour des applications électriques, la conduction pour limiter les effets électrostatiques … Dans chaque cas, la nature du matériau déposé dépendra évidemment de la propriété recherchée. Parmi ces matériaux, l’oxyde de silicium (SiO2) est largement utilisé.
En microélectronique, il a d’abord servi comme couche de passivation, d’isolant intercouches, ou encore de masque pour la lithographie de circuit intégré [4]. Plus récemment, il a été utilisé comme isolant de grille dans les transistors à film mince [5]. Son domaine d’application ne se cantonne pas pour autant au seul domaine de l’électronique. En optique, il est utilisé comme couche anti-réflective et protectrice (verre de lunettes ou phare de voiture) [6]. Dans le domaine de l’emballage alimentaire, cet oxyde est employé comme couche barrière à l’oxygène [7].