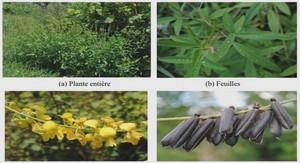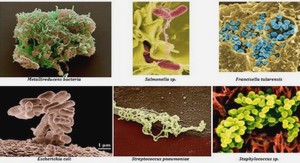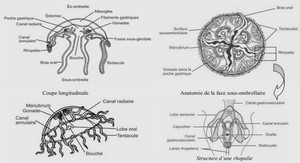PHYTOTHERAPIE DES AFFECTIONS
OPPORTUNISTES DU SIDA
La situation du SIDA
. Dans le monde (Rapport ONUSIDA, 2011) Depuis l’année 2002, le SIDA est considéré comme une pandémie globale (Lô, 2012). Les dernières estimations fournies par le rapport ONUSIDA 2012 porte à 34 millions le nombre de personnes séropositives au VIH dans le monde. Ce qui permet d’estimer à plus de 25 millions le nombre de mort depuis le début de la maladie en 1981. Les baisses les plus importantes du nombre de nouvelles infections à VIH depuis 2001 ont été observées dans les Caraïbes (42 %) et en Afrique subsaharienne (25 %). le nombre de nouvelles infections en Moyen-Orient et en Afrique du Nord a augmenté de plus 35% (passant ainsi de 27 000 à 37 000 personnes. Le nombre de décès liés au sida en Afrique subsaharienne a diminué de 32% de 2005 à 2011, malgré le fait que la région représentait encore 70% du nombre total des décès dus au sida en 2011.
Au Sénégal
Au Sénégal, les premiers cas ont été diagnostiqués en 1986 et depuis lors on a enregistré une progression rapide : 6 cas en 1986, 66 cas en 1987, 181 cas en 1988, 425 cas en 1990, 80 000 cas en 2000, ces chiffres restent presque constant avec une moyenne de 5000 décès/an. La surveillance sentinelle a montré une stabilité de la prévalence dans la population générale. La situation épidémiologique est discrète comme une épidémie de type concentré avec un taux de prévalence de 1,5% chez les femmes enceintes et une prévalence de l’ordre de 15 à 20% chez les travailleurs du sexe. En 2005, les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) ont montré qu’au niveau national, la prévalence globale (tout sexe confondu) est de 0,7 (RAPPORT ESTHER, 2009). Les femmes avec un taux de prévalence de 0,9% sont deux fois plus 7 infectées que les hommes (0,4%). Ces taux cachent cependant les disparités entre les régions dont certaines affichent une prévalence supérieure à la moyenne nationale. Il en est ainsi pour les régions de Kolda et de Ziguinchor qui enregistrent respectivement des taux de 2% et 2,2%, celle de Fatick et de Kaolack à leur tour une prévalence de 1% chacune (Centre de recherche pour le développement humain, 2005). Cependant le caractère concentré de l’épidémie et les réalités du contexte socio-économique expliquent la persistance de facteurs de vulnérabilité et laissent planer une menace de propagation du VIH au Sénégal. Ces facteurs sont liés à la pauvreté, à la position économique et sociale des femmes, à l’analphabétisme et surtout à la prostitution féminine et masculine qui semble toujours être le principal moteur de l’épidémie au Sénégal, avec une prévalence du VIH pouvant atteindre 30% parmi les professionnels du sexe à Ziguinchor (KANE, 2007). 2. Les modes de transmission du VIH Le virus du SIDA est un virus exclusivement humain. Le VIH-1 et le VIH-2 suivent les mêmes modes de transmissions. On le trouve en quantité significative dans les liquides biologiques tels que le sang, le sperme, les secrétions vaginales. Sa présence dans les autres produits biologiques que sont la salive, les larmes, les selles, les urines, le liquide céphalorachidien, le lait maternel, est de très faible quantité, si bien que cela ne représente pas un risque de transmission dans la vie quotidienne (BRUNDAGE, 1990). Cependant, trois principaux modes de transmission sont retenus : – La transmission sexuelle ou transmission horizontale. – La transmission sanguine. – La transmission maternofœtale ou transmission verticale 8 3. Dépistage du VIH au Sénégal Au Sénégal, le dépistage du VIH est gratuit et volontaire pour tous les sujets qui désirent connaitre leur statut sérologique. Par contre ce dernier est révélé après un don de sang destiné à sauver des vies humaines. Cependant le dépistage du VIH est de plus en plus recommandé chez la femme enceinte pour éviter, en cas d’infection une éventuelle contamination du bébé. Le dépistage du VIH est effectué dans toutes les structures de santé publique et il repose sur des tests de diagnostic sérologiques. Il faut noter qu’en dehors du test ELISA qui est utilisé, on fait appel aussi à deux tests rapides qui sont : – la Détermine qui est un Immuno-essai rapide – l’ImmunoComb (HIV1&2Bi Spot) IV. L’INFECTION A VIH 1. Agent pathogène http://acces.ens-lyon.fr/biotic/immuno/html/strucvih.htm Figure 1 : Schéma organisationnel de l’HIV 9 Le VIH appartient à la famille des Rétrovirideae, à la sous famille des Lentivirideae et au genre Lentivirus (ELIMANE, 2001). Le VIH est un virus à ARN enveloppé, la surface du virus est dotée de deux glycoprotéines d’enveloppe qui sont : – la GP120 qui reconnait les récepteurs CD4 qui sont présents à la surface des lymphocytes et que l’on trouve aussi dans les macrophages humains. – la GP41 qui assure la fusion du virus aux lymphocytes qui sont la principale cible. (SERE, 2004) Le VIH-1 présente des souches qui peuvent être classées en quatre groupes : le groupe M (major), le groupe O (outlier) et deux nouveaux groupes, N et P. Ces quatre groupes peuvent représenter quatre différentes introductions des virus d’immunodéficience simienne chez l’homme. Le groupe O semble être limité au Centre-ouest de l’Afrique et le groupe N, la souche découverte en 1998 au Cameroun est extrêmement rare. En 2009 une nouvelle souche étroitement liée au virus de l’immunodéficience simienne fut découverte chez une femme camerounaise. On la désigna sous le nom VIH-1 groupe P. Il faut noter que plus de 90% des infections par le VIH-1 appartiennent au groupe M. Au sein du groupe M il existe au moins neuf sous-types du VIH-1 distincts génétiquement : il s’agit des sous-types A, B, C, D, F, G, H, J et K. (HIV, 2013)
La physiopathologie
Le VIH désorganise le système immunitaire en infectant les lymphocytes TCD4+. La fixation de la particule virale sur les lymphocytes TCD4+ se fait par la liaison de la GP120 à la molécule CD4 (KINTEGA, 2006) Les lymphocytes TCD4+ sont en effet les cellules coordonnatrices de la réponse immunitaire. Elles jouent un rôle tout à fait central. La mort des cellules 10 infectées est consécutive au détournement de la machinerie des lymphocytes qui ne peuvent plus fabriquer leurs propres molécules, ainsi qu’à la destruction de l’intégrité membranaire au moment de la sortie des virus néoformés. Par ailleurs les cellules infectées exposent à leur surface membranaire des protéines virales. Ces protéines sont reconnues par des cellules immunitaires saines et s’accolent aux lymphocytes infectés. S’en suit un processus de « baiser de la mort » (kiss of death) par lequel la cellule saine est détruite par activation de la voie de l’apoptose. (Lô, 2012) 3. Les différents stades de l’infection (JOHNSON, 2001) On observe quatre stades : – la primo-infection – la phase asymptomatique – la lymphadénopathie généralisée et persistante – le stade maladie (SIDA) qui revêt deux formes, une mineure et une majeure.
La symptomatologie aux différents stades (GIRARD, 2004)
La primo-infection Elle correspond à la pénétration du virus dans l’organisme. Elle est suivie d’une période « silencieuse » qui dure trois mois et durant laquelle le virus n’est pas détectable par les tests sanguins. C’est la période de multiplication du virus qui entraine une forte virémie. Dans moins de 25% des cas, on peut observer à ce stade une mononucléose infectieuse associée ou non à une atteinte neurologique aigue à type de méningite lymphocytaire, de syndrome psychiatrique, de neuropathie périphérique ou myélopathie. (HOEN, 2004).
La phase asymptomatique
Elle peut durer deux à dix ans et elle est marquée par une absence de signe clinique. A ce stade, certaines PV VIH présentent une lymphopénie T4. La vitesse de progression de ce stade varie selon différents facteurs qui sont le mode de transmission, l’âge, le type de virus(le VIH-1 étant 10 fois plus fréquent que le VIH-2), les cofacteurs qui peuvent être viraux, bactériens, génétiques etc. (PODA, 2007)
La phase de lymphadénopathie généralisée et persistante
Elle se caractérise par des adénopathies qui durent plus de trois mois, d’au moins 1cm de diamètre. Elles sont indolores et comportent deux aires extrainguinales. Il s’agit d’une hyperplasie folliculaire sans étiologie précise. Mais aussi on note le syndrome constitutionnel appelé phase d’ARC (Aïds Related Complexe) se caractérisant par une fièvre constante, un amaigrissement, une diarrhée persistante, une asthénie prolongée, une candidose buccale, un zona et une leucoplasie chevelue qui constitue un important facteur de pronostic. (RAO, 2007).
INTRODUCTION |